17/12/2018
Gilles Balbastre « Le film dénonce trente ans de dérégulation néolibérale »
Coproduit par la Fédération des mines et de l’énergie (FNME) de la CGT et « Là-bas si j’y suis », site d’information de Daniel Mermet, « Main basse sur l’énergie » dresse le bilan accablant des privatisations dans l’électricité. Entretien avec son réalisateur.
Pourquoi votre documentaire n’est-il que sur Internet ?
Depuis mon film « les Nouveaux Chiens de garde », sorti en 2012, je suis tenu à l’écart de la télévision. Mais ce n’est pas la seule raison. La télé se resserre de plus en plus, autant sur la forme que sur le fond. Beaucoup de documentaires diffusés au cinéma le sont parce qu’ils ne trouvent plus leur place sur le petit écran. La télé nous parle plus volontiers de faits divers que de véritables enjeux citoyens. Elle préfère s’étendre sur l’héritage de Johnny Hallyday plutôt que sur le bradage au privé d’un bien public comme les barrages hydrauliques, l’un des sujets abordés dans « Main basse sur l’énergie ».
Comment est né votre film ?
La CGT énergie, qui avait beaucoup fait circuler « les Nouveaux Chiens de garde » par le biais des centres de vacances de la CCAS, m’a suggéré de faire un film sur la casse du service public de l’énergie. Il se trouve que je connaissais bien le sujet pour avoir déjà réalisé « EDF, les apprentis sorciers », à l’époque où se mettait en place la dérégulation du secteur. Et donc, ils ont fait une levée de fonds, sous forme de souscription, auprès de leurs syndiqués, pour financer le film.
Qui est à la manœuvre, dans ce hold-up que vous dénoncez ?
Comme le mouvement des gilets jaunes, le film dénonce trente ans de dérégulation néolibérale. Dans les télécoms, les transports ou l’énergie, cette dérégulation permet la création de grandes fortunes. Ce n’est pas un hasard si l’on retrouve Xavier Niel (Free) et Patrick Drahi (SFR) dans les dix premières fortunes françaises, pour ne parler que des télécommunications. La même chose se met en place dans l’électricité. Prenez celui qui a acheté l’hebdomadaire « Marianne » et est entré au capital du « Monde », le milliardaire tchèque Kretinsky : il a fait fortune avec la dérégulation de l’énergie dans les pays de l’Est. On voit bien que le capital a la ferme volonté d’aller chercher partout l’argent public pour le transformer en argent privé. Et donc, depuis trente ans, via l’Union européenne, il n’a eu de cesse de casser les services publics.
Pouvez-vous préciser la responsabilité de l’Europe ?
Le début de la dérégulation de l’énergie, c’est une directive européenne datant de 1996. Il faut comprendre qu’un certain nombre de gens ont ouvert les portes aux tenants du capital. Ceux-ci n’ont pas fait le casse tout seul, mais à coups de lois, promulguées par des partis de droite et des sociaux-libéraux. C’est une sorte de casse légal, en somme.
Votre film montre bien l’absurdité de vouloir confier l’énergie au privé...
Si, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des services publics de l’énergie ont vu le jour un peu partout dans le monde, avec ce qu’on appelle des monopoles intégrés, prenant en charge la production, le transport et la commercialisation, ce n’est pas tant pour des raisons idéologiques que techniques. Avant-guerre, les coupures géantes étaient monnaie courante et les prix explosaient. Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’énergie est à la base un marché hautement spéculatif. Je le montre aussi dans « EDF, les apprentis sorciers », avec l’exemple de la Californie confrontée à des black-out (coupures générales) au début des années 2000. La société Enron faisait monter les prix en jouant sur le fait qu’on ne sait toujours pas comment stocker l’énergie, et que en conséquence, lorsqu’il y a un pic de consommation, il est nécessaire de produire les quantités demandées, sans quoi c’est le black-out. Mais, à force de jouer sur le risque de black-out pour gonfler les tarifs, le réseau a fini par s’effondrer. Aujourd’hui, ce sont les mêmes pratiques spéculatives qui menacent l’hydraulique en France, à travers sa privatisation en cours.
Les énergies renouvelables sont instrumentalisées pour détourner l’attention de cette casse. Pour autant, leur développement n’est-il pas nécessaire ?
Personne n’est contre les énergies renouvelables. Simplement, s’il n’y a pas assez de soleil ou de vent, et que cela se produit à un moment où on a besoin de 100 % de nos moyens de production, comment fait-on ? Pour éviter les black-out, et tant qu’on n’a pas trouvé comment stocker l’énergie, on est bien obligé de doubler le renouvelable par des énergies dites pilotables : le nucléaire, les centrales thermiques et l’hydraulique. Par ailleurs, il faut parler de la façon dont ces énergies sont mises en place. Prenons l’exemple de l’éolien. Au dos de ses factures EDF, le consommateur peut constater qu’il paie une contribution au service public de l’électricité (CSPE), représentant 16 % de la facture. Cette CSPE permet en fait à EDF de payer les promoteurs de l’éolien et ce, quel que soit le besoin réel en électricité ! Le tarif est fixé à 82 euros le mégawatt. C’est une rente pour le privé, un véritable hold-up.
12:38 Publié dans Cinéma, Connaissances, Economie, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : main basse sur l'énergie, film, gilles balbastre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
04/05/2016
DALTON TRUMBO
FILM DE JAY ROACH
En 1947, Dalton Trumbo fait partie des scénaristes respectés à Hollywood : son talent et sa rapidité en font un collaborateur recherché. Mais, c'est à cette époque que le sénateur Joseph McCarthy et le Comité des activités antiaméricaines se lancent à la poursuite des artistes hollywoodiens liés de près ou de loin au parti communiste.
Dalton Trumbo et certains de ses amis font ou ont fait partie de ses sympathisants. Si certains se demandent s'il faut collaborer avec McCarthy, Trumbo, fervent supporteur de la liberté d'expression, s'y refuse catégoriquement. Ce qui pourrait mettre sa carrière en péril...
Critique
Par Cécile Mury, Télérama
Crépitement de machine à écrire. Bruits d'eau. Le scénariste Dalton Trumbo travaille dans sa baignoire. Clope au bec et lunettes sur le nez, trempant devant une planche en équilibre instable, surchargée de feuillets et de cendriers, il tape comme un forcené. C'est ainsi qu'on nous présente le grand homme, ainsi qu'on le reverra souvent : portrait de l'artiste en stakhanoviste tout-terrain, débordé, mais jamais noyé... Dalton Trumbo est une figure historique comme en raffole d'habitude Hollywood, un vrai résistant, prêt à (presque) tout sacrifier pour ses idées, un bourreau de travail opiniâtre, surdoué, et, en définitive, victorieux de ses adversaires et de l'adversité.
Il n'a qu'un seul défaut, qui explique sans doute pourquoi ce biopic intelligent arrive si tard (le « vrai » Trumbo est mort en 1976) : c'est la plus célèbre victime de la chasse aux sorcières, sombre période où, sous l'emprise du maccarthysme, le Tout-Hollywood des années 50 s'est transformé en marigot paranoïaque. Une foire au lynchage et aux trahisons que peu de films ont, jusqu'à présent, revisitée. Jay Roach, d'ordinaire versé dans des comédies grand public (Mon beau-père, mes parents et moi) et son scénariste, John McNamara, ont osé s'attaquer au sujet. Ils usent habilement des ficelles de la biographie (une tranche de vie privée, une tranche de reconstitution soignée) pour appuyer leur démonstration politique : dénoncer les symptômes et les conséquences d'une poussée de fièvre fascisante en pleine guerre froide.
Reconnu coupable d'appartenir au Parti communiste américain, Dalton Trumbo écopa de onze mois de prison et, inscrit sur la liste noire des « traîtres » de Hollywood, perdit le droit d'exercer son métier. Il dut travailler dans l'ombre, utilisant prête-noms et pseudonymes, embauchant au passage sa famille pour livrer ses scripts. Ironie suprême : durant sa clandestinité, la profession lui décerna deux oscars sans le savoir (pour les scénarios de Vacances romaines, de William Wyler, et Les clameurs se sont tues, d'Irving Rapper).
Dans la peau de cet homme exceptionnel, à la fois attachant et tyrannique, rusé et intègre, Bryan Cranston (Breaking bad) tient le rôle de sa vie. On irait voir le film rien que pour son charisme, son énergie, son élégance narquoise, jusqu'au bout de la moustache.
Autour de lui, ce drame, traité avec la fluidité, l'humour et l'éclat d'une comédie, ressuscite tout un monde où les célébrités échappent, comme par miracle, à l'habituel effet « musée Grévin ». On croise, côté ennemis, un John Wayne benêt et ultra conservateur, une Hedda Hopper (fameuse pasionaria de l'anticommunisme) toute en perversité doucereuse. Mais c'est dans le clan Trumbo qu'on trouve les plus beaux portraits : Edward G. Robinson, l'acteur blacklisté, forcé à la trahison, ou Kirk Douglas, qui, avec Spartacus, offre sa chance de réhabilitation au scénariste paria.
Paradoxalement, le plus poignant, le plus fort de tous ces personnages est celui qui n'a pas vraiment existé : un scénariste, combinaison imaginaire de tous ceux que l'hystérie maccarthyste a irrémédiablement détruits. Chacun de ces rôles est une aubaine pour les comédiens, servis par des répliques ciselées... et parfois authentiques. Comme cette phrase de Dalton Trumbo, lors d'un interrogatoire de la commission des activités antiaméricaines : « Il y a beaucoup de questions auxquelles il ne peut être répondu par oui ou non que par un imbécile ou un esclave. » — Cécile Mury
12:34 Publié dans Actualités, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dalton trumbo, film, jay roach |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
26/03/2015
CENDRILLON LE FILM !
Les contes de fées ont le vent en poupe. Après "Blanche-Neige", "Blanche-Neige et le chasseur", Une version gore de "Hansel et Gretel" ("Hansel et Gretel : Witch Hunter" ), Jack le chasseur de géants", "La Belle et la bête", c'est au tour de "Cendrillon" de passer devant la caméra, sous la houlette de Kenneth Branagh, avec Cate Blanchett en belle-mère acariâtre et Lily James dans le rôle-titre.
De Kenneth Branagh (Etats-Unis), avec : Cate Blanchett, Lily James, Richard Madden, Stellan Skarsgård, Holliday Grainger, Sophie McShera, Derek Jacobi, Helena Bonham Carter - 1h44 - Sortie : 25 mars 2015
Synopsis : A la mort de sa femme, le père d'Ella s'est remarié. Son unique fille accueille sa nouvelle belle-mère et ses deux filles. Mais le père meurt à son tour et Ella se retrouve sous l'emprise de sa nouvelle famille qui l'asservie, la surnommant Cendrillon, car continuellement couverte de cendres. Quand elle croise un jeune homme dans la forêt, elle ne sait pas qu'il s'agit du fils du roi et en tombe éperdument amoureuse, croyant qu'il s'agit d'un employé du château. Toutes les jeunes filles du royaume sont bientôt invitées à un grand bal, et Ella espère y revoir son idylle de passage. Mais sa belle mère lui interdit et complote avec le Grand Duc. Seule l'intervention d'une bonne fée dénouera le nœud de vipères…
La version animée en "live"
Disney ne pouvait pas passer à côté de ces "ripolinage" des contes célèbres que le studio avait déjà adaptés en dessins animés, tels '"Alice au pays des merveilles" (Tim Burton), ou "La Belle aux Bois dormants" ("Maléfique" de Robert Stromberg). C'est donc en toute logique que sort aujourd'hui "Cendrillon", adapté du célèbre conte de Perrault, et de sa version animée de 1950, un des grands classiques maison.
Le film de Kenneth Branagh se réfère directement à cette dernière par nombre de références esthétiques. Lily James renvoie explicitement au physique de la Cendrillon de 1950, blonde et toute de bleu vêtue, tout comme la belle-mère acariâtre (Cate Blanchett) et ses deux filles (Holliday Grainger et Sophie McShera), les souris, la forme du carrosse issu par magie d'une citrouille, ou la pantoufle de "verre", et non de "vair" du conte… Une bonne partie de la critique est tombée à bras raccourcis sur le film, lui reprochant de piètres effets spéciaux en images de synthèse, ce qui est vraiment cracher dans la soupe. On peut compter sur Disney pour ne pas avoir lésiné sur ce chapitre.Si Kenneth Branagh est très inégal dans ses réalisations, il a plus d'une fois montré son intérêt pour le Fantastique (les contes de fées relevant du genre) : "Dead Again", "Frankenstein", "La Flûte enchantée", "Thor". Son approche de "Cendrillon" lui permet de déployer une mise en scène ample, avec moult décors luxueux, très détaillés et forts beaux, en extérieur comme dans les intérieurs. Tout comme les costumes, très nombreux, aux textures et couleurs merveilleuses. Le tout n'est pas "kitsch", comme l'on dit certains, mais en phase avec la plastique des illustrations des contes de fées.Lily James apporte toute sa candeur au rôle-titre, Cate Blanchett, toujours d'une beauté renversante et sophistiquée, cabotine à souhait, mais cela sied à son rôle odieux, tout comme Holliday Grainger et Sophie McShera qui interprètent ses deux filles insupportables. Des morceaux de bravoure traversent le film, comme la transformation de la citrouille en carrosse, ou son retour à l'état premier au dernier coup de minuit, la rencontre avec le cerf… Branagh multiplie par ailleurs les travelings et mouvements de caméra aériens spectaculaires pour en mettre plein la vue. Une belle adaptation qui, évidemment, ne peut que déplaire aux grincheux.
France TV - Culture Box
19:49 Publié dans ACTUSe-Vidéos, Arts, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cendrillon, film, walt disney |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
21/09/2014
Ceci n’est pas un tableau d’Edward Hopper
Shirley. Visions of Reality, de Gustav Deutsch. Autriche. 1 h 32
Voyage dans la peinture d’Edward Hopper, le film du cinéaste et architecte Gustav Deutsch nous absorbe vraiment à l’intérieur des toiles. Un étonnement enchanteur.
Les tableaux d’Edward Hopper requièrent au plus haut point la personne du spectateur, exigeant sa déambulation.
Ce n’est pas la manière de peindre mais l’essence même de sa démarche picturale qui vous place en voyeur. Force est ensuite d’en enjamber le seuil sous l’impératif de la projection. Puis, l’on reprend sa place initiale, poches emplies d’impalpable, à la façon d’un voleur qui n’aurait rien soutiré, ni dérangé. Qui n’a rêvé la voix des personnages de ses toiles habitées, la mise en mouvement de leur immobilité, quelques fragments de leurs motifs.
Ce fantasme dont la puissance peut nous fixer longtemps au sol, Gustav Deutsch nous offre le loisir, non de le réaliser, ce qui en confinerait l’espace, mais de lui offrir comme un nouveau limon d’imaginaire et de réflexion. Il a choisi treize tableaux dont il a reconstitué décors, lumières, costumes et accessoires.
Neuf ans de travail. Surtout, il a inventé un personnage féminin, Shirley (Stéphanie Cumming), s’emparant de toutes les possibilités ouvertes par Hopper, de tout ce que le peintre ne montre pas.
Dans la première pièce où se tient Shirley, les premiers mots de sa voix intérieure insultaient « l’affreuse lumière » de la chambre d’hôtel parisienne qu’elle a hâte de quitter. Les premiers plans montraient un compartiment de train, des sièges étrangement disposés et la jeune femme se détachant de l’un d’eux en amorce de l’histoire, la sienne, qu’elle va de toile en toile raconter.
Cette femme étant engagée, en art comme en politique, la trame en sera inextricablement tissée à celle du monde. À l’instar d’un roman de Dos Passos, les nouvelles nous en parviennent par bribes radiophoniques, le 28 août de chaque année de 1932 à 1963.
 Shirley, souvent seule dans le tableau, est une actrice qui a rejoint le Group Theatre. Elle pense que le quotidien doit alimenter le théâtre et non l’inverse. En miroir de cette mise en scène, Steve (Christoph Bach), son compagnon, photojournaliste qui doit se colleter le réel.
Shirley, souvent seule dans le tableau, est une actrice qui a rejoint le Group Theatre. Elle pense que le quotidien doit alimenter le théâtre et non l’inverse. En miroir de cette mise en scène, Steve (Christoph Bach), son compagnon, photojournaliste qui doit se colleter le réel.
Gustav Deutsch nous invite à une équipée au long cours, trente ans de la vie d’une femme dans l’espace même des œuvres. Grande dépression, chômage, Seconde Guerre mondiale, maccarthysme et trahisons, architectures des plans, géométries des couleurs, le cinéaste n’est pas iconoclaste. Il affirme son propos en se gardant de l’effraction.
Son récit poétique s’ancre dans des contextes d’époques et l’inventivité, d’être déployée d’une main sûre qui use d’audace technologique, ne brise pas pour autant les cadres. Le plan fixe de la toile s’anime des mouvements de caméra.
Le montage permet une articulation inédite à laquelle aucune salle de musée ne pourrait se prêter. La musique de chaque temps adresse ses signes propres. Blues de la grande dépression, Fréhel, Big Mama Thornton ou Joan Baez chantant les droits civiques. Vision de la réalité ou ombres projetées ainsi qu’aux parois de la caverne de Platon, nul besoin de trancher.
Ne restera au fond que l’unique vérité, celle du grand soleil de Van Gogh ou d’Apollinaire. Et trois petites notes de musique
Dominique Widemann, l'Humanité : http://www.humanite.fr/ceci-nest-pas-un-tableau-dedward-h...
09:20 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hopper, film, shirley, peinture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
22/09/2013
LE MAJORDOME, LE FILM !
 « Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l’amour le peut »
« Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l’amour le peut »
Martin Luther King
Allez voir le Majordome, comme je viens de le faire. Pour les combats qui ont été menés et ceux qui restent à mener. Pour tous ceux qui se sont levés pour dire non et qui, souvent en sont morts et pour tous ceux qui sont debout encore aujourd’hui.
Et surtout pour ne pas oublier que racisme, homophobie, discrimination,…sont des maux d’aujourd’hui !!!
N’oublions pas que la bête brune, noire ou marine ne se cache plus. Sa bile nauséabonde se répand au détour de chaque geste de notre quotidien. Restons vigilants, pour ne pas nous réveiller un matin dans un monde dont nous ne voudrions pas !
LE FILM
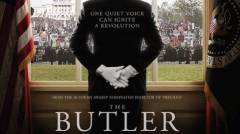 Date de sortie . 11 septembre 2013, (2h 10min) Réalisé par Lee Daniels
Date de sortie . 11 septembre 2013, (2h 10min) Réalisé par Lee Daniels
Avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Mariah Carey
Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui permettent d’atteindre une fonction très convoitée : majordome de la Maison-Blanche. C'est là que Cecil devient, durant sept présidences, un témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale.
À la maison, sa femme, Gloria, élève leurs deux fils, et la famille jouit d'une existence confortable grâce au poste de Cecil. Pourtant, son engagement suscite des tensions dans son couple : Gloria s'éloigne de lui et les disputes avec l'un de ses fils, particulièrement anticonformiste, sont incessantes.
À travers le regard de Cecil Gaines, le film retrace l'évolution de la vie politique américaine et des relations entre communautés. De l'assassinat du président Kennedy et de Martin Luther King au mouvement des "Black Panthers", de la guerre du Vietnam au scandale du Watergate, Cecil vit ces événements de l'intérieur, mais aussi en père de famille…
10:40 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Cinéma, Point de vue, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le majordome, pigaglio, homophobie, discrimination, racisme, film |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 













