07/11/2017
Éric Vuillard : « Ce qu’on appelle fiction participe à la structure de notre savoir »
 Le lauréat du Goncourt est Eric Vuillard pour son livre L'Ordre du jour, publié par Actes Sud. Le journal l'Humanité avait réalisé un entretien avec l'auteur le 05 mai 2017.
Le lauréat du Goncourt est Eric Vuillard pour son livre L'Ordre du jour, publié par Actes Sud. Le journal l'Humanité avait réalisé un entretien avec l'auteur le 05 mai 2017.
Son dernier livre traite d’un épisode de l’installation des nazis au pouvoir et de l’Anschluss qui s’ensuivit. Il tient que toute narration est un montage et, à partir d’exemples illustres, il analyse sous tous les angles la différence entre la description du monde et la pensée de l’auteur.
À l’occasion de la publication de l’Ordre du jour, le romancier nous parle ici, au fil d’une passionnante conversation d’atelier, de sa conception de la littérature et des rapports qu’elle entretient avec l’histoire.
Ce dernier roman, l’Ordre du jour, comme 14 Juillet, qui traitait en détail de figures du peuple en ce jour entre tous fondateur, et comme Congo, dont le sujet était la conférence de Berlin en 1885 où fut décidé le découpage de l’Afrique au profit des puissances coloniales, s’attache à suivre pas à pas quelques-unes des journées capitales allant du 20 février 1933, quand les capitaines d’industrie allemands passèrent à la caisse en faveur des nazis, à mars 1938. Pourquoi avoir privilégié ces dates ?
Éric Vuillard Dès que l’on raconte un épisode de l’histoire, le temps n’est plus une unité de mesure et toute narration est un montage. Il n’y a pas de récit linéaire. L’Ordre du jour raconte un épisode de l’installation des nazis au pouvoir, puis l’Anschluss, un de leurs premiers succès. Domine une impression pénible de petites combines et de mauvais coups. Cela permet de défaire le mythe : non seulement les événements ne sont pas inexorables, mais les plus grands crimes peuvent résulter des manœuvres les plus grossières. Ainsi, le livre parle de la guerre, mais sans la raconter. Il s’appuie sur ce que le lecteur sait pour chercher autre chose. Si l’on raconte l’avant-guerre, puis que l’on s’engouffre dans un récit détaillé du conflit et de ses horreurs, une fois parvenu à la fin, on a perdu de vue les manœuvres de couloir. En revanche, lorsqu’on passe des minables combines qui émaillèrent l’établissement des nazis au pouvoir, aux juifs qui après guerre demandèrent réparation, cela met côte à côte les causes et le résultat, ce qui n’est pas indifférent.
L’ensemble de vos livres témoignent d’une étourdissante connaissance historique. Comment peut s’insinuer, dans ce considérable corpus de documents dûment digérés, la part qui revient à la fiction proprement dite ?
Éric Vuillard Dans mes livres, je n’invente rien, je m’en tiens aux faits. Bien sûr, j’incarne les protagonistes, je leur prête des pensées, parfois des sentiments. Mais rien qui mène au-delà des faits. C’est là ma part de fiction, au sens restreint du terme. Je sais que Ribbentrop était intarissable durant son déjeuner d’adieu à Downing Street, afin de prolonger le repas et de retarder le moment où Chamberlain réagirait à l’invasion de l’Autriche. J’imagine alors une conversation mondaine et je le fais parler longuement de Bill Tilden, un célèbre joueur de tennis. En revanche, lorsque je rapporte que Ribbentrop était le locataire de Chamberlain, c’est un fait, et qui donne à réfléchir. Mais, en un sens plus vif, ce qu’on appelle fiction participe à la structure même de notre savoir. La connaissance n’est pas le traitement de données brutes et la fiction s’insinue déjà dans la lecture elle-même. En lisant, mon esprit est sans cesse aimanté par tel ou tel détail, un mot, une phrase, une description, une idée. Cette mosaïque est le fond réel de notre pensée. Dès le départ, dès que l’on trie les documents, comme l’écrivait Döblin : « Les grandes manœuvres commencent. » C’est que la connaissance ne consiste pas à déchiffrer des données, mais à produire un discours. L’un des versants de cette opération est le montage. On ordonne des événements, on établit des correspondances entre les faits, et tout cela compose une intrigue. C’est là, je crois, que la fiction s’enracine.
Notre rapport à la vérité se fonde sur un matériau hétérogène, notre pensée s’appuie pas à pas sur une phrase qui nous a marqués, une image, la conclusion d’un livre… C’est le lien entre tout ça qui est l’élément dynamique de la connaissance, et on l’apparente à la fiction. Pour le dire autrement, davantage que le fait d’incarner un épisode de l’histoire, c’est surtout la structure de mes livres qui relève de la fiction : lorsque je place côte à côte les suicides survenus à Vienne juste avant l’Anschluss et la conférence de Munich, je livre à la fois des faits et un discours. La fiction est ce qui fait tenir les deux ensemble.
Est-ce que Michelet, par exemple, peut être un modèle dont vous vous réclamez, dans la mesure où chez lui le style, joint à un parti pris historique fort, en a fait, pour ainsi dire, un grand écrivain d’histoire.
Éric Vuillard Même si l’heure des grandes synthèses est morte, j’ai beaucoup de plaisir à lire Michelet. Son écriture est puissante, une conception le guide, il l’affirme avec force ; et puis il y a son côté délirant, le Michelet de Barthes. Celui qui avait des migraines historiques !
Plus largement, peut-on vous demander quelques noms d’écrivains qui vous paraissent avoir déjà illustré le type de littérature qui est le vôtre ? Le Tolstoï de Guerre et Paix, pourquoi pas, quant à la méthode historique…
Éric Vuillard Lorsque, à propos de la réalisation du Dictateur, Chaplin déclare : « L’histoire est plus grande que le petit vagabond », il nous signale un point critique pour toute création. Avec la montée du fascisme, le personnage de Charlot ne suffisait plus. Il ne permettait pas de mettre en scène une réponse aux horreurs que le fascisme annonçait. Pour les mêmes raisons, j’aime la Vie de Galilée, de Brecht. La pièce a été écrite au gré des circonstances. Brecht y travailla longtemps, la reprit, à mesure que la science moderne le mit au défi de penser autrement. Les bombes atomiques américaines tombées sur le Japon furent à l’origine d’un changement de point de vue. Son œuvre est prise dans une conjoncture ; sa pensée est inscrite dans le temps. Cette attitude de Brecht me touche. C’est aussi ce qu’a fait Tolstoï avec Guerre et Paix. Dans sa première version, les dialogues des aristocrates sont souvent en français, et les descriptions sont ponctuées de longues digressions métaphysiques. Dans une version plus tardive, Tolstoï traduit les dialogues en russe et sabre la métaphysique. Cela tient à son évolution politique. Le livre doit pouvoir être lu par le grand nombre, il ne saurait être le privilège de quelques-uns. Sans quoi les conditions de lecture du livre reproduiraient les conditions sociales qu’il dénonce. Mais il y a parfois mieux que la tradition romanesque. L’Établi, de Robert Linhart, est un récit de première grandeur. Il y raconte son séjour en usine. Sa description du travail arrache au lecteur les dernières illusions qu’il avait sur le salariat. Et puis il y a deux tendances inverses. D’un côté, il y a le naturalisme, le réalisme, l’enquête préludant à l’écriture. De l’autre, il y a James Agee, la prose toute saturée de sa présence. Il faudrait parvenir à ne jamais évacuer le sujet, à ne jamais faire croire au lecteur qu’il est seul, que l’auteur n’est pas là. Mais il faudrait aussi retrouver le monde par l’autre bout, par la réalité extérieure, en investiguant. Car ce qui nous entoure ne peut être seulement imaginé, et nous ne pouvons jamais être soustraits du monde.
De fait, dans l’Ordre du jour, vous dressez le constat argumenté de la prise de pouvoir effective du nazisme grâce à l’accord bienveillant du grand capital allemand… N’est-ce pas là une interprétation marxiste ?
Éric Vuillard Mes livres expriment une défiance marquée à l’égard de ce qu’on appelait jadis le capital. Il existe une permanence du monde des affaires, une stabilité de ses intérêts. Certaines personnes morales sont désormais plus anciennes que des États, et parfois plus puissantes. Que les grands industriels allemands aient participé à l’installation des nazis au pouvoir me semble relever des faits. Ce sont les eaux glacées du calcul égoïste dont parle Marx.
Est-ce qu’au fond de votre projet ne se trouve pas un désir d’éduquer par le roman, en une période où ce genre, dûment affadi dans les petites aventures de chacun, évite volontiers d’agiter ce qu’on nommait jadis les grands problèmes ?
Éric Vuillard Il existe une tension interne, coextensive à l’histoire du roman, entre une description fidèle du monde et la pensée de l’auteur. D’une certaine manière, avec Madame Bovary, Flaubert a cru résoudre le problème : il se tient au plus près de quelques existences, au cœur d’un monde social finement décrit ; la cruauté incorporée à sa description faisant office de thèse sur la valeur de l’humanité, elle se donne pour un effet de réel, une libre conclusion du lecteur sur le monde. Le point de vue de l’auteur étant informulé, il se confond avec l’atmosphère du roman, il ne fait plus qu’un avec le style. Ainsi, la distance de Flaubert est la dimension essentielle de son message. Dans la vie de tous les jours, l’idéologie fonctionne exactement de la même manière. Elle est partout, et on ne la voit jamais.
Il existe une autre conception, une façon de ne pas dissoudre le problème, de ne pas l’effacer. Zola est en réalité plus féroce que Flaubert, c’est même ce qui agace. Avec Nana, par exemple, il souhaite raconter l’histoire de « toute une société se ruant sur le cul » ; l’affrontement est direct et il n’épargne pas les responsables, à travers le vieux Muffat de Beuville. La fille de Gervaise élève seule son fils Louis, né d’un père inconnu. Elle fait des passes pour arrondir ses fins de mois, puis devient cocotte, et confie son fils en garde. Quelques centaines de pages plus tard, elle meurt à vingt et un ans de la petite vérole. Je crois qu’en un temps où les chances de vivre comme on le souhaite sont très inégalement distribuées, il est important de trouver dans l’écriture de quoi traiter ce que vous nommez justement « les grands problèmes ». Pour la question de l’éducation, j’hésite. En tout cas, je ne m’insurge pas à l’idée d’une littérature didactique. Un trait assez symptomatique de notre temps est que l’art y répugnerait unanimement, cela doit retenir notre attention et nous rendre méfiant. On réclame des écrivains qu’ils se produisent, qu’ils participent à des ateliers, à des rencontres. En revanche, leurs textes ne devraient surtout pas être didactiques. La contradiction est curieuse et mérite d’être relevée. Et puis en dernière instance, c’est moi que j’éduque.
Combien de temps dans votre vie peuvent prendre l’élaboration puis la composition de vos romans ?
Éric Vuillard Le plus important est l’élaboration au long cours ; comme tout le monde, je lis des livres sur les sujets que je veux mieux comprendre. Ce n’est pas de la documentation, seulement de la lecture. Une fois que le désir d’écrire est là, il faut effectuer des recherches plus précises. Je les mène souvent de front avec l’écriture, pour ne pas perdre mon élan. Parfois, cela peut interrompre le travail ; il me faut aller en bibliothèque, aux archives… Cela peut prendre des semaines. Il arrive aussi que je cale, que le livre m’échappe. Il n’y a pas de règle, certains livres viennent très vite, j’ai écrit Congo en quelques jours. Mais d’autres fois je m’ensable, et je reprends le texte plus tard, quand les choses se dénouent. C’est d’ailleurs ce que l’écriture a de plus étonnant, les livres se répondent. On perd le fil, on oublie ses brouillons, le temps passe, et voici qu’un autre texte apporte la solution du premier.
Pour parler d’aujourd’hui, quelle journée vous semble-t-elle décisive dans les moments politiques que nous traversons et qui ne sont pas encore visiblement de l’ordre historique mais du quotidien angoissant ?
Éric Vuillard Il me semble que ce n’est pas tant une journée qu’un ensemble de dispositions contradictoires. D’un côté, les ralliements autour de l’un des candidats, censé être sorti de nulle part, sont tellement unanimes que cela a quelque chose de troublant. De l’autre, l’extrême droite incarnant la protection des salariés, il y a de quoi être étonné. Nous devons faire face à deux fables.
Ce livre, dans une forme originale qui n’exclut ni l’esprit didactique, ni l’incursion d’un « je » perplexe, s’ouvre donc sur la réunion secrète au Reichstag, le 20 février 1933 – en présence d’Hitler et de Goering –, quand 24 grands noms de l’industrie allemande (Bayer, Agfa, Krupp, IG Farben, Opel, Siemens, Allianz, Telefunken, etc.) passent à la caisse pour aider le parti nazi à faire campagne. « Ils sont, dit l’auteur, nos voitures, nos machines à laver, nos produits d’entretien, nos radios-réveils, l’assurance de notre monde. » C’est ensuite une foule de péripéties sur l’invasion de l’Autriche. Il est aussi question du procès de Nuremberg. Le tout fourmille de faits vrais, d’anecdotes parlantes, de portraits à l’eau-forte. Éric Vuillard explore sans peur ce que la grande histoire cache sous le tapis, avec une verve féroce, en rappelant que « les plus grandes catastrophes s’avancent souvent à petits pas ». M. S.
17:15 Publié dans Actualités, Entretiens, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eric vuillard, prix goncourt, l'ordre du jour |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
19/09/2017
Nathalie Peyrebonne Éloge du déraillement
Après une enfance passée au Costa Rica, Nathalie Peyrebonne grandit en banlieue parisienne. Elle a été élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Elle est actuellement maître de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle.
Spécialiste de l'Espagne du Siècle d'or (XVIe – XVIIe siècles), ses travaux sur la littérature de l'époque sont en lien avec une étude des sociabilités classiques, et notamment des sociabilités alimentaires (le boire et le manger).
Elle est aussi journaliste littéraire pour la revue Délibéré et pour Le Canard enchaîné,
Romans
-
Rêve général, Phébus, 2013 (Libretto, 2014) (Prix Botul 2013)
-
La silhouette, c'est peu, Phébus, 2015.
-
Votre commande a bien été expédiée, Albin Michel, 2017.
REVE GENERAL
Jean-Claude Lebrun, L'Humanité, Jeudi, 4 Avril, 2013
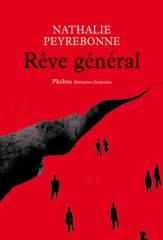 Rêve général, de Nathalie Peyrebonne. Éditions Phébus, 2013, 160 pages, 13 euros, édition Libretto, 7,70 euros
Rêve général, de Nathalie Peyrebonne. Éditions Phébus, 2013, 160 pages, 13 euros, édition Libretto, 7,70 euros
Voici un premier roman joyeux, frais, tonique. Habité par quatre personnages qui sortent de leurs trajectoires et goûtent une liberté nouvelle. Ils s’appellent Louis, Edmond, Céleste et Lucien. Ils sont premier ministre, agent de sécurité dans un bar, conductrice de métro, professeur dans un collège. Et ont en partage de soudain ne plus vouloir jouer le jeu. Comme au tout début du livre, avant qu’eux-mêmes n’entrent en scène, ce footballeur désigné pour tirer un penalty, qui choisit de tourner le dos au ballon et de regagner les vestiaires. Tous, en somme, acteurs d’une manière de révolte douce qui ressemblerait presque à une révolution.
Ce matin du 5 janvier, lendemain inhabituel des vœux du Président (il « n’allait pas écourter ses vacances au soleil pour une allocution télévisée »), Louis a décidé de ne pas sortir de sa chambre à Matignon. Edmond non plus ne se rend pas au travail, il flânera au marché pour assouvir sa passion pour la cuisine. De son côté, Céleste va quitter son poste de conduite, délaisser sa rame à quai et remonter à la surface. Enfin, Lucien plantera en plein cours ses élèves de 4e 3 et partira en balade dans Paris. Un rêve général, qui peut s’entendre aussi comme une grève générale d’un nouveau genre, a pris son essor. Sorte de déraillement délibéré hors des chemins tracés d’avance et des assignations de toutes natures. Tel un refus des règles prétendument naturelles qui régissent nos destinées d’êtres sociaux. L’on suppute en Nathalie Peyrebonne une moderne lectrice de Paul Lafargue et de son Droit à la paresse, paru en 1880. Non pas seulement conteuse des rébellions minuscules, dont les quatre récits peu à peu s’entrecroisent pour composer un véritable roman de l’émancipation, mais critique radicale d’une économie politique et de son idéologie.
Tandis que le Président reprend le vieux refrain des possédants et « s’égosille (...) au boulot, au boulot, au boulot », des êtres renouent sans le savoir avec d’anciennes luttes. Ils partent à la conquête de temps libre, s’arrachent à l’aliénation, montrent qu’il est possible de vivre mieux en travaillant moins. En somme, font revivre la belle idée d’émancipation humaine tant mise à mal par l’ultralibéralisme. « Quelques mythes, quelques rêves, quelques fraternités » retrouvent ici une inespérée vigueur. Car le mouvement rapidement s’élargit, provoquant « comme une grande panne dans le pays ». Un Mai 1968 à la mode contemporaine, sans concertation, sans organisation, sans revendications formulées, sans références historiques. Mais témoignant de la persistance forte d’une aspiration. Nathalie Peyrebonne propose le roman de ce temps inédit, à des années-lumière de la terminologie et des représentations habituelles. Aussi peu conventionnelle que le fut Paul Lafargue à son époque. Un air libertaire souffle ici puissamment.
Le rêve général s’est maintenant installé depuis deux semaines. Plus question de cette rentabilité et de cette efficacité qui tenaient lieu d’uniques caps. On respire, on regarde autour de soi, on se regarde et l’on se parle. Céleste croise ainsi Lucien au moment où, place Vendôme, celui-ci entartre le Président qui porte le prénom de Wolf : ce personnage régressif, porteur de la vieille pensée réactionnaire, ne peut évidemment voir en l’homme qu’un loup pour l’homme. Sous ses allures souriantes, le roman en effet porte loin. Constituant un salutaire précis de rébellion, contre l’idéologie restauratrice plus que jamais à l’œuvre.
13:19 Publié dans Connaissances, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicole peyrebonne, écrivain |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
19/11/2016
Un appel à diffuser les textes d’Asli Erdoğan
Laurence Mauriaucourt, l'Humanite.fr
Les écrivains français Tieri Briet et Ricardo Montserrat commencent à rassembler des textes signés de la romancière emprisonnée à Istanbul. Pour exiger sa libération, ces écrits ont vocation à être diffusés de toutes les manières possibles.
C'est donc la prison à vie qu'ont réclamé, jeudi 10 novembre 2016, les procureurs d'Istanbul contre Aslı Erdoğan ! Et l'emprisonnement d'une romancière jusqu'à sa mort, c'est l'assassinat prémédité d'une littérature qui entend rester libre ! », s’exclament les écrivains français Tieri Briet et Ricardo Montserrat qui diffusent et appellent à diffuser une lettre et des textes de la romancière emprisonnée à Istanbul. « Lisons partout les textes d'Asli Erdogan à voix haute, partageons leur beauté face à un Etat devenu assassin. Jusqu'à la libération d'Aslı Erdoğan ! », lancent-ils. Des textes commencent à être rassemblés et à circuler sur internet. Ils ont vocation à être lus « à diffuser partout dans les théâtres, les librairies, les festivals, les médiathèques... ». Les deux auteurs poursuivent : « Ils appartiennent à tous ceux qui veulent défendre une littérature vivante et impossible à soumettre. Diffusez-les par mail, sur les réseaux sociaux et les blogs, en les affichant sur les murs de nos villes, en les lisant dans les théâtres, les festivals, les Nuit debout, les repas entre amis, partout où vous pourrez ».
Parmi les textes partagés et partageables, cet autoportrait de la jeune femme, tel qu’il avait été lu sur France Inter en septembre 2016 :
« Je suis née à Istanbul en 1967. J'ai grandi à la campagne, dans un climat de tension et de violence. Le sentiment d'oppression est profondément enraciné en moi. L'un de mes souvenirs, c'est à quatre ans et demi, lorsqu'est venu chez nous un camion rempli de soldats en armes. Ma mère pleure. Les soldats emmènent mon père. Ils le relâchent, plusieurs heures après, parce qu'ils recherchaient quelqu'un d'autre. Mon père avait été un dirigeant important du principal syndicat étudiant de gauche. Mes parents ont planté en moi leurs idéaux de gauche, mais ils les ont ensuite abandonnés. Mon père est devenu un homme violent. Aujourd'hui il est nationaliste. J'étais une enfant très solitaire qui n'allait pas facilement vers les autres. Très jeune j'ai commencé à lire, sans avoir l'intention d'en faire mon métier. Je passais des journées entières dans les livres. La littérature a été mon premier asile. J'ai écrit un poème, et une petite histoire que ma grand-mère a envoyés à une revue d'Istanbul. Mes textes ont été publiés, mais ça ne m'a pas plus du tout : j'étais bien trop timide pour pouvoir me réjouir. Plusieurs années plus tard, à 22 ans, j'ai écrit ma première nouvelle, qui m'a valu un prix dans un journal. Je n'ai pas voulu que mon texte soit publié. J'étais alors étudiante en physique. Je suis partie faire des recherches sur les particules de haute énergie au Centre Européen de Recherche Nucléaire de Genève. Je préparais mon diplôme le jour et j'écrivais la nuit. Je buvais et je fumais du haschich pour trouver le sommeil. J'étais terriblement malheureuse. En arrivant à Genève, j'avais pensé naïvement que nous allions discuter d'Einstein, de Higgs et de la formation de l'univers. En fait je me suis retrouvée entourée de gens qui étaient uniquement préoccupés par leur carrière. Nous étions tous considérés comme de potentiels prix Nobel, sur lesquels l'industrie misait des millions de dollars. Nous n'étions pas là pour devenir amis. C'est là que j'ai écrit Le Mandarin miraculeux. Au départ j'ai écrit cette nouvelle pour moi seule, sans l'intention de la faire lire aux autres. Elle a finalement été publiée plusieurs années plus tard. Je suis retournée en Turquie, où j'ai rencontré Sokuna dans un bar reggae. Il faisait partie de la première vague d'immigrés africains en Turquie. Très rapidement je suis tombée amoureuse de lui. Ensemble, nous avons vécu tous les problèmes possibles et imaginables. Perquisitions de la police, racisme ordinaire : on se tenait la main dans la rue, les gens nous crachaient dessus, m'insultaient ou essayaient même de nous frapper. La situation des immigrés était alors terrible. La plupart étaient parqués dans un camp, à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Plusieurs fois, j'ai essayé d'alerter le Haut Commissariat aux Réfugiés de l'ONU sur leur sort. Mais c'était peine perdue. Je ne faisais que nous mettre davantage en danger Sokuna et moi. Puis Sokuna a été impliqué dans une histoire de drogue et il nous a fallu partir. Des amis m'ont trouvé une place dans une équipe de scientifiques au Brésil, qui travaillaient sur ma spécialité. Je pouvais y terminer mon doctorat, mais Sokuna n'a pas pu me suivre. Il a disparu, un an après. Je suis restée seule avec mes remords. Rio n'est pas une ville facile à vivre pour les migrants. J'ai alors décidé de renoncer à la physique pour me consacrer à l'écriture. Mais ce n'est qu'à mon retour en Turquie que j'ai écrit La Ville dont la cape est rouge, dont l'intrigue se passe à Rio. L'héroïne est une étudiante turque, qui se perd dans l'enfer de la ville brésilienne. J'étais étrangère au Brésil, mais aussi étrangère en Turquie. Je ne me sens chez moi que lorsque j'écris. Vingt ans plus tard, aujourd'hui, je me sens toujours comme une sans-abri. J'aime bien Cracovie, je pourrais y rester encore longtemps, mais je sais bien qu'il faut laisser la place à ceux qui attendent un asile. Il faudra bien que je retourne en Turquie. En attendant, chaque jour, je me dis que dans mon pays tout le monde sait bien que je suis devenue l'écrivaine turque la plus populaire. Tout le monde le sait, mais pourtant tout le monde se tait. C'est sans doute cela, aujourd'hui, l'exil le plus terrible ».
18:13 Publié dans Actualités, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : asli erdogan, turquie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
30/08/2016
François Moncla : un livre sur ses récits de vie et d’Ovalie en Béarn
Ancien capitaine du XV de France et de la Section paloise aux engagements extra-sportifs assumés, François Moncla inspire à Olivier Dartigolles une biographie « militante » fidèle aux faits.
J’aurais aimé faire un livre pour mes enfants que j’aurais rédigé sur les pages d’un cahier d’écolier et puis j’ai laissé le temps passer », raconte François Moncla, 84 ans, une référence pour tous les amoureux du rugby mais aussi un citoyen combatif.
Quand Olivier Dartigolles, élu communiste palois, veut écrire les « récits de vie et d’Ovalie » du champion, celui-ci, d’abord perplexe, finit par acquiescer. Les deux militants se connaissent et s’apprécient. D’ailleurs François Moncla ne rejoignit-il pas la liste Front de Gauche aux dernières élections municipales ? Aussi, « je n’ai pas su lui dire non », admet François Moncla qui ne regrette en rien sa décision. « Il n’a rien trahi. C’est bien écrit et il a bien traduit ce que nous nous sommes dit. Pour le faire, il s’est appuyé sur la tournée de l’équipe de France en Afrique du Sud en 1958. C’est une bonne idée », estime l’international de rugby.
« Le sport m’a beaucoup aidé »
A travers cette biographie un soupçon militante, c’est aussi une génération qui rend hommage à son aînée. « Ça fait bizarre car le contexte est tellement différent ! », commente François Moncla qui souhaiterait voir retenus du parcours de vie ses engagements sur le plan sportif et extra-sportif, « mon fil rouge dans tous les sens du terme », affirme-t-il.
Poussé dans ses retranchements, il évoque non sans nostalgie ses longues années au sein d’Edf (1949-1986). « Je suis malheureux quand je vois ce qui se passe. J’ai fait partie de la génération qui a créé l’entreprise. Il y avait tout à faire. C’était une école nationale de métiers qui formait les apprentis et les ouvriers de demain, une entreprise riche et cotée dans le monde entier, avec des techniques partout enviées et copiées. Quand je vois qu’on est en train de tout privatiser, ça m’horripile ! », s’insurge l’enfant de Louvie-Juzon, un cégétiste demeuré fidèle à ses idéaux.
C’est au ballon ovale qu’il doit l’essentiel de sa notoriété. « Le sport m’a beaucoup aidé », convient-il. Fort d’une trentaine de sélections en équipe de France, entre 1956 et 1961, il prit une part prépondérante à la victoire lors des Tournois des Cinq Nations en 1959,1960 et 1961. Capitaine de la Section paloise, il remporta avec son club le titre de champion de France en 1964... après celui décroché en 1959 avec le Racing Club de France. Les tournées en Afrique du Sud, Argentine et Nouvelle-Zélande ont pour lui le goût des aventures pionnières.
Combattant pour la paix
Les succès du sportif de très haut niveau n’ont jamais éclipsé dans ses souvenirsl’Etoile Sportive Arudyenne où il accomplit ses premiers pas. Sa devise (« Le jeu interdit le je ») lui tient lieu d’acte de foi quand il s’investit auprès du PCF pour la paix, le désarmement atomique ou la lutte contre l’apartheid. Face aux convulsions de la société, François Moncla veut, « au crépuscule » de sa vie, croire qu’«’il n’y aura de solutions que dans un développement harmonieux pour les hommes et pour le vivre-ensemble ».
« Il me fallait raconter tout qu’il disait »
 « J’avais sollicité François Moncla lors des élections municipales de 2014 pour la liste Front de Gauche. On avait beaucoup parlé. Je l’avais enregistré. J’ai réécouté les cassettes. Je me suis dit qu’il fallait raconter tout ce qu’il disait. Après l’avoir convaincu, je me suis mis au travail. Je voulais faire quelque chose de plus vif et percutant qui lui ressemble. J’ai terminé mi-juin », explique Olivier Dartigolles, marqué par « les trésors d’humanisme » de son interlocuteur, « un grand capitaine de l’équipe de France », complète-t-il. Après avoir présenté, hier à Pau, l’ouvrage intitulé « François Moncla, récits de vie et d’Ovalie » (1), ils iront ensemble à la rencontre des lecteurs à Agen, Dax, Tarbes et Biarritz où les attendent Philippe Sella, Pierre Albaladejo, Philippe Dintrans et Serge Blanco et aussi à la Fête de l’Humanité (9-11 septembre).
« J’avais sollicité François Moncla lors des élections municipales de 2014 pour la liste Front de Gauche. On avait beaucoup parlé. Je l’avais enregistré. J’ai réécouté les cassettes. Je me suis dit qu’il fallait raconter tout ce qu’il disait. Après l’avoir convaincu, je me suis mis au travail. Je voulais faire quelque chose de plus vif et percutant qui lui ressemble. J’ai terminé mi-juin », explique Olivier Dartigolles, marqué par « les trésors d’humanisme » de son interlocuteur, « un grand capitaine de l’équipe de France », complète-t-il. Après avoir présenté, hier à Pau, l’ouvrage intitulé « François Moncla, récits de vie et d’Ovalie » (1), ils iront ensemble à la rencontre des lecteurs à Agen, Dax, Tarbes et Biarritz où les attendent Philippe Sella, Pierre Albaladejo, Philippe Dintrans et Serge Blanco et aussi à la Fête de l’Humanité (9-11 septembre).
(1) Editions Arcane. 80p. 10€. Contact : 06 70 36 29 73. Adresse : 40, avenue Jean-Mermoz à Pau (mentionner le titre de l’ouvrage). Facebook : https ://m.facebook.com/FMvieetovalie/ Compte twitter : @FMvieetovalie
Article publié par la République des Pyrénees
16:40 Publié dans Livre, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monga, rugby, olivier dartigolles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
22/04/2016
Le frère du Che : « Votre président est socialiste, ah bon ? »
 Un demi-siècle après la mort de Che Guevara, son frère Juan Martin milite pour perpétuer son héritage, et, derrière l’icône, dévoile l’homme dans un livre "Mon frère le Che" (Calmann-Lévy). A l’heure où Cuba se rapproche des USA, où des mouvements de jeunesse secouent l’Europe, le septuagénaire argentin défend encore l’esprit de la « revolucion ». Rencontre.
Un demi-siècle après la mort de Che Guevara, son frère Juan Martin milite pour perpétuer son héritage, et, derrière l’icône, dévoile l’homme dans un livre "Mon frère le Che" (Calmann-Lévy). A l’heure où Cuba se rapproche des USA, où des mouvements de jeunesse secouent l’Europe, le septuagénaire argentin défend encore l’esprit de la « revolucion ». Rencontre.
Pourquoi avoir mis tant de temps à parler publiquement du Che, votre frère aîné de 15 ans ?
Le processus a été long…Au départ, je ne voulais pas parler de mon frère. J’ai commencé à réfléchir après des conférences, la création d’une association, et après avoir rencontré Armelle Vincent ( NDLR : journaliste française qui a co-écrit le livre). Il s’est à la fois passé des choses dans mon for intérieur, et à l’extérieur, dans le monde. Les mouvements sociaux dernièrement à travers le monde m’ont fait réfléchir. C’était le moment de remettre le Che au cœur de la société ! Il y avait aussi la pression des compagnons du Che, ils me poussaient à parler…On me disait, notamment à Cuba, que j’étais égoïste de ne pas vouloir parler du Che.
Etait-il facile de s’attaquer à la fois au mythe et en même temps au grand frère ?
Ce n’est ni une biographie, ni un livre politique. La première chose, c’était de transformer le Che en Ernesto Guevara. Comme il est présenté comme un mythe, il n’aurait pas eu d’enfance, pas de famille, ce serait une statue, un Dieu. Certains ont souvent comparé les deux, beaucoup a été fait pour nuire à leur image, pour manipuler leur histoire et présenter un autre passé, moi je voulais remettre l’authentique contenu dans l’image. Celui du Che, hein, pas du Christ !
« Je ne veux pas que le mythe du Che se convertisse en religion »
Pourquoi l’esprit du Che a-t-il traversé les décennies ?
Il y a plusieurs raisons, mais fondamentalement son combat contre l’injustice, son désir de changer le monde, sa cohérence politique, une vision à long terme, sa vision de la solidarité. Pour lui, l’homme ne naissait pas méchant et destructeur. Les guerres ne sont pas le résultat de la folie des hommes, mais dépendent de la défense de certains intérêts. Il y a une vraie différence avec la religion : elle, parle de l’après, de l’au-delà, l’esprit du Che, c’est le concret, c’est la vie terrestre. Mais je ne veux pas que ce mythe du Che ne se convertisse non plus en religion, il faut le ramener à la terre !
Mais lorsqu’on voit le Che sur les tee-shirts du monde entier, son image dépasse tout ça ?
Moi qui étais commerçant de vins et de cigares havanes, de livres, et même de confiture, je peux dire qu’un commerçant vend ce qui se vend. Et le Che, ça fait vendre ! Celui qui le vend est un commerçant, mais celui qui le porte l’achète pour le symbole. Maradona, Mike Tyson, et Renaud que j’ai rencontré l’autre jour à la télévision française, le portent comme tatouage.
Dans les mouvements actuels, l’esprit du Che est-il présent ?
Le « Che » reste une référence, mais ce ne sont pas ses idées qui sont à la source de ces mouvements. C’est l’injustice, la situation, qui les fait naître. Lui va aider à approfondir les questions politique, économique, sociale. Un peu comme Robespierre avec la Révolution française. Parfois, il y a eu des Révolutions et ils se sont réapproprié l’esprit du Che après, comme chez les Soviétiques. C’est un référent au même titre que Lénine…
« On ne sait plus ce qu’est le socialisme »
Le Cuba de 2016, au moment où il s’ouvre vers les USA, vit-il encore sur les idées du Che ?
Le monde en général ne vit plus sur des principes socialistes aujourd’hui, ce sont les principes capitalistes qui dominent. Il reste quelques endroits rares, où il résiste. Le socialisme est donc dans une position de défense. Les Etats-Unis ont un objectif : transformer Cuba si possible en pays capitaliste. La position des Cubains, elle, est contradictoire : d’un côté, ils veulent continuer à résister, garder leur santé et leur école gratuites, de l’autre ils veulent accéder aux richesses, à la technologie, avoir des écrans plats, des iPods. Ça convient aux deux pays aujourd’hui de se rapprocher. Le système est déjà hybride. Le socialisme ne s’est pas stabilisé, il s’est effondré. On ne sait plus ce qu’est le socialisme. Votre président François Hollande est socialiste ? Ah bon ? Comme ci, comme ça (en français dans le texte). Les bénéfices générés par la production ne reviennent pas en bas, mais en haut, et c’est l’un des problèmes principaux du capitalisme. Sans compter que cette énorme productivité nuit à l’environnement, brise des vies humaines.
Gardez-vous l’âme d’un anti-capitaliste, et l’âme d’un révolutionnaire ?
Oui, définitivement, celle d’un anti-capitaliste. Le capitalisme ne fonctionne pas, produit une société injuste qui ne peut durer comme ça, on doit trouver une alternative qui rétablisse l’équilibre. Le socialisme soviétique ne marche pas, le communisme chinois non plus, les nouvelles générations doivent trouver une nouvelle voie. Quelle révolution peut-on encore espérer ? La Française ? La Russe ? Celle de Mao ? Elles ont toutes eu à se confronter au pouvoir avec plus ou moins de succès.
« Je n’ai pas vécu dans l'ombre du Che, il a plutôt été une lumière pour moi »
Des révolutions sont-elles encore possibles aujourd’hui ?
Ce système n’est pas possible pour une révolution. Mais le système tel qu’il existe aujourd’hui n’est plus bon. Même si je me dis marxiste, on ne peut appliquer aujourd’hui ce que Marx disait en 1948. Pareil pour la pensée léniniste. Il y a un cheminement à trouver qui peut passer par une révolution ! Mais ce n’est pas un seul pays qui peut aller dans cette voie-là, c’est l’humanité toute entière, car on a tous les mêmes intérêts aujourd’hui.
Si le Che vivait encore aujourd’hui…
…L’Amérique latine serait libre ! Moi, je ne suis pas le même qu’à l’âge de 20 ans, et le Che ne le serait pas non plus. Le Che était par exemple en désaccord avec Fidel sur le rapprochement avec l’Union soviétique. Il pensait que l’Union soviétique utilisait en fait les armes du capitalisme. Comme les pays communistes pensaient qu’ils allaient triompher du capitalisme, ils attendaient que ce système de l’ouest s’effondre. Ces derniers ne devaient pas emprunter ni l’un, ni l’autre, ou attendent qu’ils s’effondrent, mais choisir une troisième voie.
A-t-il été difficile pour vous de vivre dans l’ombre du Che ?
Non, ça n’a pas été une ombre, ça a été une lumière ! Pas seulement comme frère, mais comme référent, comme modèle. Et j’espère qu’il le restera pour les générations futures. Mais les éléments ne sont pas réunis aujourd’hui pour qu’on trouve un nouveau Che, ou une nouvelle Chea !
« Mon frère le Che » (éditions Calmann-Lévy) par Juan Martin Guevara avec Armelle Vincent
11:52 Publié dans Actualités, Connaissances, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : mon frère le che, cuba |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 













