29/08/2017
Le capitalisme est incompatible avec la survie de la planète
Humanite.fr, Jean-Jacques Régibier
(1) Colloque au Parlement européen, 27 mars 2017, Bruxelles publiées dans les Proceedings of the Natural Academy of Science ( PNAS )(3) publié en juillet par l’Agence américaine océanique et atmosphérique ( NOAA ) et L’American Meteorological Society ( AMS ),(4) Le Global Foodprint Network, Oakland ( Californie )(5) Daniel Tanuro, « L’impossible capitalisme vert », La Découverte.
10:35 Publié dans Actualités, Connaissances, Economie, International, Planète, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : planète, capitalisme, surive |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
09/10/2013
Domenico Losurdo « Le libéralisme, ennemi le plus acharné du droit à vivre à l’abri »
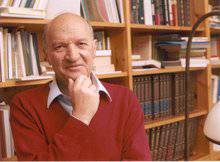 Philosophe, historien et militant communiste, l’Italien Domenico Losurdo travaille depuis plusieurs années sur l’histoire du libéralisme afin de repenser un processus d’émancipation.
Philosophe, historien et militant communiste, l’Italien Domenico Losurdo travaille depuis plusieurs années sur l’histoire du libéralisme afin de repenser un processus d’émancipation.
« En tant que communiste, mais pas seulement, en tant que philosophe et historien, je vais combattre, continuer à combattre l’idéologie dominante. Parce que l’idéologie dominante, c’est une manipulation de l’histoire qui est un obstacle au processus d’émancipation. Et de l’autre côté, nous devons repenser le processus d’émancipation » lançait Domenico Losurdo, en 2007, au village du livre de la Fête de l’Humanité, invité pour la première fois par la Fondation Gabriel-Péri.
Professeur à l’université d’Urbino, en Italie, Domenico Losurdo est spécialiste des philosophes Hegel, auquel il consacre deux livres traduits en français (Hegel et les libéraux, PUF, Paris, 1992 et Hegel et la catastrophe allemande, Albin Michel, Paris, 1994), et Gramsci (Gramsci. Du libéralisme au communisme critique, Syllepse, Paris, 2006). Losurdo n’est pas un intellectuel médiatique mais un intellectuel fondamental pour penser le libéralisme, le communisme et son combat émancipateur.
Après s’être consacré à l’histoire politique de la philosophie classique allemande de Kant à Marx en passant par Heidegger et Nietzsche, il a ensuite travaillé sur l’histoire politique du libéralisme (Contre-histoire du libéralisme, la Découverte. 2013). Il a aussi, notamment, écrit (ouvrages parus en français) le Révisionnisme en histoire (Albin Michel, Paris, 2006), le Péché originel du XXe siècle (Aden, 2007), Fuir l’Histoire (Éditions Delga et Le Temps des cerises, 2007) et Staline : histoire et critique d’une légende noire (Aden, 2011).
Dans votre livre Contre-histoire du libéralisme (1), vous déconstruisez l’idéologie néolibérale en tant que synonyme de démocratie et de défense des libertés en opposition aux totalitarismes… Pourquoi vous a-t-il semblé urgent, aujourd’hui, d’analyser et de dénoncer cette approche du libéralisme ?
Domenico Losurdo. Pour promouvoir son expansion, tout empire a besoin d’un mythe généalogique, mythe qui célèbre et transfigure ses origines et son histoire et qui ainsi invite les adversaires déclarés ou potentiels à s’incliner devant une force morale et politique supérieure.
Selon la légende savamment cultivée par l’Empire romain, Rome avait une origine non seulement royale mais aussi divine : au terme d’un parcours épique, elle aurait été fondée par le pieux Enée, qui avait fui Troie en flammes et qui était le fils d’Anchise (cousin du roi de Troie) et de la déesse Vénus.
Le mythe généalogique de l’actuel empire américain n’est guère différent : fuyant l’Europe intolérante et despotique, les pères pèlerins auraient rejoint le Nouveau Monde pour ériger un monument éternel à la liberté puis pour fonder les États-Unis, la démocratie la plus ancienne qui ait jamais existé…
Mon livre montre au contraire une histoire complètement différente : les colonies anglaises en Amérique puis les États-Unis ont vu s’affirmer la forme la plus radicale d’esclavage et la plus totale déshumanisation de l’esclave ; dans les premières décennies de vie du pays nouvellement fondé, ce sont presque toujours des propriétaires d’esclaves qui ont occupé le poste de président, et ils ont cherché à bloquer l’émancipation des esclaves de Saint-Domingue et Haïti, ils ont exporté l’esclavage au Texas, arraché au Mexique, etc.
C’est une histoire qui a duré longtemps. Il suffit de rappeler que, dans les années 1930, la persécution des Noirs dans le sud des États-Unis faisait penser – comme l’écrivent des chercheurs états-uniens notables – à la persécution contre les juifs en acte dans le IIIe Reich. Sans parler de l’extermination des Peaux-Rouges et des pratiques génocidaires qui ont caractérisé le colonialisme occidental dans son ensemble.
En quoi justement, au cours de l’histoire, l’idéologie libérale légitime-t-elle des formes de domination ? Selon vos termes, le libéralisme est une démocratie uniquement valable pour le « peuple des seigneurs »…
Domenico Losurdo. Aujourd’hui, la situation est différente. Le cycle qui va de la révolution jacobine à la révolution bolchevique a remis radicalement en question l’oppression coloniale et celle aux dépens des peuples d’origine coloniale. Néanmoins… de nos jours, on parle souvent d’Israël comme de la seule vraie démocratie au Moyen-Orient.
Le revers de la médaille est cependant que les Palestiniens peuvent être arrêtés, torturés, soumis à des exécutions extrajudiciaires, sans procès. C’est vraiment la « démocratie pour le peuple des seigneurs » ! Au niveau planétaire, l’Occident s’attribue le droit souverain de déclencher des guerres même sans l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU ; souvent, les présidents états-uniens définissent leur pays comme la « nation élue » de Dieu ayant pour mission de guider le monde : la « démocratie pour le peuple des seigneurs » a toujours de beaux jours devant elle.
Il faut ajouter que le libéralisme ignore le lien entre économie et politique, dont étaient conscients des philosophes comme Rousseau et Hegel. Ce dernier, en particulier, a bien montré que celui qui risque de mourir de faim est en réalité soumis à une condition semblable à celle de l’esclave.
Certains se plaisent à faire l’amalgame entre nazisme et communisme, sous le couvert des totalitarismes… Comment analysez-vous ce concept de totalitarisme ?
Domenico Losurdo. Le « totalitarisme » plonge ses racines dans la « mobilisation totale » et dans la « guerre totale », dans l’enrégimentement total de la population provoqué par les grandes puissances capitalistes et par leur compétition pour la conquête des colonies et l’hégémonie mondiale. Hitler aspirait à la revanche, à la récupération et à l’élargissement de « l’espace vital » et colonial de l’Allemagne.
Il s’est voulu l’héritier de la tradition coloniale, pour la radicaliser, en se réclamant en premier lieu de l’exemple des États-Unis, en cherchant son Far West en Europe orientale et en réduisant les Slaves à la condition d’esclaves au service de la « race des seigneurs ».
Ce n’est pas un hasard si ce projet a connu sa défaite décisive à Stalingrad et si cette défaite constitue en même temps le début d’une gigantesque vague de révolutions anticoloniales. Pour se rendre compte du caractère arbitraire de l’approche de l’idéologie dominante, on peut faire une comparaison. Au début du XIXe siècle, Napoléon envoie une puissante armée à Saint-Domingue, avec pour tâche de rétablir l’esclavage, après son abolition grâce à la grande révolution noire menée par Toussaint Louverture.
On peut bien dire que, dans la guerre qui a fait rage, les agressés n’ont pas été moins « sauvages » que les agresseurs, mais l’on se couvrirait de ridicule en voulant assimiler les uns et les autres sous la catégorie de « sauvagerie » ou de « totalitarisme » sanguinaire.
Dans votre dernier livre, la Lotta di classe. Una storia politica e filosofica (la Lutte de classe. Une histoire politique et philosophique) (2), qui n’est pas encore paru en France, vous vous intéressez au concept de luttes de classes, central dans la philosophie de Marx et Engels. En quoi peut-il nous permettre de mieux analyser, comprendre et agir dans la société ?
Domenico Losurdo. Pour Marx et Engels, la lutte des classes a pour objet la division du travail au niveau international, au niveau national et dans le cadre de la famille. Les peuples qui secouent le joug colonial, les classes subalternes qui luttent contre l’exploitation capitaliste et les femmes qui refusent « l’esclavage domestique » auquel les soumet la famille patriarcale sont les acteurs des luttes des classes émancipatrices.
À la lumière de cela, les guerres de libération et de résistance nationale menées par le peuple chinois et par le peuple soviétique respectivement contre l’empire du Soleil-Levant et contre le IIIe Reich qui voulaient les assujettir, voire les réduire en esclavage, sont de grandioses luttes de classes. Et de nos jours, la lutte des pays et des peuples (pensons en particulier à la Chine) qui veulent en finir avec le monopole occidental de la haute technologie et qui refusent d’être cantonnés dans des segments inférieurs du marché international du travail, doit être considérée elle aussi comme une lutte des classes.
En tant que philosophe et historien communiste, vous dites que l’idéologie dominante est une manipulation de l’histoire et constitue un obstacle au processus d’émancipation. Comment repenser ce processus d’émancipation aujourd’hui ? Selon vous, qu’est devenue la perspective communiste en Europe et dans le monde ?
Domenico Losurdo. Il faut s’engager sur les trois fronts de la lutte des classes. Je voudrais en particulier attirer l’attention sur un point souvent négligé. Non seulement l’on n’est pas socialiste, mais l’on n’est pas non plus démocrate si l’on ne mène pas une lutte pour la démocratie dans les rapports internationaux. La prétention d’un groupe de pays à se présenter comme des nations élues ayant le droit de déclencher des guerres ou de menacer de guerre sans l’autorisation du Conseil de sécurité de l’ONU est une manifestation de colonialisme ou de néocolonialisme, et doit être contestée jusqu’au bout.
En ce qui concerne la perspective stratégique, devons-nous nous représenter le communisme comme la disparition totale non seulement des antagonismes de classes, mais également de l’État et du pouvoir politique, sans parler des religions, des nations, de la division du travail, du marché, de toute source possible de conflit ?
En remettant en question le mythe de l’extinction de l’État et de sa réabsorption dans la société civile, Gramsci a fait remarquer que la société civile elle-même est une forme d’État. Il a également souligné que l’internationalisme n’a rien à voir avec la méconnaissance des identités nationales, qui continuent à subsister bien après l’effondrement du capitalisme. Quant au marché, Gramsci pense qu’il vaudrait mieux parler de « marché déterminé » plutôt que de marché dans l’abstraction. Gramsci nous aide à dépasser le messianisme qui nuit gravement à la construction de la société postcapitaliste.
Quelle est votre analyse du modèle chinois, qui mélange l’économie de marché et la perspective socialiste ?
Domenico Losurdo. La République populaire chinoise est issue de la plus grande révolution anticoloniale de l’histoire, et une révolution anticoloniale réussit réellement si elle ajoute à la conquête de l’indépendance politique la conquête de l’indépendance économique. Sur ce plan, il y a une continuité entre Mao Tsé-toung et Deng Xiaoping.
Ce dernier a introduit le nouveau cours à partir de deux considérations. D’abord, l’appel à l’esprit de sacrifice des révolutionnaires et donc le recours aux incitations morales ne peuvent réussir que dans les moments d’enthousiasme politique particulier ; dans la longue période, il est impossible de développer les forces productives (et de combattre la misère) sans incitations économiques et donc sans compétition et sans marché.
Ensuite, au moment de la crise puis de l’effondrement de l’URSS, l’Occident détenait de fait le monopole de la haute technologie, et il était impossible pour la Chine d’accéder à cette haute technologie sans s’ouvrir au marché international. Grâce également aux conquêtes réalisées dès l’époque maoïste (diffusion massive de l’instruction, éradication des maladies infectieuses, etc.), le nouveau cours, malgré des contradictions criantes, peut se vanter d’un succès incroyable : 600 millions ou, selon d’autres calculs, 660 millions de personnes libérées de la misère ; des infrastructures dignes du « premier monde » ; extension du processus d’industrialisation des aires côtières à celles de l’intérieur ; augmentation rapide, depuis quelques années, des salaires et attention croissante envers la question écologique.
En insistant sur la centralité de la conquête, de la sauvegarde de l’indépendance et de la souveraineté nationale, et en poussant les anciennes colonies à conquérir leur indépendance également sur le plan économique, la Chine est aujourd’hui, de fait, le centre de la révolution anticoloniale (qui a commencé au XXe siècle et est encore en cours sous des formes nouvelles aujourd’hui). En rappelant le rôle central de la sphère publique dans l’économie, la Chine constitue une alternative également par rapport au « consensus de Washington » et au libéralisme économique.
Face aux politiques d’austérité en Europe, comment concevez-vous les alternatives et les formes de processus d’émancipation ?
Domenico Losurdo. Les luttes contre le démantèlement de l’État social et contre la politique belliciste ne peuvent pas ne pas jouer un rôle central. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, à côté des libertés traditionnelles de la tradition libérale, le démocrate F. D. Roosevelt a théorisé également le droit à vivre « à l’abri du besoin » (freedom from want) et « à l’abri de la peur » (freedom from fear). Le libéralisme économique du « consensus de Washington » est l’ennemi le plus acharné du droit à vivre « à l’abri du besoin ». Pour ce qui concerne le droit à vivre « à l’abri de la peur », il est nié tous les jours par la politique de guerre, de menaces de guerre et de recours aux drones d’Obama.
(1) Contre-histoire du libéralisme, Éditions la Découverte.
(2) La Lotta di classe. Una storia politica e filosofica, Éditions Laterza, Italie.
Entretien réalisé par Anna Musso pour l'Humanité
Domenico Losurdo, ‘Liberalism; the fiercest enemy to our right to live free from want’.
Translated Wednesday 11 September 2013, by Julian Jones
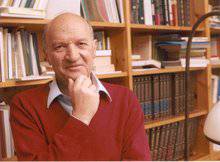 Italian philosopher, historian and militant communist, Domenico Losurdo has been working for several years on the history of liberalism in order to rethink the process of emancipation.
Italian philosopher, historian and militant communist, Domenico Losurdo has been working for several years on the history of liberalism in order to rethink the process of emancipation.
‘As a communist, but not exclusively, and as a philosopher and historian, I aim to continue combatting the dominant ideology of our time. This is because the dominant ideology is a manipulation of history, an obstacle to the process of emancipation. By the same measure, we must also rethink our fight for emancipation’, proclaimed Domenico Losurdo in 2007 at the Fete de l’humanité book fair, to which he was invited for the first time by the Gabriel-Péri Foundation. Professor at the university of Urbino in Italy, Domenico Losurdo is a specialist in the philosophy of Hegel, having written two books on the subject translated into French (Hegel and the liberals, PUF, Paris, 1992 and Hegel and the German Catastrophe, Albin Michel, Paris, 1994), as well as another on Gramsci (Gramsci. From Liberalism to Critical Communism, Syllepse, Paris, 2006).
Losurdo is no media intellectual, but a fundamentally important academic on the subject of liberalism, its relationship with communism and its emancipatory fight. Having devoted himself to a political history of classical German philosophy from Kant to Marx, passing through Heidegger and Nietzsche, he has since worked on a political history of liberalism (Liberalism: A Counter-History, la Découverte, 2003). He has notably also written several more works, of which the ones published in French include ’Revisionism in History’ ( Albin Michel 2006), ‘The Original 20th Century Sin’ (Aden, 2007), ’A Flight from History’ (Delga, 2007), and ‘Stalin: A History and Critique of a Dark Legend’ (Aden 2011).
In your book ‘Liberalism: A Counter-History’ [1], you deconstruct neo-liberal ideology and the way it is equated with democracy and liberty in opposition to ‘totalitarianism’. Why did it seem to you an urgent task to analyse and denounce this approach to liberalism?
Domenico Losurdo. In order to promote its expansion, each empire needs a genealogical myth which celebrates and transfigures its origins and history, and which invites its enemies (or potential enemies) to bow down to a moral force and to a political superiority. According to the legend wisely created by the Roman Empire, Rome had not only royal, but divine origins too: according to its epic history Rome was founded by the pious Aeneas who had left Troy in flames and was son of the goddess Venus and of Anchises - cousin of the King of Troy.
The genealogical myth of the modern US empire hardly differs: having fled an intolerant and despotic Europe, the founding fathers joined the New World in order to erect an eternal monument to liberty in the shape of the United States, supposedly the oldest living democracy... My book on the contrary shows a completely different history: English colonies in America followed by the United States saw the formation of the most extreme form of slavery and a total dehumanisation of slaves.
In the first few decades of life on the newly founded country, it was almost always slave owners who occupied the post of President, and they sought to block the emancipation of slaves in Saint-Domingo and in Haiti, as well as exporting slavery to Texas and annexing Mexico, amongst other crimes. It’s a shameful history which lasted a long time. It suffises to recount (as many notable US scholars do) how in the 1930s, the persecution of blacks in the south of the USA was comparable to the persecution of Jews under the Third Reich. All this without mentioning the extermination of Red Indians and the genocidal practices which characterised western colonialism in its entirety.
In which ways exactly has liberal ideology legitimised different forms of oppression throughout history? In your own terms, liberalism is a democracy fit only for ‘the ruling class’...
D.L. These days the situation is different. The cycle which started with the Jacobin revolution and ended with the Bolshevik Revolution radically put to the fore the question of colonial oppression at the expense of peoples of colonial origin. Nevertheless, Israel is talked about as the only ‘real’ democracy in the Middle East. The other side of the coin is that Palestinians can be arrested, tortured, and subjected to extra-judicial executions without trial. It really is a ‘democracy fit for the ruling class’!
On a global level, the west assigns itself the sovereign right to start wars without even the sole permission of the UN Security Council; US Presidents often self-define their country as ‘God’s chosen nation’, with a right to guide the world. This ‘democracy fit for the ruling class’ unfortunately seems to have a rosy future.
It must be added that liberalism ignores the link between economics and politics, of which philosophers such as Hegel and Rousseau were well aware. Hegel, in particular, showed us how someone who is at risk of dying of starvation is in reality subject to a social status comparable to that of a slave.
Some people take a great pleasure from making the comparison between nazism annd communism... How would you analyse this concept of totalitarianism?
D.L. Totalitarianism has it’s roots in theories of ‘total mobilisation’ and ‘total war’, in an enlistment of the whole population as provoked by the great capitalist powers and their competition for the conquest of colonies and global hegemony. Hitler aspired to avenge Germany, to recuperate and enlarge its ‘living (and colonial) space’.
He believed himself to be the inheritor of a colonial tradition, wanting to radicalise it, invoking primarily the example of the USA, and seeking to establish his ‘Far West’ in eastern Europe and reducing Slavonic people to a condition of slaves serving the ‘master race’. It’s no coincidence that this project came to its decisive defeat at Stalingrad, and that this same defeat constituted the start of a gigantic wave of anti-colonial revolutions.
To demonstrate the wholly arbitrary character of the dominant ideology we can make the following comparison: at the start of the 19th Century, Napoleon sent a powerful army to Saint Domingo with the aim of re-establishing slavery following its abolition by to the great black revolution led by Toussaint Louverture. Here we can safely say that in the subsequent horrendous war, the attacked weren’t anymore ‘savage’ than the aggressors, but it would seem ridiculous to accuse one side or the other of being under the category of ‘savagery’ or bloody ‘totalitarianism’.
In your latest book, ‘La Lotta di classe. Una storia politica e filosofica’ (Class Warfare, A Political History and Philosophy) [2], not yet published in French, you focus on a concept which is central to the philosophy of Marx and Engels - class warfare. In which ways can this concept help us to analyse, understand and act within our society?
D.L. According to Marx and Engels, class warfare has as its aim the division of work at an international level, at a national level and in the institution of the family. It is the people who upset the colonial order; the subaltern classes who fight against capitalist exploitation and the women who refuse to be ‘domestic slaves’ to which the patriarchal family submits them to who are on the frontline the struggle of the emancipatory classes.
In light of this, the wars of liberation and national resistance led by the Chinese people and the Soviet peoples against the Empire of the Rising Sun and the Third Reich respectively, which wanted to subjugate or even reduce them to slaves, can be considered as spectacular victories of class-warfare. What’s more, the struggle of countries and of peoples who want to see an end to the western monopolisation of high technology (let’s think of China, in particular) and who refuse to be confined to inferior segments of the international work market, should also be considered as class warfare.
As a philosopher and as a communist historian, you affirm that the dominant ideology is a manipulation of history and that it constitutes an obstacle to the fight for emancipation. How do we re-think this fight for emancipation today? In your view, what has become the communist perspective in Europe and in the rest of the world?
D.L. It is necessary to engage on the three main pillars of class warfare. I’d like to draw attention to a point which is often ignored. Not only is it impossible to be a socialist but it is impossible to be a democrat if we don’t fight for democracy with regard to international relations.
The claim by a small group of countries to present themselves as chosen nations with the right to start wars or even threaten to start wars without the authorisation from the UN Security Council is a manifestation of colonialism or of neo-colonialism, and ought to be contested all the way. As regards a strategic perspective, should we represent communism as the complete abolition not only of class antagonisms, but also of the state and of political power, without mentioning religion, nations, division of labour, markets, and of every possible source of conflict? By re-examining the myth of the abolition of the state, Gramsci remarked that civil society was in itself a type of state.
He also underlined the fact that internationalism has nothing to do with the misunderstanding of national identities, as such identities would remain well after the collapse of capitalism. As for the market, Gramsci thought that it be wiser to talk about a ‘determined market’, rather than the market as an abstract form. Gramsci helps us to think beyond the messianism which could gravely harm the construction of a post-capitalist state.
What is your analysis of the Chinese model of society, which mixes a market economy with a socialist perspective?
D.L. The People’s Republic of China originates from the biggest anti-colonial revolution of our history, and an anti-colonial revolution can only be said to truly succeed if it can add a successful economic independence to its political independence. In this respect, there is a continuity between Mao Tse-Tung and Deng Xiaoping.
The latter introduced his new plan on the basis of two main considerations. Firstly, he believed that a call to the revolutionary spirit of sacrifice can only succeed in moments of particular political enthusiasm; in the long term it is impossible to develop the productive forces (and so combat misery) without economic incentives, and therefore without competition and without markets. On top of this, during times of crises and following the collapse of the USSR, the west held the monopoly over high technology, and as such it was impossible for China to access this high technology without opening itself up to international markets.
Thanks also to the achievements orchestrated by the Maoist era (with its massive promotion of education, eradication of infectious diseases, etc.), the new plan, despite its blatant contradictions can boast an incredible success: 600 million people or 660 million people (according to other estimates) liberated from misery, infrastructures worthy of a first world economy, growth in the process of industrialisation from its coast areas to its inland areas, rapid incrementation of salaries for several years and a growing concern for environmental issues.
By focusing on the key role of the achievement in the safekeeping of independence and of national sovereignty, and by encouraging the old colonies to pursue their own economic independence, China can today be seen as the centre of the anti-colonial revolution -which began in the 20th Century and is still in process under its different guises to this day. And by reminding ourselves of the pivotal role the public sphere should play in any economy, China constitutes an alternative in opposition to the economic liberalism and to the consensus dictated by Washington.
In view of the austerity measures taking place in Europe, how do you conceive the alternatives and the ways in which we can achieve emancipation?
D.L. The struggles against the dismantlement of the welfare state and against bellicist politics can only play a central role. During the Second World War the Democrat F.D. Roosevelt theorised the right to live with ‘freedom from want’ and ‘freedom from fear’, alongside the traditional liberties granted by a liberal tradition. The economic liberalism of the consensus in Washington is the fiercest enemy to our right to live free from want. As for the right to live free from fear, this is denied to us on a daily basis by warmongering politics, threats of war and Obama’s method of resorting to drones.
[1] Contre-histoire du libéralisme, Éditions la Découverte, 2013, Liberalism: A Counter-History , Verso Publisher, 2011.
[2] La Lotta di classe. Una storia politica e filosofica, Éditions Laterza, Italie, 2013.
11:38 Publié dans Article en Anglais, Article in English, Connaissances, Entretiens, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : communisme, haïti, onu, histoire, allemagne, etats-unis, femmes, résistance, chine, entretien, capitalisme, urss, domenico losurdo, libéralisme, deng xiaoping, toussaint louverture, séries d'été, penser un monde nouveau, mao tsé-toung |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
30/07/2013
Slavoj Zizek : "Le mariage éternel entre capitalisme et démocratie est fini"
 Les séries d'été de l'Humanité : Penser un monde nouveau . Entretien avec Slavoj Zizek, philosophe et psychanalyste slovène. Selon lui, la période historique
du capitalisme touche à sa fin. Il ne faut
pas s’interdire d’utiliser le mot communisme comme horizon de nos espoirs.
Les séries d'été de l'Humanité : Penser un monde nouveau . Entretien avec Slavoj Zizek, philosophe et psychanalyste slovène. Selon lui, la période historique
du capitalisme touche à sa fin. Il ne faut
pas s’interdire d’utiliser le mot communisme comme horizon de nos espoirs.
Formé notamment en France, c’est à Ljubljana, ville qui l’a vu naître en 1949, qu’il s’est installé pour réaliser ses recherches. C’est également dans cette ville que le plus iconoclaste des Slovènes rédige, lorsqu’il n’est pas sollicité à travers le monde, la plupart de ses essais, traduits dans une vingtaine de langues. Son œuvre, polymorphe, puise aussi bien dans Lacan, Hegel que Marx – pensées dont il considère que leur combinaison nous donne une grille de lecture indépassable des antagonismes qui travaillent la société – pour s’attaquer aux réalités contemporaines qui font durablement problème : la mondialisation, le capitalisme, le couple liberté-servitude, le politiquement correct, le marxisme, le postmodernisme, la démocratie, l’écologie… Personnalité que ses détracteurs (de droite comme de gauche) présentent volontiers comme truculente, incontrôlable, Zizek est surtout un penseur qui ne s’accommode pas des conventions et des modes intellectuelles. Ses constructions conceptuelles sont enracinées dans un marxisme « vivant » (reprenant ici les mots bien trouvés de Sartre), une passion lacanienne et un tropisme hégélien. Cette construction réside pour partie dans les digressions qu’il s’autorise pour approcher au plus près les tensions du réel, ses nœuds et sa complexité.
Vous écrivez dans votre dernier essai que « les prises de pouvoir d’État ont misérablement échoué » et vous considérez que « la gauche devra se vouer à la transformation directe de la texture même de la vie sociale ». Ces deux mouvements ne peuvent-ils pas être imbriqués ?
Slavoj Zizek. J’ai de grands conflits avec plusieurs de mes amis, notamment d’Amérique latine, qui considèrent que la prise du pouvoir ne doit plus être à l’ordre du jour, qu’il faudrait abandonner le paradigme bolchevik ou « jacobin » (autrement dit, une prise de pouvoir directe d’État) au profit des bouleversements à opérer au sein des communautés locales. Il y a même l’illusion que l’État disparaîtrait de lui-même. Ma position est tout autre. On doit rester marxiste. L’antagonisme social de base ne se situe pas au niveau du pouvoir, de la gouvernance, c’est l’antagonisme économique qui exprime le plus directement le paradoxe du capitalisme. La solution ne réside pas dans un mouvement de résistance envers l’État. Ce n’est pas le grand ennemi. Il est faux de croire que le salut consiste à se tenir à distance de l’État, le capital est déjà à distance de l’État ! L’ennemi, pour moi, c’est cette société dans son fonctionnement actuel et la domination économique qu’elle met en œuvre.
C’est donc davantage la fonction attribuée à l’État qui vous questionne, plutôt que l’opposition hypothétique entre la société civile et l’État ?
Slavoj Zizek. Se priver d’État peut laisser place aux pires dérives. Un théoricien des lois légaliste de gauche m’a raconté qu’il a regardé aux États-Unis toutes les cartes où il y a un conflit entre la société civile et l’État. Le mouvement civil néoconservateur revendique que l’État ne se mêle pas des affaires civiles. Les groupes réactionnaires sont ainsi parvenus à bannir l’homosexualité dans les écoles, pour ne parler que de cela. Y compris aux États-Unis, c’est l’État qui défend quelques libertés fondamentales contre les pressions locales ou civiles néoconservatrices.
Vous entendez par là que la société civile n’est pas nécessairement mue de bonnes intentions, à vocation universaliste… Qu’une des fonctions de l’État peut être de contenir, voire d’outrepasser les dogmatismes autoritaires ?
Slavoj Zizek. Oui, on ne doit pas oublier tous les mouvements fascistes… Aujourd’hui, le grand mouvement antimigrants né du patriotisme est un fait de la société civile. Le conflit le plus radical n’est pas entre les dominés et l’État, c’est un conflit économique qui peut être dominé par l’État. Garder une distance vis-à-vis de l’État cela veut dire qu’on laisse la gestion de l’État à l’adversaire. C’est vrai que, dans la forme même d’État, une domination est inscrite. Cela ne doit pas nous empêcher de considérer qu’on peut faire beaucoup de choses avec. L’instrument est ambigu, il peut être dangereux, mais il peut aussi être un instrument de la transformation sociale.
Vous semblez parfois sceptique vis-à-vis des grandes mobilisations de masse. Pensez-vous que ces « groupes en fusion », pour reprendre l’expression de Sartre, sont incapables de transformer radicalement le cours des choses ?
Slavoj Zizek. Les récents mouvements de masse dont nous avons été spectateurs, aussi bien ceux de la place Tahrir qu’à Athènes… ressemblent pour moi à une extase pathétique. Ce qui m’importe le plus, c’est le jour d’après, le matin qui vient. Ces événements m’évoquent la sensation qu’on éprouve lorsqu’on se réveille avec un mauvais mal de tête après une soirée d’ivresse. La difficulté majeure réside dans ce moment crucial, où les choses retournent à leur état normal, quand la vie quotidienne repart.
Si certaines promesses de révolution ont été confisquées, ne participent-elles pas à faire l’histoire, à la précipiter du moins ?
Slavoj Zizek. Oui, mais que va-t-il rester du grand événement ? Le succès de ces grands mouvements extatiques doit être évalué sur la base de ce qu’il en reste une fois qu’ils sont passés. Sinon nous sommes dans ce romantisme soixante-huitard. L’après, c’est cela qui m’intéresse. L’unique problème est de savoir ce qu’on fait concrètement aujourd’hui ? C’est pourquoi j’ai admiré l’efficacité d’Hugo Chavez. On parle d’auto-mobilisation continue des masses, moi je ne veux pas vivre dans une société dans laquelle je suis obligé d’être mobilisé politiquement en permanence. Nous avons de plus en plus besoin de grands projets sociaux, avec des effets concrets et durables.
Vous juxtaposez au malaise du capitalisme un malaise écologique. Quel est ce « malaise dans la nature » dont vous traitez longuement dans Pour défendre les causes perdues ?
 Slavoj Zizek. Je n’aime pas la mythologie du mouvement écologiste qui porte l’idée d’un équilibre naturel qui aurait été ruiné par l’impérialisme humain ou déstabilisé par l’exploitation de la nature. Je préfère le darwinisme de gauche dont la thèse est que la nature n’existe pas comme un ordre homéostatique, cette mère nourricière dont la balance a été perturbée par la main de l’homme. Il faudrait la rétablir, y retourner. Je pense au contraire que la nature est folle, faite de catastrophes naturelles, c’est un grand chaos. Cela ne veut absolument pas dire qu’il ne faille pas se faire de soucis, la situation est au contraire éminemment inquiétante. Mais il faut sortir de la moralisation écologique et son homéostasie. La théologie dans sa forme traditionnelle ne peut plus remplir sa fonction fondamentale qui est de poser des limites fixes. La référence à Dieu ne fonctionne pas, or la référence à la nature commence à remplir ce lieu. Je n’ai pas de grandes réponses positives mais un premier réflexe utile serait de refuser le « way of life » écologique. Cela individualise le souci écologique, comme en attestent les injonctions au recyclage. Comme si cela suffisait à accomplir son devoir ! Cela ne fait qu’aboutir à une culpabilisation permanente. Je me soucie plus de savoir comment on s’organise pour prévenir les futurs mouvements de population liés à l’immigration et au réchauffement climatique ? La réponse à cette question m’importe plus que les bavardages autour du tri sélectif.
Slavoj Zizek. Je n’aime pas la mythologie du mouvement écologiste qui porte l’idée d’un équilibre naturel qui aurait été ruiné par l’impérialisme humain ou déstabilisé par l’exploitation de la nature. Je préfère le darwinisme de gauche dont la thèse est que la nature n’existe pas comme un ordre homéostatique, cette mère nourricière dont la balance a été perturbée par la main de l’homme. Il faudrait la rétablir, y retourner. Je pense au contraire que la nature est folle, faite de catastrophes naturelles, c’est un grand chaos. Cela ne veut absolument pas dire qu’il ne faille pas se faire de soucis, la situation est au contraire éminemment inquiétante. Mais il faut sortir de la moralisation écologique et son homéostasie. La théologie dans sa forme traditionnelle ne peut plus remplir sa fonction fondamentale qui est de poser des limites fixes. La référence à Dieu ne fonctionne pas, or la référence à la nature commence à remplir ce lieu. Je n’ai pas de grandes réponses positives mais un premier réflexe utile serait de refuser le « way of life » écologique. Cela individualise le souci écologique, comme en attestent les injonctions au recyclage. Comme si cela suffisait à accomplir son devoir ! Cela ne fait qu’aboutir à une culpabilisation permanente. Je me soucie plus de savoir comment on s’organise pour prévenir les futurs mouvements de population liés à l’immigration et au réchauffement climatique ? La réponse à cette question m’importe plus que les bavardages autour du tri sélectif.
La question démocratique, précisément, ne cesse de vous travailler. En vous appuyant aussi bien sur Platon qu’Heidegger, vous en démontrez le caractère souvent illusoire et fumeux. Est-ce l’occasion de penser son renouvellement, ou prônez-vous l’abandon pur et simple de cette idée ?
Slavoj Zizek. Tout dépend de ce qu’on entend par démocratie. La démocratie telle qu’elle fonctionne est de plus en plus remise en cause. C’est une des grandes leçons du mouvement Occupy Wall Street. Même si cette contestation s’est dissipée, il y avait deux intuitions correctes. Premièrement, c’était une mobilisation basée contre « one issue mouvement » : la dénonciation d’un problème concret, le fait qu’il y a quelque chose qui cloche dans le système économique actuel. Deuxièmement, ce mouvement a démontré que notre système politique existant n’est pas assez fort pour lutter efficacement contre ces dérèglements économiques. Or si on laisse le système mondial continuer de se développer ainsi, je m’attends au pire : à de nouveaux apartheids, de nouvelles formes de divisions. Je crois que le mariage éternel entre capitalisme et démocratie est fini. Il n’a plus que quelques années à tenir.
Qu’est-ce qui pourrait alors remplacer cette « coquille vide » ?
Slavoj Zizek. Nous avons affaire à une démocratie vidée de signification. Mais je ne suis pas pour abandonner brutalement cette idée. Il y a des situations précises où je peux être pro-démocratique. En ce sens, je ne suis pas pour le rejet systématique des élections. Parfois elles peuvent être heureuses, voyez la Commune de Paris, ou imaginez une victoire de Syriza en Grèce. Ce serait un bel événement démocratique. Mais il y a bien un malaise démocratique à dépasser, souvenons-nous du choc qui a soulevé l’Europe quand Papandréou a proposé un référendum. Les choix électoraux sont régulièrement manipulés de diverses manières, mais il peut arriver que nous puissions faire des choix démocratiques véritables. Je ne suis donc pas a priori contre cette idée.
Vous dénoncez une Europe dénuée de toute « passion idéologique ». Quel est ce mal qui fait, selon vous, qu’elle n’est pas désirable dans sa forme actuelle ?
Slavoj Zizek. Il y a trois Europe. L’Europe technocratique n’est pas a priori mauvaise. Mais quand elle n’est que cela, c’est une unité de façade qui se donne seulement les moyens matériels de sa survie. L’Europe du populisme xénophobe est violemment antimigrants. Le plus grand danger réside pour moi dans sa troisième forme, qui est la superposition d’un technocratisme économique (pourtant multiculturel et libéral à la base) et d’un patriotisme idiot. L’Italie de Berlusconi en est un sinistre exemple. Pour autant, je trouve que nous avons tort, en tant qu’Européens, de nous auto-flageller en permanence. Il faut savoir défendre et s’enorgueillir de ce qui fonde l’Europe : ses valeurs enracinées dans l’égalitarisme, le féminisme, la démocratisation radicale. Les grands mouvements anticoloniaux ont été d’inspiration européenne. Notre seule chance est d’insuffler une autre idée de l’Europe.
Vous prônez donc un nouveau volontarisme politique européen ?
Slavoj Zizek. La logique immanente de l’histoire n’est pas de notre côté. Si on la laisse incliner vers sa tendance naturelle, l’histoire continuera d’aller vers l’autoritarisme réactionnaire. En cela les analyses de Marx doivent être notre point de départ. Il faut poursuivre cette ligne tout en s’intéressant à d’autres questions, soulevées par exemple par les autonomistes italiens, dont Maurizio Lazzarato, qui défend l’idée que, dans l’idéologie quotidienne, notre servitude nous est présentée comme notre liberté. Il montre comment nous sommes tous traités comme des capitalistes qui investissons dans notre propre vie. L’endettement remplit une fonction disciplinaire, c’est aujourd’hui une des manières nouvelles de maintenir sous contrôle les individus. Tout en nous donnant l’illusion que cela relève de choix libres. Même la fragilité des parcours professionnels, l’insécurité chronique, nous est présentée comme une chance de pouvoir nous réinventer tous les deux ou trois ans. Et ça fonctionne très bien.
Une série d’intellectuels, dont vous faites partie, défendent l’idée que le communisme n’est pas un concept épuisé. L’idée a-t-elle un avenir en dépit des réductionnismes sauvages dont elle fait encore régulièrement l’objet ?
Slavoj Zizek. L’axiome commun à accepter est que nous continuons à utiliser le mot communisme comme l’horizon de nos espoirs. Les anticommunistes libéraux contemporains n’ont même pas d’appareil conceptuel propre pour réaliser une critique véritable du communisme. La théorie de la tentation totalitaire, qui serait inhérente au communisme, est un psychologisme ridicule, non théorisé. C’est ce qui m’a fait dire un jour à Bernard-Henri Lévy qu’il n’était pas assez anticommuniste. On attend toujours une critique éclairée de la catastrophe stalinienne. Every Day Stalinism (le stalinisme ordinaire) est le seul ouvrage à ma connaissance qui fasse une démonstration intéressante et instruite. C’est un fait historique que des régimes horribles se sont légitimés de Marx, il serait trop facile d’opposer à cette réalité que ce n’était pas là un marxisme authentique. Il faut quand même poser la question : comment cela a-t-il été possible ? Cette question ne doit en revanche certainement pas être un prétexte pour abandonner Marx. C’est la condition préalable pour le répéter autrement : renouveler ce geste en changeant la forme et non les prémisses. Le socialisme ne marche pas, Hitler s’est réclamé socialiste. « Une idée vraie est une idée qui divise », comme le répète mon ami Alain Badiou. Mais les erreurs passées doivent nous rendre plus exigeants.
Parution chez Flammarion des deux derniers essais de Slavoj Zizek : Vivre la fin des temps et Pour défendre les causes perdues.
13:15 Publié dans Actualités, Entretiens, Point de vue, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : communisme, philosophie, entretien, capitalisme, slavoj zizek, séries d'été, penser un monde nouveau |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
12/09/2011
737 maîtres du monde contrôlent 80 % de la valeur des entreprises mondiales
Une étude d’économistes et de statisticiens, publiée en Suisse cet été, met en lumière les interconnexions entre les multinationales mondiales. Et révèle qu’un petit groupe d’acteurs économiques – sociétés financières ou groupes industriels – domine la grande majorité du capital de dizaines de milliers d’entreprises à travers le monde.
LE RÉSEAU DE CONTRÔLE GLOBAL PAR LES GRANDES ENTREPRISES
Stefania Vitali, James B. Glattfelder, et Stefano Battiste
Leur étude, à la frontière de l’économie, de la finance, des mathématiques et de la statistique, fait froid dans le dos. Trois jeunes chercheurs de l’Institut fédéral de technologie de Zurich [1] ont scruté les interactions financières entre multinationales du monde entier. Leur travail – « The network of global corporate control » (le réseau de domination globale des multinationales) – porte sur un panel de 43.000 groupes (« transnational corporations ») sélectionnés dans la liste de l’OCDE. Ils ont mis en lumière les interconnexions financières complexes entre ces « entités » économiques : part du capital détenu, y compris dans les filiales ou les holdings, prise de participation croisée, participation indirecte au capital…
Résultat : 80 % de la valeur de l’ensemble des 43.000 multinationales étudiées est contrôlé par 737 « entités » : des banques, des compagnies d’assurances ou des grands groupes industriels. Le monopole de la possession du capital ne s’arrête pas là. « Par un réseau complexe de prises de participation », 147 multinationales, tout en se contrôlant elles-mêmes entre elles, possèdent 40 % de la valeur économique et financière de toutes les multinationales du monde entier.
Une super entité de 50 grands détenteurs de capitaux
Enfin, au sein de ce groupe de 147 multinationales, 50 grands détenteurs de capital forment ce que les auteurs appellent une « super entité ». On y retrouve principalement des banques : la britannique Barclays en tête, ainsi que les « stars » de Wall Street (JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley…). Mais aussi des assureurs et ds groupes bancaires français : Axa, Natixis, Société générale, le groupe Banque populaire-Caisse d’épargne ou BNP-Paribas. Les principaux clients des hedge fund et autres portefeuilles de placements gérés par ces institutions sont donc, mécaniquement, les maîtres du monde.
Cette concentration pose de sérieuses questions. Pour les auteurs, « un réseau financier densément connecté devient très sensible au risque systémique ». Quelques-uns flanchent parmi cette « super entité », et c’est le monde qui tremble, comme la crise des subprimes l’a prouvé. D’autre part, les auteurs soulèvent le problème des graves conséquences sociales que pose une telle concentration. Qu’une poignée de fonds d’investissement et de détenteurs de capital, situés au cœur de ces interconnexions, décident, via les assemblées générales d’actionnaires ou leur présence au sein des conseils d’administration, d’imposer des restructurations dans les entreprises qu’ils contrôlent… et les effets pourraient être dévastateurs. Enfin, quelle influence pourraient-ils exercer sur les États et les politiques publiques s’ils adoptent une stratégie commune ? La réponse se trouve probablement dans la brûlante actualité des plans d’austérité.
Ivan du Roy
17:41 Publié dans Actualités, Connaissances, Economie, Planète | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : capitalisme, maîtres, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 











