02/11/2013
OMAR : Quand Roméo fait le mur pour retrouver Juliette !
 Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des soldats, il franchit quotidiennement le mur qui le sépare de Nadia, la fille de ses rêves et de ses deux amis d'enfance, Tarek et Amjad. Les trois garçons ont décidé de créer leur propre cellule de résistance et sont prêts à passer à l'action. Leur première opération tourne mal.
Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des soldats, il franchit quotidiennement le mur qui le sépare de Nadia, la fille de ses rêves et de ses deux amis d'enfance, Tarek et Amjad. Les trois garçons ont décidé de créer leur propre cellule de résistance et sont prêts à passer à l'action. Leur première opération tourne mal.
Capturé par l'armée israélienne, Omar est conduit en prison. Relâché contre la promesse d'une trahison, Omar parviendra-t-il malgré tout à rester fidèle à ses amis, à la femme qu'il aime, à sa cause.
LA CRITIQUE DU JOURNAL L'HUMANITE
Un film palestinien remportait tous les suffrages à Cannes dans la section Un certain regard. Les nôtres également ainsi que ceux du jury, qui lui attribuait son prix.Omar, de Hany Abu-Assad. Palestine. 1 h 37.
Certains ont pu avoir en des temps anciens des préjugés vis-à-vis du cinéma palestinien. Un pays pauvre aussi peu étendu même si densément peuplé que la Palestine, en état de guerre permanente de surcroît, ne saurait disposer d’un cinéma conséquent.
C’était oublier que ce pays avait déjà sécrété un très grand maître en la personne d’Elia Suleiman, le réalisateur de Chronique d’une disparition et Intervention divine.
C’était oublier aussi que Suleiman n’est pas unique. En témoigne Hany Abu-Assad, qui nous a déjà régalés une demi-douzaine de fois, en particulier en 2002 avec le Mariage de Rana et, en 2005, avec Paradise Now.
La récidive est au plus haut avec cet Omar, reparti de Cannes avec le prix du jury obtenu dans la section Un certain regard, et qui vient d’être retenu comme le candidat officiel de la Palestine dans la course pour l’oscar du meilleur film étranger.
L’histoire nous a fait penser à la célèbre citation de Samuel Fuller jouant dans Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard : « Un film est un champ de bataille : amour, haine, violence, action, mort, en un mot émotion. »
 Nous ne sommes pas pour autant dans le romantisme anarchisant à la Nicholas Ray propre aux nantis mais dans la réalité presque documentaire de la vie quotidienne dans les territoires occupés. Pourtant, là aussi, on trouve des corps mus par des pulsions, qu’elles proviennent de l’engagement politique ou des pulsions sexuelles, du refuge dans la famille ou de l’investissement dans l’amitié.
Nous ne sommes pas pour autant dans le romantisme anarchisant à la Nicholas Ray propre aux nantis mais dans la réalité presque documentaire de la vie quotidienne dans les territoires occupés. Pourtant, là aussi, on trouve des corps mus par des pulsions, qu’elles proviennent de l’engagement politique ou des pulsions sexuelles, du refuge dans la famille ou de l’investissement dans l’amitié.
Le réalisateur du film, qui est son propre scénariste, semble avoir relu pour l’occasion toutes les grandes tragédies shakespeariennes, à commencer par Roméo et Juliette, mais en leur adjoignant toutes les propriétés du mélodrame, faire advenir au peuple ce qui était auparavant le privilège des princes et des rois. Pourquoi au demeurant les sentiments nobles leur seraient-ils réservés ? Pourquoi le peuple n’aurait-il pas droit à la jalousie, à la haine, à la confiance, à la défiance, à l’amour passion, à la duperie, à la rouerie, à la trahison ?
C’est ce qui dote ce film d’une force émotionnelle sans pareille, l’auteur ayant pris la décision juste de s’appuyer sur une mise en scène discrète quoiqu’en écran large et sur une distribution qu’on ne peut que louer bien que la plupart des jeunes comédiens tutoient la caméra pour la première fois de leur brève existence.
Au résultat, on a rarement aussi bien vu en action la solidarité ici en jeu, ou une guerre des pierres qui ressemble à l’occasion à une guerre des boutons, ou un franchissement de mur qui s’apparente au jeu du chat et de la souris. Pour une fois, les Palestiniens ne se limitent pas à une façade militante aseptisée. Ils sont faits de chair et de sang, de désirs et de contradictions. Grâce en soit rendue au cinéaste.
Un film puissant, plein de sentiments et d'humanité, un film très dur autant parce qu'on continue à y découvrir (et ne pas comprendre) la dureté de l'homme, son coté "obscur", la trahison ... mais aussi très beau parce que l'amitié et l'amour dépassent le reste ! Un film qui devrait tous nous apprendre à grandir ... Écrit par : dhuez
10:24 Publié dans ACTUSe-Vidéos, Cinéma, Connaissances, Histoire, International | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cinéma, palestine, hany abu-assad, omar |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
06/10/2013
"Blue Jasmine", de Woody Allen. N’être personne de s’être trop pris pour quelqu’un
 Blue Jasmine est une réussite de Woody Allen qui, enfin, remet tout son savoir-faire sur le métier pour un portrait de femme, interprété par Cate Blanchett, tout en profondeur.
Blue Jasmine est une réussite de Woody Allen qui, enfin, remet tout son savoir-faire sur le métier pour un portrait de femme, interprété par Cate Blanchett, tout en profondeur.
Blue Jasmine, de Woody Allen. États-Unis. 1 h 38.
Lorsque nous rencontrons Jasmine (Cate Blanchett), c’est une femme désarticulée. D’emblée, ses vêtements élégants semblent autant de vestiges auxquels s’accrocherait la passagère d’un paquebot embarqué sur un radeau en perdition pour s’empêcher de couler.
Cela tient à une façon de les rassembler, de les habiter d’une grâce dont la posture serait soudain devenue incertaine. Jasmine, de son véritable prénom Janette, s’effraie devant la porte de sa sœur Ginger (formidable Sally Hawkins) demeurée dans la modestie populaire de leurs origines. Pareille à une pouliche à pedigree contrainte aux stalles communes, Jasmine, arrivée tout droit de la côte est, déchoit à San Francisco.
Fauchée, égarée, terriblement seule et non moins exigeante comme si sa riche essence l’imposait, Jasmine, rebaptisée d’après un parfum de luxe, dépare dans le décor. Ginger pourtant l’accueille de toute son affection, rayonne de l’admiration toujours portée au joyau de la famille et partage son foyer avec le naturel de qui sait ramer dans les écueils.
À Jasmine, tout a été donné, de la beauté à l’amour qui la récompense, aux inépuisables cascades d’argent dont le prince charmant l’a inondée. Charmant dans ses limites et prince des escrocs, le mari de Jasmine, Hal (Alec Baldwin), a fini par se faire pincer. Bâtisseur d’un empire de cavalerie financière à la manière d’un Madoff, ou de tant d’autres dont on peut trouver les noms ailleurs qu’outre-Atlantique, il s’est pris les pieds dans le tapis persan.
Woody Allen procède à des flash-back fluides comme une robe de haute couture afin de reconstituer cette vie antérieure qu’ont menée Jasmine et son époux. Il ne cesse d’en enrichir les parcours conjoints des deux sœurs au fil de leurs retrouvailles. Il use de son habituelle maîtrise des décalages amusants sans le poids du procédé. Surtout, de ce qui va émerger de chacune, de leurs fantasmes et aspirations, nous permettra de ne pas nous tenir en surface, au contraire de ses derniers opus.
Outre les deux magnifiques actrices et leurs interprétations sensibles, il faudrait citer toute la distribution. Chili (Bobby Cannavale), prolo tatoué à qui Ginger s’est fiancée, capable de fondre en larmes d’amour, Augie (Andrew Dice Clay), son ex-mari tellement balourd que le couple de Jasmine et Hal a bien cru défaillir de honte sociale lorsqu’ils les ont reçus dans leur mille mètres carrés de Manhattan. Jadis. Augie au moins a survécu, outils en main. Jasmine n’en possède aucun.
Cette femme que l’on pourrait si facilement détester pour son snobisme et son arrogance de milliardaire nous apparaît, en un tour de force continu, aussi dépossédée d’elle-même qu’il est possible. Rien n’est univoque dans le traitement du film, ni dans l’interprétation. Woody Allen et Cate Blanchett parviennent à provoquer une oscillation constante qui interdit le rejet comme l’empathie à bas prix. Un film d’or fin.
11:08 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Arts, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, woody allen, cate blanchett |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
22/09/2013
LE MAJORDOME, LE FILM !
 « Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l’amour le peut »
« Les ténèbres ne peuvent pas chasser les ténèbres, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l’amour le peut »
Martin Luther King
Allez voir le Majordome, comme je viens de le faire. Pour les combats qui ont été menés et ceux qui restent à mener. Pour tous ceux qui se sont levés pour dire non et qui, souvent en sont morts et pour tous ceux qui sont debout encore aujourd’hui.
Et surtout pour ne pas oublier que racisme, homophobie, discrimination,…sont des maux d’aujourd’hui !!!
N’oublions pas que la bête brune, noire ou marine ne se cache plus. Sa bile nauséabonde se répand au détour de chaque geste de notre quotidien. Restons vigilants, pour ne pas nous réveiller un matin dans un monde dont nous ne voudrions pas !
LE FILM
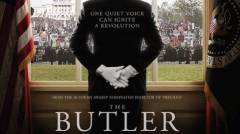 Date de sortie . 11 septembre 2013, (2h 10min) Réalisé par Lee Daniels
Date de sortie . 11 septembre 2013, (2h 10min) Réalisé par Lee Daniels
Avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Mariah Carey
Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui permettent d’atteindre une fonction très convoitée : majordome de la Maison-Blanche. C'est là que Cecil devient, durant sept présidences, un témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale.
À la maison, sa femme, Gloria, élève leurs deux fils, et la famille jouit d'une existence confortable grâce au poste de Cecil. Pourtant, son engagement suscite des tensions dans son couple : Gloria s'éloigne de lui et les disputes avec l'un de ses fils, particulièrement anticonformiste, sont incessantes.
À travers le regard de Cecil Gaines, le film retrace l'évolution de la vie politique américaine et des relations entre communautés. De l'assassinat du président Kennedy et de Martin Luther King au mouvement des "Black Panthers", de la guerre du Vietnam au scandale du Watergate, Cecil vit ces événements de l'intérieur, mais aussi en père de famille…
10:40 Publié dans Actualités, ACTUSe-Vidéos, Cinéma, Point de vue, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le majordome, pigaglio, homophobie, discrimination, racisme, film |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
24/08/2013
LA QUESTION : LE FILM DE LAURENT HEYNEMANN, EST IL INTERDIT DE DIFFUSION SUR LES TELEVISIONS FRANCAISES ?
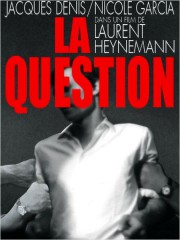 Quelques jours après la disparition de Henri Alleg, auteur du livre La Question, la question se pose toujours pourquoi le film de Laurent Heynemann qui a adapté ce roman à l’écran est il toujours interdit de diffusion sur toutes les chaines de Télévision françaises. Sa dernière diffusion sur la chaine feu, la Cinq, à minuit date de plus de 30 ans. Pourtant ce film qui avait obtenu le grand prix spécial du jury au festival de Saint-Sébastien est estimé de manière unanime par les critiques de cinéma comme étant un très beau film.
Quelques jours après la disparition de Henri Alleg, auteur du livre La Question, la question se pose toujours pourquoi le film de Laurent Heynemann qui a adapté ce roman à l’écran est il toujours interdit de diffusion sur toutes les chaines de Télévision françaises. Sa dernière diffusion sur la chaine feu, la Cinq, à minuit date de plus de 30 ans. Pourtant ce film qui avait obtenu le grand prix spécial du jury au festival de Saint-Sébastien est estimé de manière unanime par les critiques de cinéma comme étant un très beau film.
Peut être les télévisions ne veulent pas déplaire au Front National et à son électorat particulièrement opposés à ce témoignage unique sur la torture pratiquée en Algérie.
François Hollande avait pourtant rendu ainsi hommage le 18 juillet à Henri Alleg en saluant le journaliste militant qui "alerta sur la réalité de la torture en Algérie" et qui "toute sa vie lutta pour que la vérité soit dite". "A travers l'ensemble de son œuvre — jusqu'à son dernier livre, Mémoire algérienne, paru en 2005 —, il s'affirma comme un anticolonialiste ardent."
M. Hollande avait souligné aussi que, "toute sa vie, Henri Alleg lutta pour que la vérité soit dite", en restant "constamment fidèle à ses principes et à ses convictions".
Apparemment en France aujourd’hui toute vérité n’est pas bonne à dire sur les télévisions publiques et privés. La censure comme pendant la guerre d’Algérie est toujours aussi implacable.
LE FILM
La Question film de Laurent Heynemann sorti sur les écrans en 1977, est une adaptation du livre La Question d'Henri Alleg, avec Jacques Denis dans le rôle d'Henri Alleg, Nicole Garcia dans celui de sa femme, et notamment Jean Benguigui. Le film ne reprend pas à l'écran toutes les descriptions terribles d'Alleg mais était sorti avec une interdiction aux moins de 18 ans.
LE THEME
A Alger, en 1957, les paras font régner l'ordre. Henri Charlègue, le directeur d'un journal sympathisant avec le FLN, passe à la clandestinité. Il est arrêté avec son ami Maurice Oudinot. Tous deux subissent des tortures et ce dernier meurt au cours d'un interrogatoire. Tandis qu'il est derrière les barreaux, Charlègue écrit en cachette un récit sur les conditions de sa détention et réussit à le faire parvenir à son éditeur par l'intermédiaire de son avocat. À sa parution, le livre fait scandale. Charlègue est condamné à dix ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'Etat.
13:34 Publié dans Actualités, Cinéma, Film, Histoire, International, Livre, Médias, Société | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : heyneman, la question, henri alleg, censure, télévision |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
07/07/2013
World War Z nous a agréablement étonnés
 World War Z a été projeté en ouverture du 35ème Festival international du film de Moscou. "Le film d'ouverture nous a agréablement étonnés, écrit alors Jean Roy dans l'Humanité.
World War Z a été projeté en ouverture du 35ème Festival international du film de Moscou. "Le film d'ouverture nous a agréablement étonnés, écrit alors Jean Roy dans l'Humanité.
On attend normalement peu où que ce soit d'un tel titre, qui se doit d'être une grosse production consensuelle, une mise en bouche qui ne déplaît à personne, faute de plaire à certains. Ce fut World War Z, de Marc Forster, qu'on pourra voir en France dès le 3 juillet.
Le film affiche sans pudeur son budget estimé à 200 millions de dollars, mais, au moins, ils pètent à l'écran. Pourtant, une mauvaise réputation était née. Le film aurait dû sortir l'hiver dernier, il aurait donc été envoyé en remontage par une Paramount mécontente, etc. C'était sans compter sur le souci de précision de Marc Forster, dont nous avions déjà apprécié, il y a cinq ans, Quantum of Solace, peut-être le meilleur James Bond depuis longtemps. Ici, dans ce film futuriste de zombies où Brad Pitt sauve le monde d'un mal nouveau et inconnu comme on a pu le faire de la peste au Moyen Âge, le réalisateur s'est souvenu de tous les classiques du genre, du terrifiant White Zombie, de Victor Halperin, en 1932, avec Bela Lugosi, jusqu'au non moins prenant la Nuit des morts-vivants, de George Romero, en 1968.
On a sursauté
Le rythme est impeccable, la musique à ne pas rabaisser, l'interprétation sans faille et, surtout, les effets spéciaux en 3D sont saisissants. Cela relève peut-être des émotions que procure un tour de manège à sensations fortes, mais, parfois, on a eu peur et on a sursauté.
10:34 Publié dans ACTUSe-Vidéos, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, marc forster, brad pitt, george romero |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 










