18/07/2014
Cette propagande qui transforme le bourreau en une victime
Hier 25 morts et 200 blessés dont plusieurs handicapés à vie... Dont une famille entière décimée...Qui dira et répétera les noms des enfants tués? Qui leur allumera des bougies en les pleurant? Qui qualifiera ces crimes de terrorisme aveugle?
Par Inès Safi (1)
 Mes chers amis,
Mes chers amis,
Je m'excuse si je ne trouve pas la force d'évoquer des roses et des rossignols ce matin... Gaza est sous les feux.. Certes, l'Irak et la Syrie sont en deuil aussi, formant des terrains minés par des puissances occidentales et les monarchies du golfe qu'elles ont créées dans le passé... Mais l'injustice criante qui perdure en Palestine est une plaie qui saigne depuis des décennies, qui s'infecte et répand ses microbes partout dans le monde...
Je suis frappée par la propagande qui transforme le bourreau en une victime qui se défend... Par les journaux qui décrivent en détail le type de roquettes palestiniennes même quand elles ne font pas de victimes, mais ne s'intéressent guère à la nature des bombardements isaréliens, ni des victimes palestiniennes..
Hier 25 morts et 200 blessés dont plusieurs handicapés à vie... Dont une famille entière décimée...Qui dira et répétera les noms des enfants tués?
Qui leur allumera des bougies en les pleurant?
Qui qualifiera ces crimes de terrorisme aveugle?
Et toi mon compatriote européen, pourquoi si peu de compassion envers l'arabe, que je suis aussi?
Peut être qu'en te rappelant que des palestiniens chrétiens sont aussi des victimes, tu te sentirais plus révolté, comme si la religion devrait nous séparer en clans solidaires?
Peut être que je devrais te montrer des enfants palestiniens blonds ensanglantés afin que tu te sentes touché?
Crois tu vraiment qu'Israel est un prolongement de l'Europe, chose d'ailleurs quasiment officielle, en tout cas pour les contrats européens qui couvrent mon domaine de recherche?
Pourquoi aurais tu froid au dos en entendant "Etat islamique", alors que répéter "Etat Juif" ne te choque guère?
Pourquoi te sens tu agacé devant un drapeau qui porte la shahada, alors que tu te sens familier avec un drapeau récupérant l'étoile de David, symbole universel y compris en islam, que s'approprie un sionisme qui n'a rien de spiriituel?
Bien au contraire, te voici y voir un allié très cher, qui se prétend le rempart des pays civilisés contre les barbares...
Pourquoi acceptes tu que la barbarie meurtrière que tu as causée dans le passé soit payée par des palestiniens qui doivent céder leurs terres, leurs maisons, leurs âmes, leurs enfants?
Réveille ta conscience, mon compatriote, libère toi de ce mépris hérité des croisades.. Rappelle toi qu'au cours de ces croisades les chrétiens arabes de Jerusalem furent massacrés, et ne voyaient guère dans ces croisés barbares, leurs bourreaux, des frères..
Saches que c'est Omar ibn AlKhattab qui avait permis aux familles juives de s'installer à Jerusalem.. Que des juifs arabes ont été ministres (dont l'arrière grand père d'un ami physicien premier mlinistre ottoman), médecins, philosophes, poètes, baignant dans la même culture, et que leur émancipation ou déclin était intimement liés à celui de leurs frères musulmans.. Une culture dont tu as pleinement profité, révolutionnant tes moeurs, te faisant découvrir l'amour courtois et le rafinnement...
Ce n'est pas la religion qui nous divise, c'est la colonisation, tout simplement..
(1) Inès Safi : Née en Tunisie, Inès Safi est diplômée de l’Ecole Polytechnique de Palaiseau et chercheuse CNRS en théorie de la matière condensée, au Laboratoire de physique des solides à Orsay, où elle étudie des système de taille nanométrique.
Reconnue sur le plan international notamment pour son expertise dans les systèmes unidimensionnels, elle s’intéresse aussi, depuis quelques années, aux significations de la mécanique quantique, ainsi qu’aux questions éthiques et environnementales posées par la science.
Elle est invitée à divers colloques et débats sur le thème « science et religion ».
18:55 Publié dans Actualités, Connaissances, Inès Safi, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : inès safi, palestine, point de vue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
13/07/2014
VOUS PRESIDENT ! LETTRE OUVERTE DU PROFESSEUR OBERLIN !
 Face à cette boucherie insoutenable, qui fait recours aux bombes DIME, qui n'épargne même pas les morts dans leurs tombes, ni les handicapés, qui se poursuit en toute impunité dans une prison à ciel ouvert encerclée de toute part, mer terre et air, et qui me concerne non seulement pour la cause humanitaire, mais aussi en tant que citoyenne française trahie par son président, nous partageons cette lettre ouverte (voir video, attention images choquantes) du professeur de médecine Christophe Oberlin:
Face à cette boucherie insoutenable, qui fait recours aux bombes DIME, qui n'épargne même pas les morts dans leurs tombes, ni les handicapés, qui se poursuit en toute impunité dans une prison à ciel ouvert encerclée de toute part, mer terre et air, et qui me concerne non seulement pour la cause humanitaire, mais aussi en tant que citoyenne française trahie par son président, nous partageons cette lettre ouverte (voir video, attention images choquantes) du professeur de médecine Christophe Oberlin:"Vous président, voulez-vous que je vous montre les photos des enfants palestiniens coupés en deux par les bombes israéliennes ?
Vous président, savez-vous qu’un enfant palestinien est tué par Israël chaque trois jours, depuis dix ans ?
Vous président, vous vous inscrivez dans la lignée d’une classe politique détestable : celle qui a fait fonctionner la guillotine pendant la guerre d’Algérie, celle qui a signé pour l’assassinat de Larbi ben Mhidi, celle de l’expédition de Suez, celle qui a donné la bombe atomique à Israël.
Vous président n’avez décidément rien retenu des cours d’histoire et des cours de droit de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.
Vous président, alors qu’Israël agrandit tous les jours son territoire par la force, vous prétendez nier le droit des Palestiniens à résister par la force ?
Vous président, en soutenant un état qui agrandit ses frontières par la force, vous violez la charte des Nations Unies !
Vous président, par la coopération militaire que vous entretenez avec Israël, vous êtes juridiquement complice de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité.
Vous président, alors que les Palestiniens sont majoritaires sur le territoire de la Palestine, en soutenant la minorité vous niez la démocratie !
Vous président, je vous accuse de l’une des pires formes de racisme : le racisme en col blanc !
Vous président, vos déclarations n’engagent que vous, vous êtes la honte de la France !"
18:57 Publié dans Actualités, International, Point de vue, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oberlin, hollande, palestine, gaza |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
11/07/2014
ISRAEL : L'ONU dénonce un "nettoyage ethnique"
L'expert indépendant du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés, l'Américain Richard Falk, a une nouvelle fois dénoncé aujourd'hui la politique d'Israël dans ces territoires, affirmant qu'elle présente les caractéristiques de "l'apartheid" et du "nettoyage Ethnique".
"La réalité sur le terrain s'aggrave aussi bien du point de vue du droit international que du point de vue du peuple palestinien", a-t-il dit aux journalistes à Genève. Il a notamment accusé Israël "d'efforts systématiques et continus pour changer la composition ethnique de Jérusalem Est", de "recours excessif àla force", de "punition collective" à Gaza, de destructions d'habitations et de construire de plus en plus de colonies.
"Il y a une discrimination systématique sur la base de l'identité ethnique, avec l'objectif de changer la démographie de Jérusalem", a-t-il affirmé, appelant cela une forme "de nettoyage ethnique".
Depuis 1996 plus de 11.000 Palestiniens ont perdu leur droit de vivre à Jérusalem, a souligné Falk. "Ce que nous appelons occupation est maintenant de plus en plus compris comme une forme d'annexion, une base pour un apartheid dans le sens où il y a un double système légal discriminatoire", a ajouté Falk.
Le mandat de Richard Falk expire dans quelques jours, après une mission de six ans qui lui a valu de polémiquer vivement et régulièrement avec Israël et ses soutiens, notamment les Etats-Unis et le Canada.
Ce professeur emeritus de l'Université de Princeton, âgé de 82 ans, est lui même juif, ce qui lui permet de balayer toutes les accusations d'antisémitisme dont il a fait souvent l'objet. Il considère que ces attaques visent "à dévier la conversation du message vers le messager".
Il a affirmé que la Cour Internationale de Justice devrait examiner le statut légal de cette occupation prolongée par Israël «l des territoires palestiniens et il a rappelé que cette cour avait en 2004 déclarée illégale la construction de la barrière par Israël isolant ces territoires occupés en 1967, ce qui n'a pas empêché l'Etat hébreu de poursuivre ses travaux.
Photo Ziad, article publié par le Figaro
12:59 Publié dans Actualités, International, Planète, Point de vue, TV E-MOSAIQUE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : palestine, nottoyage ethnique, israël, onu, richard falk |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
29/06/2014
HERVE DI ROSA A LA MAISON ELSA TRIOLET-ARAGON

Pour les visiteurs se sera aussi l'occasion en plus de cette exposition de découvrir la maison des ces deux grands écivains et le magnifique parc qui en entoure cette résidence.
Hervé Di Rosa est l'un des protagonistes de la figuration libre au début des années 80. Plus tard il a inventé l'art modeste.
A une époque où tout est visible dans les journaux, à la télévision ou sur internet, il parcourt le monde pour voir comment les images se font ailleurs.
Son œuvre s'enrichit du savoir des autres et se métisse à la pratique des autres.
Récemment, il a assuré la décoration du hall d'entrée du Centre socio culturel Aimé Césaire à Gennevilliers (fresque murale de 800 m2, sculptures et mobilier réalisé au Cameroun), conçu la décoration du tramway d'Aubagne et réalis l'exposition « Modestes tropiques » au musée Quai Branly.
L'EXPOSITION

Le Classic. Les personnages sont des acteurs de scènes historiques et d'anecdotes littéraires. Ils posent pour le plaisir esthétique qu'ils procurent et les rêveries qu'ils engendrent.

Le Monde grotesque. Pour Di Rosa c'est de la « décoration pure, en perpetuelle négation de l'espace, et décrit un monde suspendu, impossible et peuplé d'êtres hybrides et traçant un monde parallèle ».

Cette exposition permet de voyager à travers ces thèmes et d'apréhender ainsi l'oeuvre riche de Di Rosa. A découvrir et à apprécier,...
Texte, photos, vidéo E-Mosaïque
12:49 Publié dans Actualités, Connaissances, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : di rosa, exposition, maison louis aragon |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
20/06/2014
ECONOMIE : CONDITIONNEMENT ET SCANDALE AU BAC ES
Le Bac est, cette semaine, le sujet à la mode. Il revient ainsi tous les ans, avec ses polémiques (faut-il supprimer le Bac ?), avec ses scandales, réels ou imaginaires. Il y a une bonne raison à cela.
Premier examen universitaire (et c’est pour cela qu’un professeur des universités préside le jury), il conditionne pour de nombreux jeunes la possibilité d’avoir accès aux études supérieures.
L’idée de faire passer le Bac par contrôle continu aurait probablement pour conséquence de conduire les universités à instaurer des concours d’entrée, puis à créer leurs propres filières de préparation à ces concours d’entrée, ouvrant par là même la porte à des abus multiples.
Le formatage par le MEDEF commence au Bac !
On trouve donc de tout dans les sujets du Bac ; parfois des « perles » et même de la propagande. C’est le cas pour les sujets de 2014 dans l’épreuve de sciences économiques et sociales pour la section ES (Sujets: BAC-ES2014). Cette propagande peut être grossière, comme c’est le cas pour les (malheureux) élèves qui auront choisi l’épreuve composée. La première question de cette dernière (valant 6 points) se compose de deux sous-questions :
- Comment la flexibilité du marché du travail peut-elle réduire le chômage ?
- À quels risques économiques peuvent s’exposer les pays qui mènent une politique protectionniste ?
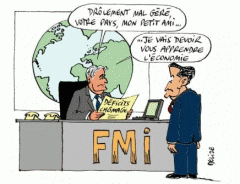 On ne saurait imaginer choix plus tendancieux, et plus erroné du point de vue de la science économique.
On ne saurait imaginer choix plus tendancieux, et plus erroné du point de vue de la science économique.
Commençons par la première sous-question ; il est ainsi implicitement suggéré à l’élève que la « rigidité » du marché du travail peut-être une cause du chômage.
Or, ce que l’on appelle la « rigidité » ce sont des contrats de travail assurant une stabilité et une protection au salarié.
Poussons alors le raisonnement à l’absurde : si la flexibilité du travail permet de réduire le chômage, il nous faut revenir à des contrats journaliers ou hebdomadaires, comme aux premiers jours de la révolution industrielle.
Il n’y avait rien de plus flexible que le marché du travail au début du XIXème siècle.
Pourtant, comme c’est étrange, tous les commentateurs de l’époque s’entendent pour dire qu’il régnait alors un chômage important…
Par ailleurs, si une personne n’a aucune garantie quant à son lendemain, si elle vit dans une insécurité permanente, aura-t-elle la moindre incitation pour s’instruire et développer sa force de travail ?
On oublie trop que l’extrême flexibilité du travail a pour corolaire une productivité extrêmement faible. Inversement, ce sont les industries qui avaient besoin d’un travail qualifié (comme Krupp en Allemagne ou Schneider en France) qui ont, les premières, instauré des mécanismes rigidifiant le marché du travail afin de stabiliser une main d’œuvre avec des caractéristiques spécifiques.
En réalité, la segmentation du marché du travail est issue du développement même du capitalisme. Les gains très importants en productivité du travail que l’on a connu depuis plus de 100 ans dans l’industrie sont le résultat de ces stabilités qui sont aussi, pour ceux qui les combattent, autant de « rigidités ».
Or, ces gains permettent des hausses régulières du salaire réel, qui assurent ainsi les débouchés (la consommation) à la production, et contribuent par là à la baisse du chômage. Il faut ici rappeler que l’introduction du SMIG puis du SMIC a fortement contribué à une croissance rapide dans les années 1960.
Quant à la seconde question, elle passe sous silence le fait qu’il n’y a pas eu un seul pays qui ait réussi à s’industrialiser et à se développer économiquement sans recourir à des méthodes protectionnistes. De la France au Japon, des États-Unis à l’Allemagne, tous les pays ont eu recours au protectionnisme, et ceci a correspondu à leurs périodes de croissance les plus importantes. Dans un papier célèbre[1], le regretté Paul Bairoch et Richard Kozul-Wright ont montré le rôle largement positif des réglementations protectionnistes. ...
Jacques Sapir
15:52 Publié dans Actualités, Cactus, Connaissances, Livre, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bac es, formatage, lavage de cerveau |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 












