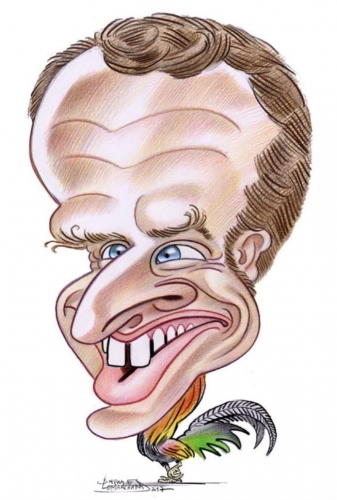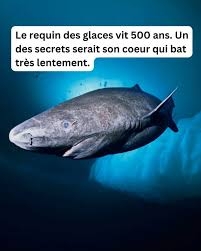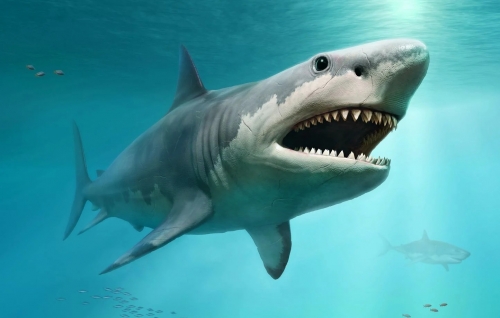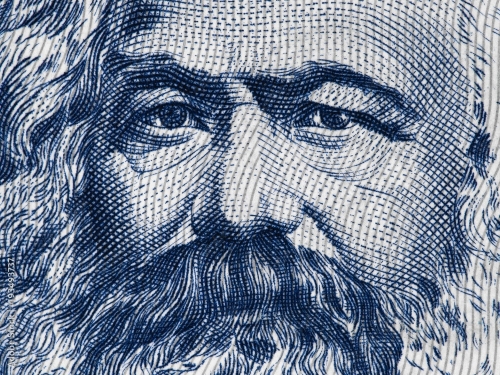Nous sommes il y a tout juste un an, le 6 janvier 2025. Le président de la République française, Emmanuel Macron, s’apprête à donner une allocution devant les ambassadeurs. L’allocution, très attendue par la presse, succède à un climat d’anticipation devenu caractéristique de la communication présidentielle, habituée à ménager ses effets d’annonce et à événementialiser les déclarations officielles. L’allocution du 6 janvier 2025 se présente comme un « exercice rare » pour un Président de la République, dont la presse et les médias se font allègrement l’écho. Il s’agit en réalité de rendez-vous annuels, se tenant au mois d’août de chaque année depuis 1994, lorsqu’ils ont vu le jour à l’initiative d’Alain Juppé.
Depuis 2017 et l’élection d’Emmanuel Macron, il est devenu presque étrange de se rappeler que la conférence des ambassadeurs avait initialement pour ambition de permettre à la diplomatie française de se confronter à un certain « regard nouveau » à porter sur le monde d’après la dissolution de l’URSS et la chute du mur de Berlin. En effet, depuis ces dix dernières années, la diplomatie française observe, quelque peu médusée, le renoncement de la quasi-intégralité de la classe politique française à donner la partition de la politique étrangère de la France.
Grand orchestre de faux-semblants
Après avoir été annulée en 2024 (en raison des JOP), la Conférence des Ambassadeurs bénéficie d’un rebranding de circonstance, changeant de nom (pour inclure le féminin). Elle se tient finalement de nouveau le 6 et 7 janvier 2025, avec le désormais traditionnel discours-fleuve présidentiel (et quelques ateliers thématiques). Elle réunit quelque 200 chefs de mission diplomatique en attente d’une feuille de route.
Au fil d’un discours-fleuve truffé de petites formules, Emmanuel Macron décline un langage où les observateurs peinent à identifier « les linéaments d’une politique étrangère cohérente et structurée autour de quelques priorités claires ». La classe politique — de la droite à la gauche, en passant par toutes les nuances du centre — demeure pourtant toujours aussi sensible à son langage.
Une fois de plus, la communication présidentielle a le sens du timing. L’allocution présidentielle offre à Emmanuel Macron l’occasion de réagir aux tentatives du milliardaire américain Elon Musk de « s’immiscer dans la vie politique européenne » au service de ce que la classe politique française qualifie désormais « d’internationale réactionnaire ». La formule, reprise par le président de la République dans son allocution, a imprégné les discours de la gauche durant toute l’année 2024 (et depuis). On la retrouve au fil des tweets et des déclarations publiques chez Olivier Faure (Parti socialiste), Raphaël Glucksmann (PS-Place publique), ou encore Thomas Portes (France insoumise). On la retrouve jusque dans la communication officielle de la Marche des Fiertés, qui aurait fait l’objet de vifs débats « en interne ».
L’origine de ce bon mot de la communication présidentielle serait à chercher dans les prises de position publiques de Pascal Canfin, candidat sur la liste LREM aux élections européennes de 2019, derrière Nathalie Loiseau. Ce qui s’exprime, à travers cette formule, le 6 janvier 2025 dans l’allocution présidentielle, c’est bien « la voix autorisée » du gouvernement et du chef de la diplomatie française sur le positionnement de la France dans le monde.
La diplomatie française au rendez-vous du « monde d’après »
Dans un billet de blog consacré à cette Conférence 2.0, un ancien diplomate et haut fonctionnaire français évoque avec amertume les excès du langage présidentiel, avec son goût de « la formule choc, au détriment du raisonnement structuré ».
Il déplore également l’absence de « discussions libres sur les sujets sensibles » et un certain « conformisme de la pensée ambiante », un discours présidentiel « sans priorités claires, manquant de profondeur stratégique, de clairvoyance » allant de pair avec « le choix de la diplomatie des apparences, de la diplomatie de “l’esbroufe” ». Les voix de la diplomatie française s’élèvent désormais dans la presse, pour souligner le « peu d’égards » avec lequel le Président de la République semble traiter les quelques 200 diplomates aguerris auxquels il semble « faire la leçon ».
En 2022, dans le sillage de la réforme de la Fonction publique, le gouvernement avait déjà acté la suppression en bonne et due forme du corps diplomatique français. Une décision contre laquelle le Parti communiste français avait été peut-être le seul à gauche à protester avec quelque conviction.
La conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, édition 2025 (et 2026), aura néanmoins servi à révéler une chose. C’est qu’en se faisant l’écho du langage présidentiel, dont elle ne cherche plus guère à se distinguer, au moins sur les affaires internationales, la classe politique de gauche se met spontanément au service de la communication présidentielle, à laquelle la « grand-messe » de la diplomatie française offre désormais le prétexte opportun.
Les implications des convergences d’idées qui rassemblent si largement la classe politique — de la France insoumise au Parti socialiste en passant par la République en marche — au fil de l’actualité internationale ont de quoi susciter de légitimes interrogations. En sautant les deux pieds joints dans le vacarme médiatique orchestré par la communication présidentielle, une grosse partie de la gauche française accompagne un tournant qui pourrait bien marquer la fin de l’histoire de la diplomatie française.
À partir de ce tournant : dans le sillage du président de la République, la classe politique française s’attache tout entière à la « défense des démocraties » (libérales, s’entend), qui trouvent leur parfaite incarnation dans les valeurs de l’Union européenne, contre « l’internationale réactionnaire » de Donald Trump et consort. L’allocution présidentielle à la Conférence ne nous apprend rien, cependant, de la spécificité de la politique étrangère de la France, qui ne semble plus guère occuper le centre de la discussion.
Pour la diplomatie française, le monde d’après ressemble désormais à un théâtre d’ombres où « la morale remplace le réel », où « l’émotion » se substitue à la « raison », et où, pour finir, « l’incantation remplace l’action ». Cette fois, comme presque toujours, les dessous de l’affaire sont peut-être à chercher dans une certaine formule du bonheur à l’européenne.













 del.icio.us
del.icio.us Imprimer
Imprimer
 Digg
Digg