13/11/2012
Le Front de gauche de Sevran épingle la grève de la faim de Stéphane Gatignon
 Les élus et militants du Front de gauche de Sevran rejettent la grève de la faim très médiatisée de Stéphane Gatignon comme mode d'action pour résoudre les problèmes de financements de la ville du 93. Dans un communiqué publié ce mardi, ils mettent en cause les choix politiques du maire EELV dans la gestion de la ville.
Les élus et militants du Front de gauche de Sevran rejettent la grève de la faim très médiatisée de Stéphane Gatignon comme mode d'action pour résoudre les problèmes de financements de la ville du 93. Dans un communiqué publié ce mardi, ils mettent en cause les choix politiques du maire EELV dans la gestion de la ville.
"L’action publique d’un élu ne peut se résumer à jouer sur l’émotion de la population", déplore d'entrée le communiqué émis par l'assemblée citoyenne du Front de gauche à Sevran qui explique préférer l'action collective "plutôt que de soutenir une action individuelle qui engendre de la désespérance et contribue à donner de notre ville une image désespérée."
"Le maire de Sevran doit aussi s’interroger sur sa gestion. Cette nouvelle opération de communication ne peut pas servir à masquer des choix politiques qui ont conduit à des échecs", estiment ces élus et militants qui listent trois erreurs du maire de la ville de Seine-Saint-Denis:
- "Stéphane Gatignon a soutenu le Traité d’austérité Sarkozy-Merkel qui étrangle les collectivités locales. Son parti, Europe écologie-Les Verts, approuve le budget du Gouvernement prévoyant la baisse drastique de 2,25 milliards d’euros des dotations aux communes dans les prochaines années. Quel sens y a-t-il à réclamer 5M d’euros supplémentaires aujourd’hui, et accepter la baisse des dotations dans les prochaines années?"
- "Avant l’été, les élus sevranais du Front de gauche ont initié une action avec la population pour obtenir de l’Etat plusieurs millions pour financer la construction d’une école dans le sud de la ville. Le maire de Sevran a refusé d’y participer. Il a préféré recourir à un financement en partenariat public-privé qui avait pour conséquence automatique de faire perdre à la ville une subvention de 3 millions de la Région Ile-de-France!"
- "Ce partenariat public-privé, contre lequel nous avions mis en garde, a depuis échoué et retardé d’ un an la construction de l’école. Déjà en 2010, à propos d'un précédent PPP sur l’éclairage public, la Chambre régionale des comptes avait mis en cause la responsabilité de la ville, en épinglant de « nombreuses irrégularités » aux règles légales et « son manque de compétences ». Pour solder le contentieux, Sevran a dû verser plus de 1,1 million d’euros de dommage, aux frais des contribuables sevranais ! Conclusion des magistrats : « la commune n’a pas correctement défendu ses intérêts »."
17:17 Publié dans Actualités, Cactus, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eelv, seine-saint-denis, collectivités territoriales, politique de la ville, finance publique, pacte budgétaire européen, aménagement du territoire, sevran, stéphane gatignon, dsu, banlieue quartiers populaires |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
08/11/2012
Thierry Lepaon (CGT): le plan compétitivité est "une erreur politique"
 Le futur secrétaire général de la CGT, Thierry Lepaon, a estimé jeudi que le plan du gouvernement pour la compétitivité était une "erreur politique". Le syndicat poursuit son offensive contre les annonces d’Ayrault entamée hier par Bernard Thibault.
Le futur secrétaire général de la CGT, Thierry Lepaon, a estimé jeudi que le plan du gouvernement pour la compétitivité était une "erreur politique". Le syndicat poursuit son offensive contre les annonces d’Ayrault entamée hier par Bernard Thibault.
L'octroi d'un crédit d'impôt de 20 milliards d'euros pour favoriser 300.000 créations d'emploi, "ça fait environ 70.000 euros l'emploi" dans le privé "alors qu'on refuse de donner les moyens au service public de notre pays de fonctionner normalement, je pense que c'est une erreur politique", a déclaré sur RTL celui qui succèdera en mars à Bernard Thibault. Le financement de ce plan au moyen notamment d'une hausse de la TVA signifie que "ce sont les salariés, les ménages qui vont une nouvelle fois être mis à contribution".
"On confie encore l’avenir des salariés à un patron"
Thierry Lepaon rappelé qu’en France, le problème n'est pas le coût du travail, "c'est le problème du coût du capital". Pour sa première interview suite à sa nomination officielle, Le futur secrétaire général poursuit l’offensive lancée mercredi par Bernard Thibault : "La CGT conteste fortement les volets essentiels du dispositif" présenté mardi par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault en soutien à la compétitivité avait-il lancé. Le syndicat dénonce "une vaste campagne consistant à culpabiliser les salariés sur le coût du travail", mais aussi le financement du plan, via la hausse de la TVA, "un impôt très inégalitaire".
Autre point de contestation, les 20 milliards d'euros de crédit d'impôt prévus par le plan, "vont bénéficier à toutes les entreprises y compris à celles qui distribuent des dividendes. C'est inacceptable pour nous". Surtout que ces milliards "s'ajoutent à 160 mds d'exonérations déjà accordées. Je dis stop".
- Et de rappeler que pour l’instant, "87 manifestations et rassemblements sont prévus" le 14 novembre à l’appel de la Confédération européenne des syndicats, dont sont membres notamment la CGT et la CFDT.
Thierry Lepaon, le successeur de Bernard... par rtl-fr
15:20 Publié dans Actualités, Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : syndicat, cgt, bernard thibault, compétitivité, thierry lepaon |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
09/10/2012
Le bouclier fiscal de François Hollande coûtera 675 millions d'euros, presque autant que celui de Sarkozy
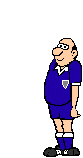 Tiens, revoilà le bouclier fiscal. En mars 2012, pendant la campagne présidentielle, François Hollande avait indiqué qu'il rétablirait un bouclier fiscal à 85%, comme du temps de Michel Rocard.
Tiens, revoilà le bouclier fiscal. En mars 2012, pendant la campagne présidentielle, François Hollande avait indiqué qu'il rétablirait un bouclier fiscal à 85%, comme du temps de Michel Rocard.
Un dispositif nécessaire pour éviter que l'impôt ne soit considéré par le Conseil constitutionnel comme confiscatoire (le fisc ne pourra ponctionner plus de 85% des revenus d'un contribuable). Mais promis juré, le bouclier fiscal de la gauche devait être très différent de celui de Sarkozy.
C'est raté. Non seulement le bouclier fiscal sera plus avantageux que prévu mais ce nouveau dispositif permettra d'être plus généreux... avec les plus riches ! Un comble relevé par Le Canard enchaîné.
Le bouclier fiscal en 1991, en 2006 et en 2007
Créé par Michel Rocard en 1991, le bouclier fiscal première version interdisait au fisc de prélever plus de 85% des revenus d'un contribuable. En 2006, Dominique de Villepin avait fait passer ce taux à 60%. Plus généreux, Nicolas Sarkozy avait descendu ce taux à 50% en 2007. Un bouclier fiscal pour riches donc, qui avait notamment permis à Liliane Bettencourt de recevoir un chèque de 30 millions d'euros de la part de l'administration fiscale.
Hollande et la promesse d'un bouclier fiscal à 85%
Pendant la campagne présidentielle, François Hollande avait annoncé qu'il taxerait à 75% les revenus supérieurs à 1 million d'euros. Une super taxe pour les super riches, symbole de la fin des privilèges de l'ère Sarkozy. Sauf que dans le même temps, Hollande s'était déclaré favorable à la création d'un bouclier fiscal à 85%. Car sans cette mesure, la super taxe pouvait être retoquée par le Conseil constitutionnel au nom de l'équité.
Le bouclier de la gauche coûtera presque autant que celui de Sarkozy
Qu'en est-il aujourd'hui ? Le bouclier fiscal de la gauche sera finalement de 75%. Première victoire pour les ménages les plus aisés : pendant la campagne, Hollande avait prévu d'en ponctionner plus (jusqu'à 85% des revenus). Deuxième victoire : le bouclier fiscal nouvelle version n'a rien à envier au bouclier de Sarkozy : "il coûtera, en 2013, presque autant que son prédécesseur (675 millions contre 735 millions) [et] pour ses bénéficiaires, moins nombreux, il sera nettement plus avantageux", révèle Le Canard enchaîné.
"Les bénéficiaires de ce bouclier nouvelle manière (...) formeront un club certes plus fermé, mais beaucoup mieux loti que ceux de l'ère Sarkozy, poursuit l'hebdomadaire. Selon les chiffres du ministère du Budget, ils seront deux fois moins nombreux (6 662 contre 13 000) et se verront rembourser plus en moyenne : 101 000 euros par contribuable, contre 56 400 sous Sarkozy". Magique.
Devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale, le 27 septembre dernier, le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, a tenté de se justifier : "Nous nous conformons aux injonctions du Conseil constitutionnel, alors que la droite, elle, avait pris une décision politique". Effectivement, ça change tout.
D'ailleurs, le bouclier fiscal de la gauche sera moins visible : plus question d'envoyer de chèques, l'administration fiscale devra faire la soustraction directement sur l'avis d'imposition après l'envoi du formulaire N° 2041-DRID. Un bouclier plus généreux et plus discret ? Sarkozy en a rêvé, Hollande l'a fait.
Le Canard enchaîné · 4 oct. 2012
17:23 Publié dans Actualités, Cactus, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fiscalités, riches, hollande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
07/10/2012
En Allemagne, l’espérance de vie des plus pauvres a reculé d’au moins deux ans depuis 2001
 L’espérance de vie des plus pauvres – ceux qui ne disposent que des trois-quarts du revenu moyen – recule en Allemagne. Pour les personnes à bas revenus, elle est tombée de 77,5 ans en 2001 à 75,5 ans en 2011 selon les chiffres officiels. Dans les Lander de l’Est du pays c’est encore pire : l’espérance de vie est passée de 77,9 ans à 74,1 ans.
L’espérance de vie des plus pauvres – ceux qui ne disposent que des trois-quarts du revenu moyen – recule en Allemagne. Pour les personnes à bas revenus, elle est tombée de 77,5 ans en 2001 à 75,5 ans en 2011 selon les chiffres officiels. Dans les Lander de l’Est du pays c’est encore pire : l’espérance de vie est passée de 77,9 ans à 74,1 ans.
Ces chiffres ont été fournis au député Matthias Birkwald (Die Linke) en réponse à une question écrite, interpellation qui oblige le gouvernement à répondre à en fournissant toutes les données officielles.
Matthias Birkwald est un spécialiste des retraites et son interpellation éclaire d’un jour nouveau la réforme intervenue dans le système allemand de retraites. Le parlement a en effet adopté en 2007 – le gouvernement de l’époque rassemblait sociaux-démocrates du Spd et conservateurs de la Cdu – un report graduel de l’âge de la retraite à 67 ans justifié (comme en France) par l’allongement de l’espérance de vie...
Le pays est souvent montré en exemple pour son taux d’emploi des plus de 60 ans. Dans les faits, montrent les chiffres livrés hier, leur situation les expose souvent à la pauvreté.
En mars 2011, seulement 26,4 % des 60-64 ans occupaient un emploi “normal”, soumis à cotisations sociales. Et moins de 19 % de ces actifs seniors avaient un travail à temps plein.
 Qu’en sera-t-il demain ? Il n’y a pas de salaire minimum garanti en Allemagne et 7,6 millions de personnes ne disposent que d’un “emploi atypique”. Environ 5 millions des quelques 30 millions de travailleurs allemands sont à temps partiel.
Qu’en sera-t-il demain ? Il n’y a pas de salaire minimum garanti en Allemagne et 7,6 millions de personnes ne disposent que d’un “emploi atypique”. Environ 5 millions des quelques 30 millions de travailleurs allemands sont à temps partiel.
En 2009, 2,5 millions de travailleurs – dont 600 000 retraités – étaient en contrat “mini job” payé environ 400 euros (sans cotisations patronales, sans assurance-maladie, sans droits à la retraite...).
Autant de formes de travail qui font (et feront) des retraités pauvres, premières victimes de ce recul de l’espérance de vie.
Article publié dans Viva
10:52 Publié dans Actualités, Connaissances, Dossier retraites, Economie, Planète, Société | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : allemagne, espérance de vie, diminution, pauvres |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
29/09/2012
Budget 2013: les marchés financiers grands gagnants (analyse)
 Dix milliards d'euros d'économies, vingt milliards de recettes nouvelles, les mesures présentées ce matin en Conseil des ministres n’ont qu’un seul objectif: celui de réduire le déficit à 3% du PIB l'an prochain.
Dix milliards d'euros d'économies, vingt milliards de recettes nouvelles, les mesures présentées ce matin en Conseil des ministres n’ont qu’un seul objectif: celui de réduire le déficit à 3% du PIB l'an prochain.
Un budget de « combat », a lancé le premier ministre, Jean-Marc Ayrault, à l’issue du Conseil des ministres. Des mots repris en boucle par les différents ministres. Un combat « contre la crise, la dette et les injustices », a précisé de son côté Pierre Moscovici, ministre de l’économie. Mais pour Nicolas Sansu, député communiste et membre de la commission des Finances, ce budget est avant tout celui « du traité et des 3%, dans lequel il y a des réductions de dépenses, des postes de fonctionnaire en moins et des collectivités qui vont être attaquées. »
- Un budget pour satisfaire les marchés...
Sans nier, Pierre Moscovici a d’ailleurs déclaré qu’il s’agissait là d’une question de « crédibilité » vis-à-vis des marchés et de ses partenaires européens, pour continuer à emprunter à des taux intéressants. Une crédibilité qui pourrait être vite entachée par une baisse de la croissance qu’entrainerait la baisse des dépenses publiques et le manque de relance. D’autant que la prévision de croissance à 0,8% pour 2013 est jugée très optimiste et que beaucoup d’économistes estiment que les 3% ne seront pas atteints. Le gouvernement a d’ailleurs prévu plusieurs collectifs budgétaires.
- .... sur le dos des fonctionnaires...
Le projet de loi de Finances présenté ce vendredi matin en Conseil des ministres comprend 10 milliards d'euros d'économies réalisées sur les dépenses. Si les ministères de l'Education, de l'Intérieur et de la Justice voient leur quotidien amélioré, les autres vont devoir se serrer la ceinture. L'Agriculture, la Culture, et l'Economie sont les grands perdants et voient leur crédit fortement baisser. Au total 12.298 postes seront supprimés et 11.000 créer. Ce seront donc 1.287 postes de fonctionnaires qui disparaîtront.
- ... et des collectivités locales
Des suppressions d’emploi qui s’accompagnent d’un gel du point d’indice des fonctionnaires pour la troisième année consécutive. Pis, pour la deuxième année consécutive les collectivités vont être mises au régime sec. L’Etat a décidé de geler leur enveloppe à 50,5 milliards d’euros en 2013. Puis de la réduire de 750 millions d'euros en 2014 et en 2015, selon le projet de loi de finances (PLF) pour 2013. Une catastrophe économique au moment où les collectivités, premiers investisseurs de France, ont du mal à se financer. Une catastrophe sociale quand les dépenses de solidarité sont assurées par ces collectivités et que le taux de chômage est au plus haut.
- Un budget qui corrige des injustices fiscales...
La stratégie fiscale va dans un autre sens et corrige les injustices laissées par la droite, puisque ce sont 15,8 milliards de hausses d'impôts qui seront ponctionnés principalement chez les ménages aisés et les grandes entreprises. Avec la création d'une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu à 45% et la « taxe exceptionnelle » de 75% sur les revenus d'activité au-delà d'un million d'euros en sont les signes les plus spectaculaires. Et s'accompagnent d'une forte hausse de la taxation du capitall'alignement de la fiscalité des revenus du capital sur celle des revenus du travail.
« L'impôt total versé par le 1 % des ménages les plus aisés augmentera de plus de 2,8 milliards d'euros », insiste Bercy. Côté grands groupes, le projet mise sur un coup de rabot de 7 milliards d'euros sur plusieurs niches fiscales afin de « réduire de 30% l'écart" » qui voit aujourd'hui les grands groupes bénéficier d'un taux d'impôt sur les sociétés à 8%, inférieur de vingt points à celui des petites et moyennes entreprises (PME).
- ... mais qui met à contribution les classes populaires
Reste que les classes populaires et moyennes seront également mises à contribution par le maintien du gel du barème de l'impôt sur le revenu, à l’exception des deux premières tranches, représentant une hausse de l’Impôt sur le revenu de 2%. A laquelle s’ajoute une hausse de la redevance télé de 4,5 euros par foyer. Des mesures qui seront complétées, lundi, par 4 autres milliards de prélèvements inscrits dans le budget de la Sécurité sociale (taxes sur la bière, une hausse de prélèvement de 0,15% sur les pensions des retraités imposables, etc.), pour parvenir aux 20 milliards de recettes supplémentaires annoncés par François Hollande. « La justice par le refus de l’optimisation fiscale est présente dans ce projet, salue Nicolas Sansu. Il manque le rôle incitatif de l’impôt qui contraint les entreprises, par exemple, à réorienter leur stratégie. »
- Des impacts négatifs sur la croissance et l'emploi?
Plutôt que « d’inverser la courbe du chômage », François Hollande risque de l’accroître en réduisant le filet de croissance qui perdure aujourd’hui. Selon l’Office français des conjonctures économiques, cette austérité supplémentaire « amputerait l’activité de 1%, avec un coût social catastrophique». « Le taux de chômage dépasserait la barre des 11 % dès 2014» et «coûterait plus de 160 000 emplois en cinq ans ». Et ce ne sont pas les 300 millions d'euros supplémentaires alloués au ministère du Travail qui vont empêcher la dégradation de l’emploi.
Publié par l'Humanité
20:00 Publié dans Actualités, Economie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : croissance, emploi, dette, budget, impôts, jean-marc ayrault, règle d'or, pierre moscovici, gouvernement, politique budgétaire, nicolas sansu, pacte budgétaire européen |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 









