30/06/2023
L'ECONOMIE ALLEMANDE RENTRE EN RECESSION
Douche froide sur la conjoncture européenne. Le principal pilier de la zone euro est entré en récession au premier trimestre 2023, sur fond d’inflation comme de chute des exportations. Les perspectives s’annoncent sombres. Explications.
De janvier à mars 2023, la production a reculé en Allemagne de 0,3 %. Le pays a ainsi enregistré, après – 0,5 % entre octobre et décembre 2022, un second trimestre de chute de la production. Ce qui est la marque d’une entrée en récession. En dépit des prévisions optimistes des instituts de conjoncture et de l’avis du chancelier Scholz, qui annonçait encore urbi et orbi au début de l’année : « Je suis absolument convaincu que nous n’entrerons pas en récession. »
La crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine et la brutale coupure de gaz russe bon marché jouent naturellement un rôle important dans cet accès de faiblesse. Les prix de l’énergie ont flambé et dopé une inflation déjà très soutenue. Mais le diagnostic est infiniment plus préoccupant, puisqu’il révèle certains travers structurels du modèle ordolibéral allemand qu’Olaf Scholz et son ministre Vert de l’économie, Robert Habeck, s’emploient à perpétuer.
Baisse des salaires
Déjà très malmenées avant le début de la guerre en Ukraine par l’explosion des prix des loyers, les classes populaires sont les principales victimes de la flambée des prix qui s’est propagée très largement, de l’énergie jusqu’aux produits alimentaires. Atteignant les 7,2 % en mars, l’inflation a toujours un niveau très élevé outre-Rhin. Les factures d’électricité sont ainsi les plus chères d’Europe, sur fond de bilan toujours plus calamiteux des émissions de CO2 du réseau. À l’inverse, les entreprises et les plus grands groupes ont vu le choc des prix très atténué par les tarifs de faveur, très subventionnés, d’un État fédéral qui affiche sa priorité de défendre comme le graal leur compétitivité.
Pendant ce temps-là, les salaires réels baissent sous l’effet de la valse des étiquettes. Une étude de l’institut des statistiques fédérales Destatis a mesuré la perte moyenne enregistrée par les salariés sur leurs rémunérations à 4,2 % en 2022. Les luttes du syndicat Ver.di tout au long du premier trimestre dans le secteur des services publics, pour des augmentations de salaire substantielles, et leur degré inédit de popularité dans l’opinion ont révélé l’acuité du phénomène de paupérisation ressenti par l’immense majorité du monde du travail.
Hausse des profits
Le gouvernement tripartite SPD-Verts-libéraux a mis en place un dispositif très coûteux pour tenter de compenser vaille que vaille ces ravages de l’inflation sur le pouvoir d’achat. Les entreprises se sont vu offrir la possibilité de verser une prime exceptionnelle, jusqu’à 3 000 euros, à leurs salariés, la puissance publique effaçant tout prélèvement (impôts ou cotisations sociales) sur ces versements. Moyennant quoi les travailleurs et leurs syndicats sont priés, pour sauvegarder la compétitivité des firmes, encore elle, de renoncer à toute hausse véritable de leurs salaires, une alternative diabolisée comme facteur d’une aggravation de l’inflation.
Si l’on se penche sur les profits des entreprises, le bilan du modèle ordolibéral reste somptueux. Tous les records sont même pulvérisés, en dépit de la guerre et de la crise économique : jamais autant de dividendes (75 milliards d’euros) n’ont été versé aux actionnaires que cette année, selon les calculs d’un Institut pour la finance stratégique (ISF). Bichonnés, les propriétaires du capital ont vu leurs revenus augmentés dans la dernière période dans des proportions jamais atteintes. Au point de rendre l’inflation totalement indolore.
C’est pourtant cette fracture de classes de plus en plus béante qui mine tous les fondamentaux du système de production. Le marché intérieur se contracte en effet à grande vitesse. Quand, au même moment, se réduisent les débouchés à l’international. Les exportations, cœur du modèle industriel, sont touchées. Elles sont en chute libre en mars (– 5,2 %). Un net recul se fait sentir sur les positions acquises par les champions de l’automobile, Volkswagen, BMW, Daimler Benz, sur l’immense marché chinois où ils se font détrôner par les producteurs locaux de véhicules électriques. Plus préoccupant, les commandes en biens d’équipement des pays du Sud global, étranglés par la hausse des taux d’intérêt en raison de leur dépendance au dollar, se tarissent.
Tous les indicateurs sont en train de passer au rouge outre-Rhin. Et plus grand monde n’est dupe des commentaires lénifiants du gouvernement, qui maintient encore pour cette année une prévision de croissance réduite mais positive, à 0,4 %. Les experts de la Deutsche Bank viennent, eux, de réviser drastiquement leurs estimations et tablent sur une récession de l’Allemagne (– 0,3 %) sur l’ensemble de l’année 2023. Avis de gros temps sur tout le reste de la zone euro.
Production : effondrement des commandes industrielles de 10,7 % en mars
L’ampleur de la plongée de la production industrielle allemande, en mars, a surpris la plupart des analystes. Un indicateur révèle à lui seul la taille du décrochage en cours : les commandes industrielles se sont effondrées de 10,7 %, soit un niveau jamais enregistré, sauf au creux de la pandémie de Covid, en 2020. Une très mauvaise surprise pour la plupart des conjoncturistes, qui n’attendaient qu’un recul d’environ 2 %. Dans le détail, la demande sur le marché intérieur s’affaisse de 6,8 %, quand les nouveaux contrats d’achat depuis l’étranger enregistrent une baisse de 13,3 %.
Aucun secteur n’échappe à ce brusque accès de faiblesse : - 12,2 % pour l’automobile, - 7,8 % pour la sidérurgie et - 5,9 % pour les machines-outils. Les reculs les plus marqués concernent les commandes à l’industrie de la construction, en chute libre de 47,5 %, pénalisées par un début de retournement du secteur immobilier, après l’explosion spéculative qui a fait flamber, ces dernières années, le prix des logements dans les grands centres urbains.
17:03 Publié dans Actualités, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
28/05/2023
+4 °C en 2100 en France : mesures de scientifiques s’ils étaient ministres
 +4 °C d'ici 2100 en France : les mesures que prendraient des scientifiques s’ils étaient ministres
+4 °C d'ici 2100 en France : les mesures que prendraient des scientifiques s’ils étaient ministres
La France est exposée à un réchauffement de +4 °C d'ici la fin du siècle, si ce n'est plus, si rien n'est fait. Le ministère de la Transition écologique a dévoilé être en train de travailler sur un plan d'atténuation du réchauffement climatique et d'adaptation aux phénomènes météo extrêmes qui nous attendent dans le futur. Les mesures devraient être annoncées courant juin, mais que feraient les spécialistes du climat s'ils étaient au gouvernement ?
Nous avons posé la question à trois références dans le secteur du climat, parmi lesquelles, un spécialiste de l'agriculture, une spécialiste des questions liées à l'eau et un spécialiste des phénomènes météo extrêmes. Alors, que faudrait-il vraiment faire pour affronter la hausse inquiétante des températures en France et ses conséquences ?
Serge Zaka, agroclimatologue
- Investir dans le développement de nouvelles filières de cultures adaptées aux gelées tardives, à la sécheresse et aux canicules : la pistache, le sorgho, le millet, le mil, la cacahuète et d'autres nouvelles cultures qui viennent d'Europe du Sud et d'Afrique. Il faut plusieurs milliards d'euros pour développer une filière, et il faut environ 15 ans pour la mettre en place. Il est urgent d'investir dès maintenant, car nous avons déjà 20 ans de retard.
- Favoriser le stockage du carbone en France par la photosynthèse, en continuant à développer la reforestation, et surtout l'agriculture de conservation des sols. Il faut aider les agriculteurs à faire cette transition, au niveau finance et formation. Cela comprend aussi le fait que les agriculteurs doivent être rémunérés à juste titre pour les services écosystémiques qu'ils rendent, comme l'entretien des haies et le stockage du carbone.
- Limiter la consommation hors saison et la consommation de viande hors production française. Il faudrait obliger les consommateurs à manger moins de viande, mais à consommer de la viande française de qualité. Les traités internationaux qui permettent d'acheter de la viande pas chère, qui provient de l'étranger, doivent changer. Le rôle d'un ministre est aussi de vérifier que ces produits qui viennent de l'étranger soient respectueux de l'environnement, car le climat est une seule enveloppe.
Emma Haziza, hydrologue
- Préfinancer les mesures de transformation des bâtiments pour s'adapter aux extrêmes climatiques : concrètement, il faut que les particuliers et les professionnels puissent aller chercher en magasin sans payer tout ce dont ils ont besoin pour s'adapter au réchauffement climatique. Il y a déjà beaucoup de choses finançables, mais le processus est lent et complexe, et les populations les plus pauvres ne sont pas forcément au courant.
- Permettre la récupération d'eau grâce à des innovations simples qui ont fait leurs preuves : l'humidification des fondations des bâtiments, en collectant l'eau de pluie, permet par exemple de limiter les problèmes de fissures liés à la sécheresse. Les programmes de recherche ont montré que c'était efficace, il faut maintenant adapter la recherche à la réalité en accompagnant les familles et entreprises. Si on ne travaille pas sur ce problème très vite, le risque est de ne plus avoir aucune assurance qui accepte de couvrir les dommages sur les bâtiments liés à la sécheresse.
- Créer des villes éponges, un domaine dans lequel la France est très en retard. Il faut dé-imperméabiliser nos villes au plus vite en finançant ces travaux. On ne devrait pas autoriser un seul bâtiment qui n'intègre pas les risques de sécheresse, canicule, et inondation. Cela devrait être obligatoire. Tout ce qui permet de faire des économies d'eau, c'est autant d'eau qui ne sera pas prélevée dans les nappes phréatiques.
Davide Faranda, climatologue à l'IPSL
- Une installation massive de l'énergie solaire et de l'éolien pour éviter de produire encore plus d'émissions de CO2, car la réduction des émissions reste la voix principale.
- Une obligation de récupérer les eaux usées en limitant les fuites, mais aussi des limitations de l'utilisation pour des usages de luxe : il faut rationaliser l'usage de l'eau au maximum.
- Renaturer la France autant que possible : les espaces naturels doivent être privilégiés par rapport au béton. La végétalisation des villes est en effet l'une des meilleures options pour atténuer les effets du réchauffement climatique dans les aires urbaines.
11:59 Publié dans Connaissances, Economie, Planète | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : réchauffement climatique, propositions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
21/10/2022
VOITURE ELECTRIQUE : MIRAGE OU REALITE ?

"Deux millions de véhicules électriques produits en France en 2030." Emmanuel Macron a rappelé cet objectif, lundi 17 octobre, en se rendant au Mondial de l'automobile de Paris. Bonus, bouclier tarifaire… Le président de la République avait également annoncé une batterie de mesures en faveur des voitures électriques la veille. Le but, selon le chef de l'Etat, est de "tenir l'objectif pour le climat, pour la réindustrialisation du pays, et pour notre souveraineté". Pourtant, d'un point de vue environnemental, la voiture électrique n'est pas si vertueuse. Franceinfo détaille pourquoi la seule "transition vers l'électrique" de la voiture thermique n'offre pas une solution durable pour dépolluer nos déplacements.
Parce que la voiture électrique n'est pas totalement "propre"
Comme l'a déjà expliqué franceinfo, une voiture électrique pollue. En sortie d'usine, avant même d'avoir roulé, elle présente une empreinte environnementale supérieure à celle d'un véhicule thermique de taille équivalente, résume Bertrand-Olivier Ducreux, ingénieur transport et mobilité à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).
"Cette empreinte environnementale est beaucoup plus élevée pour la voiture électrique, principalement en raison de sa batterie."
Bertrand-OIivier Ducreux, ingénieur transport et mobilité à l'Ademe
à franceinfo
Cobalt, nickel, manganèse, lithium... Les batteries des voitures électriques nécessitent des métaux dont l'extraction est particulièrement polluante. La voiture électrique démarre donc avec un net retard environnemental sur son homologue thermique. Ce décalage n'est comblé qu'après 40 000 à 50 000 km de route, selon les estimations de l'Ademe. Ce rattrapage survient "à condition d'avoir un mix électrique à la française", c'est-à-dire avec une part importante d'électricité peu émettrice en gaz à effet de serre, comme le nucléaire, précise Bertrand-Olivier Ducreux.
Toutefois, sur l'ensemble de sa durée de vie, une voiture électrique roulant en France a un impact carbone deux à trois fois inférieur à celui d'un modèle similaire thermique. Mais un nouveau bémol reste à souligner : cette estimation ne vaut que pour les batteries de moins de 60 kWh, soit l'équivalent d'une Peugeot e208 ou une Renault Mégane au maximum, avec des autonomies d'environ 400 km.
Parce qu'elle est trop gourmande en matières premières rares
Prenons l'exemple d'une batterie de Renault Zoé. Pour la produire, il faut 7 kilos de lithium, 11 kilos de manganèse, 11 kilos de cobalt et 34 kilos de nickel. Le total représente environ 63 kilos de métaux, illustrait "Complément d'enquête", sur France 2, en 2020.
Ces matières premières se trouvent en quantité limitée sur notre planète. Julien Pillot, économiste, anticipe des "conflits d'usage" car les mêmes ressources sont nécessaires pour les éoliennes et le photovoltaïque. En outre, le risque est de remplacer une dépendance aux pays exportateurs de pétrole par une dépendance aux pays extracteurs de métaux rares, comme la Chine.
Pour ses câbles et rotors, un véhicule électrique nécessite aussi une quantité de cuivre bien plus importante qu'un véhicule thermique. Pour Marco Daturi, professeur et chercheur au laboratoire catalyse et spectrochimie de l'université de Caen, c'est une impasse.
"Au rythme actuel d'extraction, dans vingt ans, nous aurons consommé presque tout le stock de cuivre disponible sur Terre."
Marco Daturi, chercheur au laboratoire catalyse et spectrochimie de l'université de Caen à franceinfo
Cela signifie selon lui qu'"il est impossible de remplacer le parc automobile thermique exclusivement par des voitures électriques" et que nous ne pourrons le faire que sur un "pourcentage relativement faible".
Parce que l'intérêt écologique de l'électrique ne vaut que pour les voitures légères
"L'impact carbone d'un véhicule électrique augmente quasiment proportionnellement à son poids, lui-même fortement impacté par la capacité de stockage de sa batterie", écrit l'Ademe dans un avis publié le 10 octobre. L'Agence encourage les automobilistes à "choisir une voiture avec une batterie juste adaptée à l'usage majoritaire" et à opter pour "un modèle de véhicule le plus petit et léger possible".
Des critiques ont donc logiquement émergé lorsque Renault a dévoilé, lundi, un SUV trapu en guise de nouveau modèle électrique de la mythique 4L. "C'est un non-sens de faire un SUV électrique", juge Marco Daturi.
"En France, environ 40% des véhicules sont des SUV. Il faut absolument rééquilibrer ça, aller vers des véhicules nettement plus légers."
Pierre Leflaive, responsable transports au sein du Réseau action climat à franceinfo
Malgré cette nouveauté de la marque au losange à rebrousse-poil des recommandations de l'Ademe, Bertrand-Olivier Ducreux décèle des signaux positifs. "Jusqu'à l'année dernière, la voiture électrique la plus vendue en France était la Tesla Model 3, une voiture très haut de gamme, qui coûte très cher". Selon lui, "beaucoup de personnes avaient un a priori élitiste sur la voiture électrique". Ce regard tend à changer. Sur les huit premiers mois de l'année 2022, les cinq voitures électriques les plus vendues en France sont la Peugeot e208, la Fiat 500e, la Dacia Spring, la Renault Zoé et la Renault Twingo E-TECH. Il relève qu'il s'agit globalement de voitures qui ne sont pas des SUV, qui coûtent moins de 30 000 euros avant les aides publiques, et pèsent entre 1 200 et 1 250 kilos à vide. "Ces voitures ont trouvé leur marché et montrent une réalité industrielle", commente l'ingénieur.
Parce que la voiture électrique n'est vertueuse que sur de courtes distances
A les écouter, des responsables politiques ou des dirigeants de constructeur automobile considèrent la "transition vers l'électrique" comme le remplacement de la voiture thermique par la voiture électrique. "Nous aurons bientôt des voitures qui vont dépasser les 600 km d'autonomie", a déclaré mardi sur franceinfo Carlos Tavares, PDG de Stellantis. Et d'ajouter : "Tant que les consommateurs veulent acheter de l'autonomie, ma mission, c'est [d'y] répondre."
"Si on remplace un véhicule thermique par un véhicule électrique, on ne parvient pas à nos objectifs climatiques", remarque Pierre Leflaive, du Réseau action climat.
"La simple substitution du thermique par l'électrique n'est pas satisfaisante."Bertrand-Olivier Ducreux à franceinfo
L'Ademe, insiste l'ingénieur, met en avant la petite voiture électrique, "un outil efficace et pertinent", pour les déplacements quotidiens dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. "Jusqu'à un passé récent, le véhicule thermique était le couteau-suisse de la mobilité, il pouvait tout faire. Nous ne pouvons pas rester dans ce modèle", estime Bertrand-Olivier Ducreux. Il appelle à une "rupture de comportement" par rapport à une période où "nous choisissions en partie notre véhicule pour les quelques déplacements de l'année les plus contraignants" : partir en vacances à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, avec de nombreux bagages, un ou plusieurs enfants, et parfois des vélos sur le toit.
Pour ces longs trajets, il conçoit la voiture électrique comme un maillon de la chaîne. Au lieu d'effectuer tout le trajet en voiture, il s'agirait par exemple de prendre un bus ou un car pour rejoindre une gare. De là, éventuellement, des transports en commun permettraient de prendre un train de grande ligne. Une fois sur place, la location d'une voiture électrique permettrait de se rendre sur son lieu de vacances et de circuler dans un rayon de 40-50 km.
Parce que c'est la place de la voiture (électrique ou non) qui doit être revue
La voiture électrique n'est qu'une "brique parmi une offre de services de mobilité plus large et diversifiée", écrit l'Ademe. Cette projection se heurte à l'aménagement du territoire, qui a privilégié les routes et l'automobile, laissant le réseau ferroviaire s'éroder. Résultat : la voiture personnelle constitue l'un des modes de transport principaux au quotidien pour 72% des Français, alors que la moitié des trajets font moins de 5 km, rapporte l'Ademe.
"En raison de choix de société, de choix politiques, une part de la population doit utiliser une voiture. Nous ne pouvons pas les culpabiliser."Marco Daturi à franceinfo
Comme l'Ademe, le chercheur en chimie plaide non pas pour une unique solution, mais pour "des solutions qui seront insérées dans le tissu du territoire". Le projet est aussi ambitieux que délicat. "Remettre en cause le tout voiture dans la société, investir massivement dans le ferroviaire, à longue distance, mais également à courte distance, réduire les distances entre le domicile et le travail, réduire l'étalement urbain... C'est une trajectoire plus difficile sur le plan politique que tout miser sur la voiture électrique", analyse Julien Pillot, économiste, chercheur de l'Inseec, associé au CNRS.
Ce profond changement est pourtant nécessaire, juge Pierre Leflaive. Il rappelle que 13 millions de personnes en France sont en "situation de précarité mobilité", c'est-à-dire sans accès à un mode de transport individuel ou collectif, selon la Fondation pour la nature et l'homme. Pour le responsable Transports du Réseau action climat, réduire le parc automobile ne signifie pas réduire les déplacements. D'après lui, il s'agit d'offrir davantage de possibilités aux personnes qui en ont besoin. Dans cette vision, "le ferroviaire va être le fer de lance de la transition du secteur des transports et cela signifie investir massivement", relève-t-il.
"L'enjeu, ce n'est pas de moins bien se déplacer. Au contraire, c'est de mieux s'adapter à nos besoins, et à la fin d'avoir une meilleure mobilité pour tous."Pierre Leflaive à franceinfo
Encore faut-il, concède Pierre Leflaive, améliorer la qualité des alternatives : leur ponctualité, leur régularité, leur prix mais également leur confort. D'après le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, une enveloppe de 100 milliards d'euros sur quinze ans est nécessaire pour doubler la part du train dans les déplacements. Elle engloberait les investissements de remise à niveau du réseau vieillissant, le développement de RER et de nouvelles lignes à grande vitesse. Réponse de Clément Beaune, le ministre des Transports : "Je veux vraiment que si on dégage des moyens budgétaires – et on en dégagera –, on les mette en priorité sur ces transports du travail, du quotidien le plus souvent, et sur le réseau." L'électrification du parc automobile et la revitalisation du train pourraient faire dérailler les comptes publics. Le défi pour l'Etat sera de tenir la charge.
17:06 Publié dans Actualités, Economie, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voiture électrique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
14/10/2022
Conjuguer sciences, travail et environnement
Amar Bellal Rédacteur en chef de Progressistes
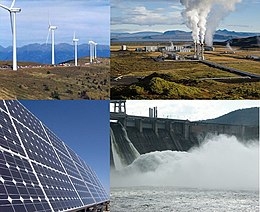 Il existe une autre conception du rassemblement que celle qui prétend le décréter par « le haut » uniquement : celle qui consiste à rassembler par les contenus, par ce que vivent les travailleurs de la science et des entreprises, par le réel, le défi du climat, du développement industriel, de la recherche.
Il existe une autre conception du rassemblement que celle qui prétend le décréter par « le haut » uniquement : celle qui consiste à rassembler par les contenus, par ce que vivent les travailleurs de la science et des entreprises, par le réel, le défi du climat, du développement industriel, de la recherche.
Ainsi, lors de la Fête de l’Humanité, il y a un événement politique, le rassemblement de personnalités du monde scientifique, du monde du travail et de la défense de l’écologie, qui a lieu lors de la soirée repas de la revue Progressistes du jeudi soir.
C’est tout le défi du camp du progrès social que de réussir à articuler ces enjeux : celui du monde du travail, de l’emploi, de l’industrie, d’une part, celui du développement des avancées scientifiques et techniques, d’autre part, ainsi que celui des grandes questions environnementales et en premier lieu le défi climatique. Or, aujourd’hui, tout est fait pour les opposer.
On oppose le monde du travail, la production de richesses à l’environnement : la fameuse usine qui pollue mais sans laquelle nous devrions importer des produits du bout du monde. On oppose le progrès scientifique et technique aux emplois : la robotisation qui mettrait au chômage les salariés. On oppose la science à l’environnement en désignant des découvertes ou de possibles nouvelles technologies qui menaceraient l’environnement.
S’il est si facile d’opposer science, travail et environnement, c’est parce que tout est piloté par le capital au service des actionnaires, sans que les citoyens, les salariés aient vraiment leur mot à dire, sans qu’on mette en débat la finalité de la recherche scientifique. Alors que, au contraire, il faut articuler et conjuguer ces trois grands sujets. Cela implique que les salariés aient plus de pouvoir lors des prises de décisions stratégiques dans les entreprises, dans les instituts de recherche.
Cela demande de financer, à partir d’autres critères, notamment sociaux et environnementaux, le développement économique. Si on ne fait pas ce travail d’articulation, les discours de la gauche prioriseront la décroissance, la peur, la culpabilisation des gens et la dénonciation du progrès scientifique et technique.
Il se trouve que le PCF, parti historiquement attaché à ces enjeux, doit tenir prochainement son congrès : si ce grand moment d’intelligence collective permettait de faire émerger ne serait-ce que cette idée, ce serait déjà un énorme appui pour le monde du travail !
Reconstruire la gauche passe par le refus du populisme, quelle que soit sa forme, comme le populisme scientifique. Quand la gauche s’aventure dans le populisme, à la fin, le gagnant, c’est toujours l’extrême droite : il suffit de voir les ravages du populisme sanitaire aux Antilles, qui porte la gauche très haut au premier tour des dernières présidentielles, mais cela finit par un vote massif pour Le Pen au deuxième tour.
Évoquons aussi le populisme climatique, qui met en avant par exemple l’idée que 67 milliardaires émettraient autant de CO2 que 30 millions de Français en sous-entendant ainsi que cela solutionnerait 50 % du problème. C’est absolument faux. Le chiffre est farfelu. En réalité, leurs émissions propres correspondent à celles d’environ 100 000 Français, ce qui est déjà scandaleux. L’exagération vient du fait qu’on a tenu compte de toutes les productions industrielles qu’ils possèdent, productions que nous consommons tels l’acier et le ciment de nos logements, le pétrole brûlé dans nos voitures, etc.
C’est donc une présentation biaisée du problème. Dénoncer le train de vie des milliardaires – et il faut le faire, il faut légiférer – ne suffit donc pas pour résoudre la crise du climat… En effet, au-delà du symbole, on ne parle ici que de 0,1 % du problème.
La démagogie dans ce domaine provoque des dégâts durables : on se décrédibilise auprès des scientifiques et spécialistes qui connaissent le sujet, d’une part ; d’autre part, on prend du retard dans la bataille politique en se berçant d’illusions avec une solution toute trouvée.
Pour se relever, la gauche doit travailler à articuler science, travail et environnement, ce qui suppose de refuser toutes les formes de populisme.
19:27 Publié dans Connaissances, Economie, Planète, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amar bellal, environnement, travail |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
27/01/2022
VACCINS : FABIEN ROUSSEL A T-IL RAISON ?
Récemment, le candidat à l’élection présidentielle Fabien Roussel affirmait que les vaccins contre la Covid pouvaient être produits massivement dans les pays du Sud, que les capacités et les usines existaient bel et bien, ajoutant qu’il était urgent de lever les brevets pour lutter efficacement contre la pandémie. Vrai ou faux ? Y aurait-il vraiment un obstacle insurmontable à leur production en masse dans le Sud autre que politique comme l’affirme le candidat communiste ? Décryptage.
Par Irene Perrin Toinin pour Progressiste
La réponse à cette question est à peut-être à chercher du côté de l’organisme Human Rights Watch qui a mis en évidence dans un article paru sur son site internet en décembre 2021 que 100 entreprises, dans près d’une quinzaine de pays en Asie, Afrique et Amérique du Sud, ont la possibilité aujourd’hui de produire leurs propres vaccins à technologie ARN messager[1].
Comme l’indique la communauté scientifique, la sortie de la pandémie passe par la vaccination massive de l’ensemble de la population mondiale. Or : Les prévisions de production mondiale de vaccins laissant entendre qu’il y aura bientôt assez de vaccins contre le Covid pour toute la population du monde sont trompeuses, dénonce Aruna Kashyap, directrice adjointe de la division entreprises et droits humains de l’ONG Human Rights Watch. Tandis que le virus mute, les États-Unis et l’Allemagne ne devraient pas laisser les laboratoires dicter où et comment des vaccins doivent être acheminés dans la majeure partie du monde. [2]
Le développement fulgurant du variant OMICRON a bien démontré toute l’utilité sanitaire de la vaccination massive des populations. Ce sont les pays pauvres d’Afrique et d’Asie qui n’ont pas accès aux vaccins. Ainsi, tandis que le taux de vaccination actuel approche des 80% dans les pays européens, il est seulement d’environ 35% au Bangladesh, 4% en Ouganda, autour de 30% en Afrique du Sud. Outre l’injustice criante que cela représente, il s’agit par ailleurs d’un enjeu sanitaire pour sortir de cette pandémie qui accable le monde depuis 2 ans. D’autant plus que les États sont capables de produire ces vaccins dont les brevets appartiennent à des firmes pharmaceutiques. Rappelons-nous de l’interpellation de l’Inde et de l’Afrique du Sud faite à l’Organisation Mondiale du Commerce dès fin 2020 pour demander une levée des brevets nationaux sur les vaccins anti-Covid-19. L’Afrique du Sud a d’ailleurs récemment pris les devants face à l’attente de la levée des brevets. Le 19 janvier 2022[3], le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le milliardaire américano-sud-africain Patrick Soon-Shiong, ont inauguré la première usine de fabrication de vaccins sur le continent au Cap. Si le grand pays africain pourra « se débrouiller seuls(…) libérés des chaînes du colonialisme » comme l’affirmait son président, il restera dans ce cadre dépendant du capital et du marché néo-libéral. La levée des brevets sur les vaccins anti-covid reste pour autant une nécessité.
À ce titre, l’initiative en France du candidat PCF aux élections présidentielles et député du Nord, Fabien Roussel peut donc être légitimement saluée : avec les membres et élus du PCF, il réclame en effet depuis un an cette levée des brevets sur les vaccins. Donc, Fabien Roussel dit vrai sur la nécessaire internationalisation de la production des vaccins.
Il affirmait aussi sous la plume du journal l’Humanité du 2 décembre lors d’une rencontre de l’association des journalistes parlementaires organisée le 1er décembre 2021 : « [Lever les brevets,] c’est permettre que la formule de ces vaccins soit connue de tous, que tous les scientifiques puissent échanger, que tous les pays qui le veulent puissent les produire. Cela permettra de créer de la transparence, de la confiance en ces vaccins qui manque aujourd’hui pour que tout le monde aille se faire vacciner », a-t-il assuré ajoutant que « plus de 100 pays demandent la levée des brevets et des transferts de technologie ».
Cette levée de la propriété intellectuelle sur les traitements avait déjà été réalisée dans le cadre de l’épidémie du VIH. En juillet 2011, le laboratoire pharmaceutique américain Gilead avait renoncé à ses brevets sur 4 molécules aux bénéfices de quelques pays. Ainsi, par exemple, les fabricants indiens de génériques ont pu produire des copies de traitements anti-VIH de Gilead, donnant accès à des populations de pays pauvres aux mêmes avancées dans le domaine de la recherche médicale contre le Sida que les populations des pays riches. Cela restait toutefois assez limité. En 2017[4], un jugement européen a déclaré illégal la prolongation du brevet de Gilead sur le Truvada, un des médicaments le plus utilisé contre le sida. La fin du monopole de la firme américaine permettait le développement des génériques du Truvada en Europe.
Ainsi, la problématique est la même pour l’épidémie de Covid-19 : celle du monopole de firmes pharmaceutiques sur les traitements et les vaccins à des fins mercantiles de profits immédiats au mépris des vies humaines.
Lors de la fête de l’Humanité qui s’est tenue en septembre 2021, Jérôme Martin, co-fondateur de l’observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, était invité au débat sur la levée des brevets à l’Agora de l’Humanité. Il affirmait alors que le médicament ne peut être une marchandise : « On ne sait pas combien les industriels ont reçu d’aides publiques pour pouvoir développer les vaccins contre le covid-19 »
L’industrie pharmaceutique en a bien reçu des milliards. Les laboratoires pharmaceutiques comme Pfizer ou Moderna font des bénéfices sur le dos de la crise sanitaire, alors qu’ils ont démarché des sous-traitants pour la production du vaccin et son flaconnage. Oxfam a calculé que Pfizer, Johnson & Johnson et AstraZeneca ont versé 26 milliards de dollars à leurs actionnaires au cours des 12 derniers mois.[5] Avec les droits exclusifs d’exploitation liés à la propriété intellectuelle, 100 pays sont aujourd’hui bloqués par les monopoles pharmaceutiques pour la production des vaccins.
Cet égoïsme monopolistique est d’autant plus dramatique qu’il alimente la méfiance d’une partie de la population à l’égard de la vaccination. Or, la communauté scientifique a prouvé qu’un faible taux de vaccination engendre un taux de malades et de mortalité importants des suites de cette maladie. La région de la Caraïbe est particulièrement exemplaire en ce sens. Alors que les populations des Antilles françaises connaissent une méfiance accrue à l’égard de la vaccination, donnant lieu une flambée épidémique aux conséquences désastreuses à partir du mois de juillet 2021[6], plus au Nord, Cuba a su développer ses propres vaccins et enrayer le développement de la crise sanitaire sur son territoire[7]. Il s’agit des résultats de politiques en faveur de la santé publique mises en œuvre depuis des décennies[8]. Ayons en mémoire que, dès 2020, des médecins cubains sont envoyés par leur pays afin de porter assistance aux systèmes de santé étrangers, allant même jusqu’à assister des pays riches (Italie notamment). À l’heure actuelle, Cuba connaît un taux de vaccination de 93% selon les données disponibles (ourworldindata.org).
Lors du rassemblement du PCF du 3 février 2021, Fabien Roussel affirmait : « nous demandons que la découverte de ces vaccins tombe dans le domaine public, afin que ces vaccins puissent être produits librement »[9]. Presqu’un an plus tard, il déclare, interviewé par la chaîne Réunion la 1ère en décembre 2021 : « Le meilleur moyen de lutter contre l’apparition des variants, l’OMS le dit, c’est que tous les pays aient accès aux vaccins. Or, il y a une injustice […]. Si je suis élu, je demanderai immédiatement la levée des brevets. »[10] .
Les membres du comité de rédaction de la revue Progressistes ne peuvent qu’approuver ces prises de position d’utilité publique et provenant du PCF et de son candidat aux élections présidentielles.
Irène Perrin Toinin, le 19/01/2022
[1]https://www.hrw.org/fr/news/2021/12/15/covid-19-des-exper...
[2]N’en déplaise à Big Pharma, les vaccins à ARN messager peuvent être produits partout dans le monde | L’Humanité (humanite.fr)
[3]https://afrique.tv5monde.com/information/afrique-du-sud-p...
[4]https://www.aides.org/communique/generique-de-fin-pour-le...
[5]Levée des brevets : démêler le vrai du faux (oxfamfrance.org)
19:29 Publié dans Connaissances, Economie, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fabien roussel, covid, masques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 











