En 2007, la France a consacré à l’ensemble de son système éducatif (métropole + DOM) 125,3 milliards d’euros, soit 6,6 % de la richesse nationale (PIB), ce qui représente un montant de 1 970 euros par habitant, ou 7 470 euros par élève ou étudiant. Hors formation continue, cet effort nous situe au-dessus de la moyenne des pays de l’OCDE (6,0 % contre 5,8 % en 2005).
La part de la dépense d’éducation dans la richesse nationale s’était sensiblement accrue au début des années 1990, pour atteindre 7,6 % en 1993 contre 6,4 % en 1980. Depuis, la tendance s’est lentement et progressivement inversée, la dépense d’éducation continuant l’augmenter, mais moins vite que la richesse nationale.
Depuis 1980, la dépense d’éducation a augmenté de 85 % à prix constants, progressant sur un rythme annuel moyen équivalent à celui du PIB (2,2 %). Cette croissance s’explique moins par l’accroissement du nombre d’élèves et d’étudiants que par celui du coût de chaque élève. Tous niveaux confondus, ce coût unitaire a augmenté de 73 % depuis 1980, en raison du développement particulier des enseignements du second cycle du secondaire et du supérieur relativement plus coûteux, mais surtout de l’amélioration des conditions d’accueil des élèves, et de la revalorisation des carrières et des rémunérations des enseignants.
Durant cette période, les coûts annuels moyens par élève des premier et second degrés ont davantage progressé (de respectivement 79 % et 63 %), que celui d’un étudiant du supérieur (+ 36 %).
Dans le premier degré, la stabilité du nombre d’enseignants conjuguée à la décrue des effectifs d’écoliers s’est traduite jusqu’à la rentrée 2002 par une nette amélioration des taux d’encadrement. Le second degré n’a pas connu une telle évolution, mais dispose de moyens relativement importants par rapport aux autres pays comparables. Les forts taux d’encadrement caractéristiques de notre enseignement secondaire (ratio moyen de 11,9 élèves par enseignant, en 2006), renforcés par la baisse démographique actuelle, tiennent en particulier au fait qu’un nombre important d’heures d’enseignement (un tiers en moyenne et la moitié dans les lycées) sont dispensées non pas devant la classe entière mais devant des groupes réduits d’élèves.
Si le poids de l’enseignement supérieur dans la dépense d’éducation s’est accru depuis 1980, c’est d’abord en raison de la hausse particulière des effectifs d’étudiants, les coûts unitaires ayant en revanche nettement moins progressé que dans l’enseignement scolaire. Une reprise de l’effort en faveur de l’enseignement supérieur est cependant engagée et, en 2007, la dépense par étudiant dépasse plus nettement la moyenne observée pour un élève du second degré, le coût de l’étudiant universitaire restant toujours inférieur à celui d’un lycéen (près de 9 000 euros contre plus de 10 000).
L’État assume de manière prépondérante le financement de la dépense d’éducation, à hauteur de 61 % en 2007, dont 55 % pour le ministère de l’Éducation nationale. Son budget sert d’abord à rémunérer des personnels dont les effectifs et surtout la structure ont sensiblement évolué. Ainsi, 94 % des enseignants du public sont maintenant professeurs des écoles dans le premier degré, et 75 % agrégés ou certifiés dans le second degré.
Les collectivités territoriales contribuent à hauteur de 22,8 % au financement « initial » de l’éducation en 2007, contre 14 % en 1980.
Cette part, qui s’accroît encore avec les nouvelles vagues de décentralisation, dépasse 40 % dans le premier degré, où les communes prennent en charge les dépenses de personnels non enseignants, ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’investissement des écoles.











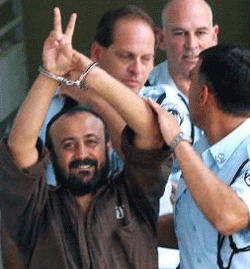

 del.icio.us
del.icio.us Imprimer
Imprimer
 Digg
Digg



