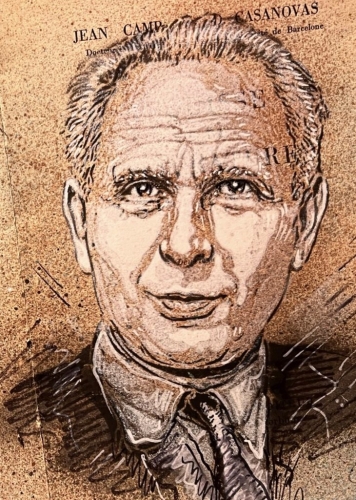Pays de 35 millions d’habitants, colonie britannique jusqu’en 1957, date à laquelle l’ancienne « Golden Coast » prend son indépendance, le Ghana est aujourd’hui le pays le plus développé de l’Afrique de l’Ouest en termes d’indicateur de développement humain (IDH). Entre héritage du panafricanisme de Nkrumah, montée de l’évangélisme, exploitation des ressources minières, sous une apparente stabilité politique, le Ghana est aujourd’hui au centre des enjeux rencontrés sur le continent Africain.
Le Ghana, une terre de mission pour les églises évangélistes
 Au Ghana, où 70% de la population est chrétienne et 20% musulmane, la religion est omniprésente. Les églises pentecôtistes et charismatiques y connaissent une expansion fulgurante, avec près de 30% de la population affiliée à ces mouvements, tandis que les Anglicans et autres protestants traditionnels voient leur influence stagner.
Au Ghana, où 70% de la population est chrétienne et 20% musulmane, la religion est omniprésente. Les églises pentecôtistes et charismatiques y connaissent une expansion fulgurante, avec près de 30% de la population affiliée à ces mouvements, tandis que les Anglicans et autres protestants traditionnels voient leur influence stagner.
Le pays est devenu l’un des épicentres du renouveau évangélique en Afrique de l’Ouest, favorisé par l’héritage indirect de la colonisation anglaise qui a semé un terreau religieux fertile au développement des églises protestantes, mais aussi influencé par des réseaux étrangers et des missions internationales. Dans les rues d’Accra, comme dans tout le pays, les affiches annoncent les prédications de pasteurs devenus de véritables stars nationales. Certains possédant leurs propres chaînes de télévision diffusant en boucle sermons, prières et exorcismes.
Les églises y guident la foi mais régissent également des pans entiers de la vie sociale et politique, des choix économiques des fidèles aux débats publics sur la morale. Les conférences géantes attirent des milliers de participants chaque semaine, et dans les quartiers populaires comme dans les centres urbains, l’influence des télévangélistes se ressent jusque dans les écoles et les commerces. Le pentecôtisme ghanéen a pu se développer en prônant une africanité de la religion, et en reprenant habilement chants, danses et invocations locales qui faisaient partie du quotidien.
À Cape Coast, ville côtière de l’ouest du pays qui abrite l’un des plus anciens forts coloniaux construits par les portugais et point de départ de la déportation des esclaves vers le continent américain, Mikael, issu d’une famille de pécheurs et travaillant dans le secteur du tourisme nous explique. « Il est vrai que la religion est très importante pour nous, elle fait partie de notre identité. L’église et les pasteurs permettent de rendre la société moins violente. Les gens écoutent les consignes de l’église, et nous nous comportons de manière pacifique les uns envers les autres. De l’autre côté, les pasteurs jouent un rôle politique et anesthésient la société. Nous ne nous révoltons pas, acceptons tous les problèmes politiques sans protester. Au final, les politiques peuvent continuer de se servir sur le dos du peuple ».
Il continue en évoquant le bipartisme du Ghana « l’élection du Président Mahama ne changera rien pour nous, les deux partis alternent et remplacent les juges pour ne pas être dérangés. Les routes ne sont pas réparées à cause de la corruption et l’école continue de coûter cher, alors que nous avons tout pour être riches, de l’or, de la bauxite, du cacao, du pétrole et des mangues ! »
Alternance politique, rentes minières et programme FMI
Depuis la fin des années 1990, la vie politique ghanéenne est dominée par deux blocs solidement installés : le National Democratic Congress (NDC) et le New Patriotic Party (NPP), vitrine du libéralisme anglophone ouest-africain. Le retour de John Mahama (NDC) au pouvoir en 2024 s’inscrit dans ce cycle presque mécanique d’alternance entre la social-démocratie et le libéralisme, symbole pour les observateurs internationaux d’un « modèle de démocratie pour l’Afrique de l’Ouest ».
Pour d’autres, dans ce système verrouillé, les rentes minières alimentent le clientélisme, les nominations partisanes et les campagnes électorales bien plus qu’elles ne financent les routes, les écoles ou la santé. Le pluralisme existe sur le papier ; dans la vie réelle, il se résume trop souvent à une alternance d’élites qui protègent les mêmes intérêts.
Le Ghana dispose de ressources naturelles et minières conséquentes lui permettant de se hisser à la troisième place des économies de la CEDEAO. Son économie dépend largement des exportations de matières premières : or (61% des recettes d’exportation), cacao (16%) et pétrole (10%). Le Ghana est le premier producteur d’or en Afrique et le deuxième mondial de cacao.
Les grandes compagnies étrangères comme AngloGold Ashanti (Afrique du Sud), Newmont (États-Unis) ou Gold Fields (Afrique du Sud) contrôlent les concessions les plus lucratives et exportent la majorité de la production, posant la question de la souveraineté du Ghana sur ses ressources. Dans le même temps, des milliers d’artisans creusent à mains nues ou à la pioche dans les rivières et collines, au mépris des règles : c’est le fameux galamsey, responsable de déforestations massives, de rivières contaminées au mercure et de sols ravagés.
Les habitants subissent ces dégâts au quotidien, tandis que l’État, entre pression des multinationales et nécessité de réguler l’illégalité, peine à protéger les villages et à faire entrer dans ses caisses une part équitable des richesses. Sur le terrain, cela crée tensions et conflits : disputes sur les droits d’accès aux sites, enfants et jeunes exposés au travail dangereux, et un sentiment croissant que l’or du Ghana profite d’abord à l’étranger et aux élites locales.
Pourtant, depuis décembre 2022, le Ghana est en défaut de paiement sur une partie de sa dette externe — un choc majeur qui a obligé Accra à solliciter un prêt de 3 milliards de dollars auprès du Fonds monétaire international (FMI) dans le cadre d’une facilité élargie de crédit. Le programme impose le cocktail classique des mesures FMI : austérité budgétaire, mobilisation accrue des recettes, politique monétaire stricte, hausse des prix de l’électricité... Si ces mesures ont permis de stabiliser l’inflation et d’accroître les réserves de change, le prix social est lourd : réduction des dépenses publiques, pression sur les populations vulnérables, et dépendance aux bailleurs extérieurs.
Le rôle central des infrastructures publiques
Akosombo, à 1h au nord d’Accra, au bord du fleuve Volta. Alors que nous nous approchons de l’imposant barrage jouxtant la ville, nous sommes arrêtés par le garde de l’autorité du bassin de la Volta. Il nous souffle « Désolé, vous devez faire demi-tour. Le barrage est une infrastructure stratégique, c’est le cœur du pays […] s’il a un problème, tout le Ghana le ressent ! ».
Construit dans les années 1960 sous Nkrumah, le barrage d’Akosombo a bouleversé la Volta en créant le plus grand lac artificiel du monde et en électrifiant une large partie du pays. Un véritable symbole pour un pays qui venait d’obtenir son indépendance et une source d’électricité fondamentale pour l’exploitation des fonderies d’aluminium ghanéennes, sous propriété d’une société américaine. 80% de l’électricité produite initialement par le barrage était destinée à la production d’aluminium, nourrissant les critiques qui pointaient le néocolonialisme du projet financé en partie par la Banque Mondiale, les États-Unis et le Royaume-Uni.
Aujourd’hui, le Ghana est un des pays d’Afrique les plus électrifiés (89%), le barrage produit environ 50% de la demande et permet également d’alimenter en électricité le Togo et le Bénin. Le pays fait pourtant face à des coupures de courant régulières en raison du mauvais état du réseau lié en grande partie à la situation financière catastrophique de la Compagnie d’électricité du Ghana.
De la Chine à la Russie, de nouvelles coopérations
53 ans après la mort de Kwame Nkrumah, père de l’indépendance du Ghana, la question de son héritage demeure centrale. Le non-alignement du Ghana, son rôle dans l’émancipation des peuples africains et son ambition panafricaniste continuent de nourrir le récit national. Entre recherche d’investissements étrangers, négociations avec le FMI, partenariats sécuritaires multiples et arbitrages permanents entre puissances rivales, Accra doit naviguer aujourd’hui au gré des contraintes économiques.
Le retour au pouvoir de John Dramani Mahama en 2024 a néanmoins marqué un tournant dans la politique étrangère du Ghana. Si la politique internationale du Ghana en 2025 n’est pas une version actuelle du non-alignement et panafricanisme de Nkrumah, ce dernier agit néanmoins pour ériger à nouveau le Ghana comme médiateur continental. À ce titre, il a personnellement pesé pour renouer les liens avec l’Association des États du Sahel (AES - Mali, Burkina-Faso et Niger) en se rendant dans chacun de ces États et en nommant un médiateur dédié, visant à rapprocher les positions entre la CEDEAO et l’AES.
Le nouveau président déploie par ailleurs une politique étrangère teintée de pragmatisme. Mahama a rencontré Xi Jinping en Chine en octobre dernier. Une visite qui a permis de raffermir les relations historiques entre le Ghana et la RPC, en développant une coopération axée sur les questions économiques (mines, infrastructures, agriculture, pêche). La rencontre a également débouché sur une convergence de vues sur les grands enjeux mondiaux (multilatéralisme, nouvelles routes de la soie, initiative chinoise pour la gouvernance mondiale…). Le Ghana entretient par ailleurs des relations poussées avec la Russie avec des projets dans le domaine du nucléaire civil, bien que la coopération économique soit freinée par les sanctions occidentales.
Sur le continent africain, le Ghana a opéré un revirement majeur en direction du Maroc, avec une montée significative de la coopération avec le Royaume soldée par le soutien en juin 2025 du plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental et la fin de la reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique.
Le pragmatisme pour l’Occident
Le pragmatisme de la politique étrangère de Mahama s’illustre également dans ses relations avec l’Occident. Le premier exemple est l’accord de septembre dernier conclu avec Trump. Le Ghana accepte désormais de recevoir les ressortissants de pays d’Afrique de l’Ouest expulsés des États-Unis, un accord conclu sous la pression du président Trump (restrictions de visas et droits de douane).
L’ancien président libéral ghanéen, Nana Akufo-Addo avait entamé un rapprochement significatif avec la France, Emmanuel Macron faisant même du Ghana un symbole d’une politique africaine française se déplaçant hors de son pré-carré historique se réduisant à peau de chagrin. Symbole de ce rapprochement, le Ghana a officiellement adhéré à l’Organisation internationale de la Francophonie en 2024, avec le soutien appuyé de la France. L’arrivée au pouvoir de Mahama ne semble pas avoir renversé cette dynamique, en témoigne sa présence en tant qu’invité d’honneur au Forum de Paris pour la Paix et l’agenda bilatéral plutôt dynamique.
On peut citer la demande ghanéenne d’assistance de la France pour la lutte contre la piraterie dans le Golfe de Guinée, la demande d’implication de l’Agence Française de Développement suite au départ de l’USAID, l’Agence de développement des États-Unis…
Depuis le retour au pouvoir de Mahama, après un mandat de Akufo-Addo très pro-occidental, la politique étrangère du Ghana se rééquilibre vers un multilatéralisme assumé, ne se fermant aucune porte et en endossant un rôle de médiation sur le continent.
par Paul Moullec pour Liberté Actus












 del.icio.us
del.icio.us Imprimer
Imprimer
 Digg
Digg