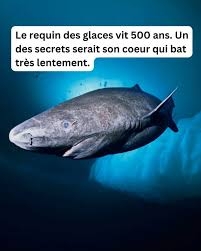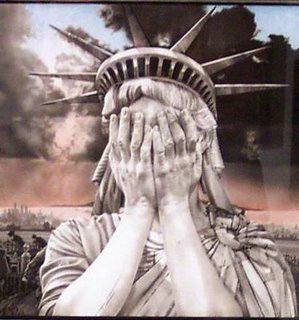Les métaux rares, ou « terres rares » sont un groupe de métaux :
- Ils sont définis comme des éléments géologiques ayant des propriétés physiques spécifiques.
- Relativement abondants dans la terre, malgré leur nom.
- Très difficiles à extraire et à purifier (ils sont mélangés à d’autres minéraux et très dispersés).
- Il est rare de trouver un gisement assez riche pour justifier une mine.
En bref, les métaux rares sont des métaux particulièrement difficiles à obtenir. Les séparer exige un travail long, coûteux, complexe et très polluant (énormes quantités de déchets rocheux, d’eaux usées, risques de contamination des sols, éléments radioactifs).
Exemple : pour 1 kilo de lutécium, il faut casser 1 200 tonnes de roches ; pour 1 kilo de scandium, c’est près de 4 tonnes de minerai à traiter avec un bon gisement.
On liste 17 terres rares, dont les lanthanides (auxquels appartient le lutécium), le scandium ou l’yttrium. Ils permettent, par exemple, de fabriquer des aimants permanents, des alliages, écrans, catalyseurs, etc.
Les métaux rares sont aussi… critiques
Les métaux critiques ou stratégiques sont listés par des gouvernements en raison de plusieurs critères économiques et politiques :
- Essentiels pour l’économie.
- Peu substituables par d’autres matériaux.
- Présentent des risques élevés de pénurie.
Par exemple, l’Union européenne liste 34 matières premières critiques, dont les terres rares, le lithium, le cobalt, le graphite, le nickel, le gallium, le germanium, l’indium, le tantale, le tungstène ou encore le phosphore. Les « terres rares » sont des métaux critiques, mais la liste de ces matériaux stratégiques les dépasse largement.
Là aussi, les utilisations sont variées et stratégiques : le gallium pour les puces électroniques, les LED et les cellules photovoltaïques ; l’indium pour les écrans tactiles ; le tantale pour les condensateurs d’appareils électroniques ; le germanium dans les fibres optiques et les lentilles infrarouges ; le tungstène dans les armements, etc. Le cobalt et le lithium sont connus pour leur utilisation dans les batteries.
Ces métaux sont donc largement indispensables à la transition énergétique, à l’électronique ou au secteur de la défense.
Guerre commerciale ou coopérations ?
À ce jour, la production des métaux rares est en fait très concentrée : la Chine domine très largement la production mondiale. Elle vend plus de 168 000 tonnes par an, soit 60 % du marché mondial, selon l’Institut des études géologiques des États-Unis (USGS).
Mais elle est encore plus incontournable dans les premières étapes de la chaîne de valeur. La Chine extrait ainsi 60 à 70 % des minerais de terres rares et raffine 90 % de la production mondiale. Autrement dit, la plupart des pays extracteurs font appel à elle pour le raffinage du matériau.
Cela ne date pas d’hier, car la Chine populaire est devenue premier producteur mondial de métaux rares en 1995 !
Même si ces métaux sont aujourd’hui essentiels pour la production des véhicules électriques, éoliennes et panneaux photovoltaïques, l’extraction et le raffinage ont un coût environnemental assez colossal. C’est pourquoi la Chine tente de limiter sa production en établissant des quotas d’exportation, mais le monde entier veut lui en acheter !
Dans le cadre de la guerre commerciale lancée par les États-Unis, le gouvernement chinois demande désormais à vérifier que ses exportations ne soient pas utilisées par des industries militaires contraires à ses intérêts de sécurité (comme c’est le cas pour l’armement américain).
Il faut bien comprendre qu’on parle ici de capacités de production à une échelle gigantesque et que la question de la répartition géologique des réserves minérales est secondaire. Les estimations évoluent constamment avec les progrès des connaissances, et la Chine a un réservoir certes important (37 % des réserves mondiales), mais dans une proportion relativement plus faible que son importance dans la production mondiale.
Peut-on en produire en France ?
Selon l’USGS, 4 pays détiendraient 90 % des réserves mondiales : Chine, Vietnam, Brésil et Russie. Quatre pays avec lesquels les États-Unis et leurs vassaux entretiennent des relations quelque peu tumultueuses.
En admettant que des coopérations futures permettent d’acheter des métaux rares à ces pays, le retard pris dans le développement de capacités de traitement et de raffinage est abyssal. La Chine a non seulement plus de 30 ans d’expérience industrielle, mais également une stratégie nationale d’investissements, des entreprises publiques au centre du secteur, une intégration de ses industries de pointe qui bénéficient de cette production spécifique.
Une éventuelle exploitation française, dans un cadre d’entraide et de partage des savoir-faire, mettrait au minimum 10-15 ans à être mise en service. Autant dire que nos va-t-en-guerre et protectionnistes du cru nous emmènent droit dans le mur.













 del.icio.us
del.icio.us Imprimer
Imprimer
 Digg
Digg