Dans certaines régions des Etats-Unis l'espérance de vie est plus basse qu'au Bangladesh et au Viêt Nam.
Etats-Unis : chômage faible mais grande pauvreté
Etrangement, alors que de nombreux économistes montrent en exemple les Etats-Unis pour leur quasi plein emploi, avec 4% de chômage, c'est pourtant ce pays qui génère le plus grand nombre de pauvres et d'écarts salariaux au sein des pays développés. Les injustices sociales sont une caractéristique des Etats-Unis. Le candidat à la primare démocrate, Bernie Sanders faisait ce constat en 2016 : "Une vingtaine de personnes détient la même richesse que les 50 % les moins nantis du territoire américain". Plus de 5 millions d'Américains vivent avec moins de 4 dollars par jour et comme le soulignait le prix Nobel d'économie Angus Deaton dans un éditorial du New York Times fin 2017, : "Dans certaines régions [des Etats-Unis] comme le delta du Mississippi et les Appalaches, l'espérance de vie est plus basse qu'au Bangladesh et au Viêt Nam."
Les enfants américains sont ceux qui sont confrontés au plus haut niveau de pauvreté dans le monde occidental développé
Les calculs de taux de chômage aux Etats-unis ne reflètent pas la réalité de la bonne santé économique et sociale des citoyens : des millions de personnes ne sont pas comptabilisées comme étant sans emploi parce qu'elles sont soit en prison, subissant des mini-jobs, malades, ou simplement n'étant pas inscrites dans l'équivalent des pôles-emploi américains. Près de 45 millions de personnes sont considérées comme "pauvres", soit 13,5% de la population . Ces chiffres sont contestés par des universitaires qui estiment que la pauvreté aux Etats-Unis est bien plus importante. Une étude publiée fin 2009 sur la pauvreté des enfants fait ce constat effarant : "Les enfants américains sont ceux qui sont confrontés au plus haut niveau de pauvreté dans le monde occidental développé".
Les Etats-Unis sont le pays le plus riche du monde, avec les plus hauts revenus par habitants et pourtant une part importante de sa population vit dans de très mauvaises conditions, au point de faire baisser l'espérance de vie de l'ensemble de la nation. Les raisons concrètes de cette baisse sont connues et sont dûes principalement à la mauvaise alimentation, la difficulté d'accès aux soins, la prise de drogues et de médicaments opiacés.
Royaume-Uni : quand l'austérité tue
Le Royaume-Uni subit des problèmes d'inégalités sociales et de grande pauvreté depuis des décennies, mais avec une explosion de ceux-ci depuis 2011 : la crise financière de 2008 a incité les différents gouvernements britanniques à appliquer des cures d'austérité budgétaires drastiques.
Dans le quartier le plus cher de Londres, à Chelsea, les riches vivent en moyenne 16 ans de plus que les pauvres.
La longévité est en baisse au Pays de Galle et en Ecosse et cette baisse est clairement reliée au niveau de vie des habitants : francetvinfo explique que "Dans le quartier le plus cher de Londres, à Chelsea, les riches vivent en moyenne 16 ans de plus que les pauvres".
La population la plus touchée et la plus fragile au Royaume-Uni est celle des personnes âgées qui ne peuvent souvent pas se payer une alimentation correcte, les prix ayant flambé, pas leurs pensions. Le budget du système de santé a été grévé et de nombreux services ne sont plus fournis, comme les repas livrés à domicile ou les bus en zone rurale. Les prises en charge de problèmes de santé causés par la pollution sont le plus souvent effectuées en urgence. Alcoolisme, prises d'anti-dépresseurs, suicides causés par l'isolement social et économique : les personnes âgées meurent de plus en plus prématurément au Royaume-Uni.
Interrogé par Le Monde, un chercheur de l'université d'Oxford, Danny Dorling résume la situation : "Si plus de gens vivent sous le seuil de pauvreté, qu’on réduit les aides aux personnes âgées, que le budget du système de santé ne progresse pas, qu’il y a plus de sans-abri, peut-être qu’on ne devrait pas être surpris des conséquences".
Sachant que le taux de longévité a été "gonflé" par l'arrivée des jeunes immigrés polonais venus chercher du travail, la réalité de la baisse de l'espérance de vie britannique va très vite devenir difficile à cacher. Le chercheur Danny Dorling n'est pas optimiste et pense que cette baisse va continuer et s'amplifier. Le problème central qui n'est pour l'heure pas discuté, pour cause de batailles politiques sur le Brexit, est en fait celui de la redistribution des richesses. Mais l'Etat britannique ne semble pas désireux de s'emparer du sujet, surtout quand il se vante de son taux de chômage à 4% gagné par des mesures de restrictions des droits des chômeurs, de contrôles ultra sévères et de "contrats 0 heure"…










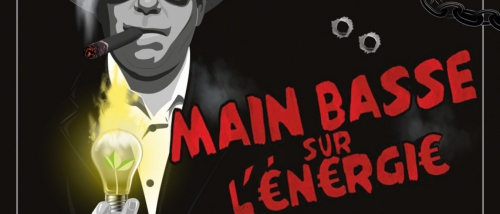

 del.icio.us
del.icio.us Imprimer
Imprimer
 Digg
Digg



