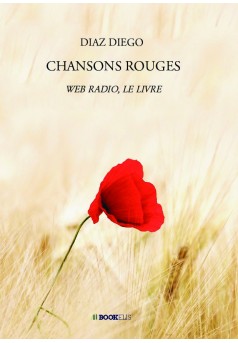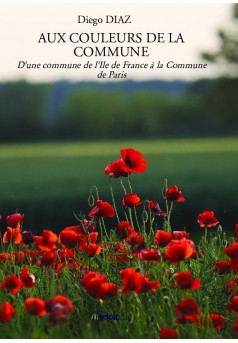Insulté pour avoir dénoncé l'explosion de la violence et les ravages du fondamentalisme religieux, le secrétaire général des Jeunes Communistes (MJCF) détaille dans un entretien à « Marianne » pourquoi, selon lui, la gauche doit se montrer intransigeante sur ces sujets.
Peut-on encore s'attaquer à l'obscurantisme quand on est de gauche ? Il y a de quoi douter, vu le tombereau d'indignations et d'insultes suscité ces derniers jours par le discours laïc d'Assan Lakehoul. Auprès de Marianne, le secrétaire général des Jeunes Communistes (MJCF) revient sur cette affaire, regrettant que sa famille politique ait abandonné l'un de ses piliers : la lutte contre le fondamentalisme religieux.
Marianne : Depuis quelques jours, vous êtes victime d'insultes pour avoir dénoncé les propos rétrogrades d'un influenceur musulman très suivi sur les réseaux. Pouvez-vous revenir sur cette histoire ?
Assan Lakehoul : Tout est parti du plan de lutte contre la montée de la violence chez les jeunes qu'on a dévoilé après les récentes annonces de Gabriel Attal, déconnectées des réalités du terrain. Parmi nos mesures visant à mieux accompagner la jeunesse, il y a notamment la lutte contre le communautarisme et l'obscurantisme religieux.
A LIRE AUSSI : Emmanuel Maurel : "A gauche, des digues ont cédé sur la laïcité"
C'est en développant ce point sur le plateau de BFMTV [ce mercredi 24 avril, N.D.L.R.] qu'on m'est tombé dessus sur les réseaux sociaux. Dans le lot, il y a des musulmans rigoristes, des cathos tradis et, bien sûr, l'extrême droite. Rien de très étonnant. Mais il y a aussi tout une partie des militants soi-disant de gauche (voire d'extrême gauche), soi-disant insoumis, qui se sont attaqués au discours laïc que je tiens et qui, à mon sens, fait partie de nos piliers.
Quelles sont, justement, vos propositions pour lutter contre la violence chez les jeunes ?
C'est un problème complexe, donc il faut jouer sur tous les tableaux. D'un côté, la droite et l'extrême droite pensent que ce n'est qu'une question d'autorité. Elles mentent. De l'autre, une partie de la gauche estime qu'il suffirait de recruter des profs. Elle se trompe. Nous, on est convaincu qu'aucune mesure choc isolée ne pourra régler ce phénomène.
« Il y a aussi une réponse de gauche à apporter sur le fléau de la drogue. »
Ça passe évidemment par les services publics, mais aussi par la lutte contre le retour en force du fait religieux et le narcotrafic. Un mineur délinquant, c'est avant tout un jeune en danger. Il faut donc plus de moyens pour l'aide sociale à l'enfance, plus d'éducateurs, plus d'assistantes sociales, plus de moyens à l'école. Il faut aussi prendre à bras-le-corps la question des violences sexistes et sexuelles, dont on parle peu quand on traite de l'insécurité.
ll y a aussi une réponse de gauche à apporter sur le fléau de la drogue. S'attaquer à la source, aux gros bonnets, plutôt que de faire la chasse aux petits dealers, ce qui ne change pas le problème. Donner des moyens à la police, à la justice. Retracer les financements… En faisant tout ça, on s'apercevra peut-être qu'il y a des banques trop laxistes si ce n'est complices, mais aussi des pays, comme le Maroc, qui jouent un rôle considérable là-dedans.
Quel genre d'insultes recevez-vous et comment analysez-vous cette situation ?
Je me suis fait traiter « d'Arabe de service », de « collabeur », ce genre de choses. Aujourd'hui, beaucoup de militants ne font plus que de la politique avec de l'outrance et de la provocation. Ces gens s'amusent, prennent tout ça pour un jeu, alors que nous, on se bat pour nos convictions. Ce qui me révolte et me choque, c'est qu'une partie de la gauche s'approprie ces méthodes d'intimidation classiques de l'extrême droite.
A LIRE AUSSI : Islamistes, fachos, gauche radicale : il n'y a pas de bonne fatwa numérique
Si cette violence est encore plus relâchée en ligne, elle a des répercussions concrètes dans la vie réelle. Lors de manifestations récentes, on a pu entendre des slogans comme « Tout le monde déteste Fabien Roussel [secrétaire national du Parti communiste français] ». L'année dernière, le 1er-Mai, le stand du PCF (Parti communiste français) avait aussi été pris à partie.
Certains vont même jusqu'à vous comparer à des personnalités d'extrême droite comme Damien Rieu. Comment le prenez-vous ?
Je trouve ça terrible. Ils ont aussi comparé Fabien Roussel à Jacques Doriot… C'est minable, ça les déshonore, eux et la gauche par la même occasion.
N'est-ce pas une preuve que dénoncer les ravages du fondamentalisme religieux, ou encore de la montée de la violence, devient de plus en plus difficile à gauche ?
Je ne vais pas faire dans la langue de bois : je pense surtout que ça devient impossible pour une partie de la direction de La France insoumise. Ils accréditent la fameuse thèse des deux gauches irréconciliables en abandonnant des principes fondamentaux de notre courant politique.
D'ailleurs, vous dénoncez également le fondamentalisme chrétien. A priori, un point de vue pas très Damien Rieu-compatible…
Bien sûr. Et d'ailleurs, les deux influenceurs religieux que j'ai dénoncés m'ont répondu. Le prédicateur musulman a fait une vidéo, tandis que l'abbé Raffray a commenté ma publication. Ce qui est drôle à souligner, c'est que leurs réponses se croisent. Ce qui montre bien que c'est un même sujet. Il y a un lien entre l'extrême droite politique, les catholiques traditionalistes et les fondamentalistes musulmans. Nous, on les dénonce tous pour l'idéologie réactionnaire qu'ils incarnent.
« Ils voudraient nous enfermer dans une société moyenâgeuse. »
Ils prônent une vision du monde sexiste et patriarcale, donnent des leçons sur comment les femmes doivent vivre ou comment les jeunes doivent se comporter… Bref, ils voudraient nous enfermer dans une société moyenâgeuse et là encore, ça a un impact direct sur la vraie vie.
A LIRE AUSSI : "Toute la journée, c'était des insultes" : derrière l'affaire Samara, bêtise, ghetto et réseaux sociaux
Récemment, on a eu des groupuscules identitaires qui sont sortis faire une ratonnade au nom des valeurs chrétiennes et françaises. Mais aussi un adolescent tué parce qu'il discutait de sexe avec sa copine ou une jeune femme morte à cause de sa « réputation ». Il faut bien voir que ces discours religieux en ligne permettent de justifier et légitimer cette violence.
Pourquoi votre famille politique et la gauche de manière générale doivent, selon vous, se montrer intransigeantes sur ces sujets ?
Déjà, car la laïcité est une valeur intrinsèquement de gauche. Elle a été récupérée par l'extrême droite, alors que cette dernière est tout sauf laïque et républicaine. Et s'ils peuvent faire croire l'inverse, c'est notamment parce que la nature a horreur du vide et que la gauche a abandonné sa bataille pour l'émancipation et contre toute forme de domination. L'Internationale, c'est : « Ni Dieu, ni César, ni tribun ».
« Leur gauche Tolbiac, leur gauche Rennes-II ou Mirail, elle est toute petite. »
On a aussi un désaccord de fond avec LFI sur la question du rapport de force et du rôle qu'on veut jouer. Nous, on pense qu'une gauche utile, c'est une gauche majoritaire. Eux, au contraire, veulent radicaliser leur électorat, diviser la jeunesse et, finalement, cliver la société sur de mauvaises bases, qui ne sont pas du tout des bases de classe. C'est très dangereux.
A LIRE AUSSI : Les 2 gauches aux européennes selon le PCF Léon Deffontaines : "À eux la Troïka, à nous la République sociale"
Au PCF, ça ne nous intéresse pas d'incarner une gauche qui ne parle qu'aux centres-villes et aux grandes universités. Leur gauche Tolbiac, leur gauche Rennes-II ou Mirail, elle est toute petite, elle n'ira jamais nulle part. C'est ce que j'appelle aussi la gauche nombriliste, qui n'aspire qu'à prêcher auprès des convaincus. Personnellement, je ne me suis pas engagé pour faire de l'opposition toute ma vie. Je veux pouvoir gagner afin de réellement changer la vie des gens.












 del.icio.us
del.icio.us Imprimer
Imprimer
 Digg
Digg