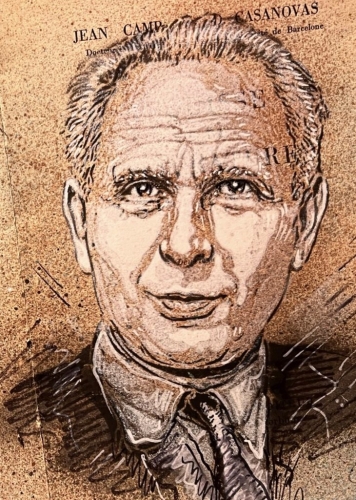Moi qui ai vécu la révolution iranienne de 1978/1979 dans la ville de Mashhad (Nord-Est du pays), où j’enseignais le français au titre de la coopération, j’attire l’attention des divers interprètes du mouvement populaire en cours sur un point qui me paraît essentiel : nul ne peut analyser la situation actuelle sans la relier à cette révolution d’il y a 50 ans qui a poussé progressivement dans la rue toute la population du pays. Jusqu’à 500 000 manifestants dans cette ville où j’habitais, devenue depuis la deuxième ville du pays !
Témoin de ces événements et parfois acteur (même involontaire), j’affirme ici que je ne peux, même un instant, croire que le peuple iranien souhaiterait le retour de la dynastie Pahlavi ! Celle-ci est à jamais discréditée par la répression sanglante infligée à « son » peuple qu’elle prétendait pourtant servir. Celle-ci est pour toujours discréditée par son alignement inconditionnel sur les USA, qui en avaient fait le gendarme du Moyen-Orient. Le peuple n’oublie pas si facilement la trahison, par les Pahlavi, des liens historiques et fraternels de l’Iran avec son environnement arabo-musulman, au seul profit des intérêts coloniaux d’Israël et de l’impérialisme US.
Ce que beaucoup ne semblent pas vouloir voir, c’est que les dernières mobilisations héroïques, en particulier des jeunes et des ouvriers (compte tenu des risques vitaux encourus), s’inscrivent dans le prolongement de la révolution de 78/79. Les réduire, comme le font certains, notamment à la France insoumise, à un mouvement « contre la vie chère », est un coup de poignard porté dans le dos de toutes celles et tous ceux qui (dans leur diversité comme en 78-79) continuent à se battre, notamment sous la bannière « Femme - Vie - Liberté ». Cet aveuglement (volontaire ou pas) gomme de fait la dimension historique de ce mouvement et sa nature politique : « ni dictature du Chah ni régime terroriste des mollahs » !
À l’autre bout de l’échiquier politique travaillent d’autres forces pour nous persuader (et se persuader elles-mêmes) que le fruit serait mûr pour le retour de « REZA II » sur le trône déchu de la dynastie Pahlavi. Il est certes tout à fait exact que Trump et Netanyahou, sous prétexte de programme nucléaire iranien et de démocratie (sic !), travaillent à une nouvelle intervention qui ramènerait le futur monarque dans leurs fourgons. Une situation déjà vécue en 1953, quand la CIA avait remis sur le trône le Chah en exil et chassé du pouvoir le Premier ministre légal Mossadegh. Ce dernier avait eu l’outrecuidance de nationaliser le pétrole. On y revient toujours !
Mais faire croire que ce serait répondre à une demande du peuple n’est que pure manipulation. Il est si facile de « truander » les vidéos, d’y ajouter certains slogans ou de faire croire à la présence massive de l’ancien drapeau royaliste.
La vraie nouveauté du mouvement révolutionnaire actuel est le lâchage du régime des mollahs par les commerçants religieux et conservateurs qui avaient joué un rôle déterminant dans leur installation au pouvoir début 1979.
L’Iran est un pays pluraliste, la révolution de 1978-79 l’était aussi (y participèrent toutes les forces de gauche durant un an avant d’en être de fait exclues). L’avenir de l’Iran passe par l’instauration d’une république pluraliste, démocratique, sociale et laïque.












 del.icio.us
del.icio.us Imprimer
Imprimer
 Digg
Digg