 BIOGRAPHIE
BIOGRAPHIE
Après une enfance passée au Costa Rica, Nathalie Peyrebonne grandit en banlieue parisienne. Elle a été élève de l'École normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Elle est actuellement maître de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle.
Spécialiste de l'Espagne du Siècle d'or (XVIe – XVIIe siècles), ses travaux sur la littérature de l'époque sont en lien avec une étude des sociabilités classiques, et notamment des sociabilités alimentaires (le boire et le manger).
Elle est aussi journaliste littéraire pour la revue Délibéré et pour Le Canard enchaîné,
Ecoutez ici en podcast un entretien exclusif réalisé pour Chansons Rouges Mosaik Radio avec Nathalie Peyrebonne qui présente son œuvre}}}
Romans
-
Rêve général, Phébus, 2013 (Libretto, 2014) (Prix Botul 2013)
-
La silhouette, c'est peu, Phébus, 2015.
-
Votre commande a bien été expédiée, Albin Michel, 2017.
REVE GENERAL
Jean-Claude Lebrun, L'Humanité, Jeudi, 4 Avril, 2013
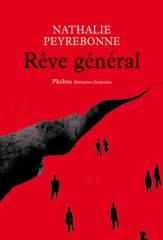 Rêve général, de Nathalie Peyrebonne. Éditions Phébus, 2013, 160 pages, 13 euros, édition Libretto, 7,70 euros
Rêve général, de Nathalie Peyrebonne. Éditions Phébus, 2013, 160 pages, 13 euros, édition Libretto, 7,70 euros
Voici un premier roman joyeux, frais, tonique. Habité par quatre personnages qui sortent de leurs trajectoires et goûtent une liberté nouvelle. Ils s’appellent Louis, Edmond, Céleste et Lucien. Ils sont premier ministre, agent de sécurité dans un bar, conductrice de métro, professeur dans un collège. Et ont en partage de soudain ne plus vouloir jouer le jeu. Comme au tout début du livre, avant qu’eux-mêmes n’entrent en scène, ce footballeur désigné pour tirer un penalty, qui choisit de tourner le dos au ballon et de regagner les vestiaires. Tous, en somme, acteurs d’une manière de révolte douce qui ressemblerait presque à une révolution.
Ce matin du 5 janvier, lendemain inhabituel des vœux du Président (il « n’allait pas écourter ses vacances au soleil pour une allocution télévisée »), Louis a décidé de ne pas sortir de sa chambre à Matignon. Edmond non plus ne se rend pas au travail, il flânera au marché pour assouvir sa passion pour la cuisine. De son côté, Céleste va quitter son poste de conduite, délaisser sa rame à quai et remonter à la surface. Enfin, Lucien plantera en plein cours ses élèves de 4e 3 et partira en balade dans Paris. Un rêve général, qui peut s’entendre aussi comme une grève générale d’un nouveau genre, a pris son essor. Sorte de déraillement délibéré hors des chemins tracés d’avance et des assignations de toutes natures. Tel un refus des règles prétendument naturelles qui régissent nos destinées d’êtres sociaux. L’on suppute en Nathalie Peyrebonne une moderne lectrice de Paul Lafargue et de son Droit à la paresse, paru en 1880. Non pas seulement conteuse des rébellions minuscules, dont les quatre récits peu à peu s’entrecroisent pour composer un véritable roman de l’émancipation, mais critique radicale d’une économie politique et de son idéologie.
Tandis que le Président reprend le vieux refrain des possédants et « s’égosille (...) au boulot, au boulot, au boulot », des êtres renouent sans le savoir avec d’anciennes luttes. Ils partent à la conquête de temps libre, s’arrachent à l’aliénation, montrent qu’il est possible de vivre mieux en travaillant moins. En somme, font revivre la belle idée d’émancipation humaine tant mise à mal par l’ultralibéralisme. « Quelques mythes, quelques rêves, quelques fraternités » retrouvent ici une inespérée vigueur. Car le mouvement rapidement s’élargit, provoquant
« comme une grande panne dans le pays ». Un Mai 1968 à la mode contemporaine, sans concertation, sans organisation, sans revendications formulées, sans références historiques. Mais témoignant de la persistance forte
d’une aspiration. Nathalie Peyrebonne propose le roman
de ce temps inédit, à des années-lumière de la terminologie et des représentations habituelles. Aussi peu conventionnelle que le fut Paul Lafargue à son époque. Un air libertaire souffle ici puissamment.
Le rêve général s’est maintenant installé depuis deux semaines. Plus question de cette rentabilité
et de cette efficacité qui tenaient lieu d’uniques caps.
On respire, on regarde autour de soi, on se regarde
et l’on se parle. Céleste croise ainsi Lucien au moment
où, place Vendôme, celui-ci entartre le Président qui porte le prénom de Wolf : ce personnage régressif, porteur
de la vieille pensée réactionnaire, ne peut évidemment
voir en l’homme qu’un loup pour l’homme. Sous ses allures souriantes, le roman en effet porte loin. Constituant
un salutaire précis de rébellion, contre l’idéologie restauratrice plus que jamais à l’œuvre.











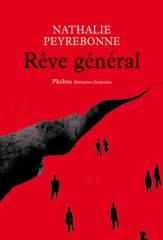

 del.icio.us
del.icio.us Imprimer
Imprimer
 Digg
Digg


