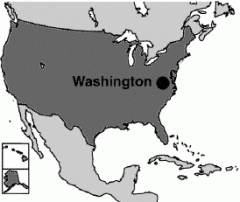21/02/2013
Esclavage moderne aux Émirats
Pourquoi ne parle-t-on jamais de cette réalité du capitalisme mondialisé ?
Le coolie trade est une pratique instaurée par les grandes puissances coloniales à la suite de l’abolition de l’esclavage. Pour compenser la perte d’une main-d’œuvre asservie, l’empire britannique fit appel aux populations les plus misérables d’Asie et institua un système moralement douteux : en échange de leur force de travail, l’État garantit aux travailleurs des salaires de misère, et les invita à travailler dans des conditions de travail telles que les anciens esclaves les avaient fuies.
Dubaï, aujourd’hui symbole de la puissance financière des Émirats, est une ville factice qui a émergé du désert en moins de trente ans. Sa population, forte de quelque 5 % d’Émiratis, est majoritairement composée de travailleurs étrangers : les expatriés occidentaux, au compte de grandes multinationales, et les ouvriers dépêchés pour subvenir à la nouvelle politique de grands travaux, ainsi que des domestiques, souvent des femmes, en provenance des Philippines.
Ces deux derniers groupes sont exploités, et ce sans discrimination de sexe. À l’instar des anciens coolies, ils ont des conditions de travail effroyables : papiers confisqués par leur employeur à leur arrivée à Dubaï, salaires de misère… Le mode opératoire est toujours le même : les travailleurs quittent leur pays natal après qu’on leur a fait miroiter une somme qui leur permettrait de soutenir leur famille. La réalité est toute autre : la plupart des bonnes perçoivent un salaire très inférieur à celui dû et sont fréquemment victimes de viols (1) comme cette jeune Éthiopienne qui s’est suicidée en décembre dernier. Les travailleurs immigrés masculins sont logés à la même enseigne. La tour de Burj Khalifa, du haut de ses 828 mètres, fleuron de la politique de grands travaux, a nécessité l’emploi de plus de 10 000 travailleurs, œuvrant au prestige de la ville pour quelque 2,85 euros par jour, sans filet de sécurité ni harnais. Ces pratiques alarmantes font douter de la véracité du nombre de morts déclaré pendant la construction (un seul), alors que l’ONG Human Rights Watch n’a cessé de dénoncer le surmenage et les suicides des ouvriers. Bâtisseurs du prestige de Dubaï, les travailleurs, le soir venu, sont dérobés aux yeux des touristes dans un bidonville à quelques dizaines de kilomètres du centre-ville.
Rares sont ceux à connaître un sort plus enviable que leurs ancêtres coolies. Ces travailleurs pauvres sont les esclaves modernes, victimes corvéables de leur misère natale et d’un capitalisme dément. Avec la mondialisation, les pays de la péninsule Arabique disposant d’une nouvelle manne financière se sont lancés dans une modernisation effrénée pour s’imposer comme un modèle régional, un acteur mondial, et surpasser le modèle occidental des pays dits développés. Dubaï est l’image même de tous les excès de nos sociétés d’hyperconsommation, au prix du sang et des larmes des travailleurs bafoués.
 Le non-respect des droits de l’homme est symptomatique de la région. À l’heure où Dubaï réussit à s’imposer à l’international, cette mentalité, cette conception de l’autre, permet de douter de la légitimité d’un modèle cynique qui s’appuie sur la négation de l’autre, une traite immonde, une forme d’esclavage moderne. Ce modèle qui prône la puissance de l’argent réduit l’autre à une simple bourse, ou une force de travail qu’il convient de réduire à l’impuissance.
Le non-respect des droits de l’homme est symptomatique de la région. À l’heure où Dubaï réussit à s’imposer à l’international, cette mentalité, cette conception de l’autre, permet de douter de la légitimité d’un modèle cynique qui s’appuie sur la négation de l’autre, une traite immonde, une forme d’esclavage moderne. Ce modèle qui prône la puissance de l’argent réduit l’autre à une simple bourse, ou une force de travail qu’il convient de réduire à l’impuissance.
(1) Lire le dossier de Courrier international n° 1130, juin 2012.
18:15 Publié dans Cactus, Planète, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippines, esclavage, libres-échanges, dubaï, burj khalifa |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
04/02/2013
Mariela Castro Espin: «Cuba surprend toujours, même nous, nous surprenons»
 Fille du président Raul Castro et de Vilma Espin, grande figure de la révolution cubaine, aujourd’hui disparue, Mariela Castro Espin, âgée de quarante-neuf ans, est directrice du Centre national d’éducation sexuelle cubain (Cenesex). Rebelle, militante opiniâtre des droits des homosexuels et des transsexuels, longtemps discriminés, elle est à l’origine d’importants changements les concernant. Entretien.
Fille du président Raul Castro et de Vilma Espin, grande figure de la révolution cubaine, aujourd’hui disparue, Mariela Castro Espin, âgée de quarante-neuf ans, est directrice du Centre national d’éducation sexuelle cubain (Cenesex). Rebelle, militante opiniâtre des droits des homosexuels et des transsexuels, longtemps discriminés, elle est à l’origine d’importants changements les concernant. Entretien.
Vous menez depuis plusieurs années un combat en faveur de la liberté d’orientation sexuelle et de l’identité du genre à Cuba. Où en êtes-vous actuellement ?
Mariela Castro. Nous sommes dans un bon moment. C’est le résultat d’un travail de plusieurs années. Depuis la création de la Fédération des femmes cubaines, dans les années soixante, des chemins ont été ouverts et ont permis peu à peu de désarticuler les préjugés liés à la sexualité et au genre. Ce travail nous a permis d’aborder avant de les affronter d’autres formes de discriminations qui existent tous les jours dans notre culture et notre société.
S’agissant de l’homophobie, changer la façon de penser de toute une société n’est pas facile. Mais chaque action peut réussir, par le biais d’une incidence, dans le domaine éducatif, s’appuyant sur les moyens de communication, télévision et radio, dans le cadre d’une stratégie complexe. Il faut être partout. Cela implique la présence d’une volonté politique pour opérer tous ces changements et qu’elle soit exprimée par le biais d’une loi concrète, explicite, qui puisse s’emparer de ce problème.
Vous avez élaboré un projet de loi, avance-t-il ?
Mariela Castro. Une de nos propositions législatives concerne le Code de la famille, code civil approuvé en 1975, à l’initiative de l’organisation des femmes, et largement discuté. Ce Code fonctionne mais, depuis plus de quinze ans, nous participons, en tant qu’institution, au combat de la Fédération des femmes cubaines pour le transformer afin de mieux garantir les droits des femmes, des enfants, des handicapés et des personnes âgées. Dans cette logique, le Cenesex propose un nouvel article incluant la libre orientation sexuelle et l’identité des genres.
Ce n’est pas un Code dont l’accomplissement est obligatoire, mais il sert à établir des valeurs au sein de la famille. J’ajoute que ce Code, une fois qu’il sera voté, devra inclure par la suite d’autres éléments parce que beaucoup d’autres législations vont aussi changer. Avec la nouvelle loi, les transsexuels auront le droit de modifier leurs documents d’identité. Ce qui suppose qu’ils soient soumis à une intervention chirurgicale pour changer de sexe. En 2008, nous avons déjà réussi, sous l’égide du ministère de la Santé, à établir des procédures d’assistance de santé spécialisée dont les personnes transsexuelles ont besoin, y compris pour le changement de sexe.
Ces interventions sont totalement gratuites et rentrent dans le budget de l’État. Nous sommes le seul pays à l’avoir fait complètement. Mais on ne change pas encore les identités, s’il n’y a pas d’intervention chirurgicale. Tel est le projet de loi. Il est rédigé, il ne reste plus qu’à le présenter à la discussion politique.
Ne vous êtes-vous pas heurtée à des obstacles d’ordre politique et religieux ?
Mariela Castro. Les freins ne sont pas les préjugés de toute la population. Dans cette société hétérogène dans laquelle nous vivons, dans les églises, et même dans d’autres structures existantes, des gens nous soutiennent et d’autres pas. Des responsables religieux sont d’accord, d’autres non. Il n’y a pas de confrontation avec le Parti communiste et son département idéologique, ni avec le médiateur qui a été très attentif et respectueux.
Nous leur avons exposé nos arguments et ils ont eux-mêmes dialogué avec les religieux qui n’étaient pas d’accord. Il n’y a pas de malaise, des soucis oui, mais pas de malaise. Nous avons parlé de notre préoccupation à ne pas transgresser les personnes, à ne pas leur porter atteinte. Seul le dialogue peut régler les contradictions. Mais il y a des points sur lesquels nous ne céderons pas, par exemple, les opérations pour le changement de sexe.
Nous le considérons comme un traitement de santé et là, nous ne transigerons pas. Il faut le faire, c’est un droit. Nous savons que, par rapport au mariage des personnes de même sexe, plusieurs églises ne l’approuvent pas. Plutôt que de créer une catégorie avec le mariage homosexuel, ce n’est pas nécessaire, nous proposons une union légale qui puisse garantir les droits des personnes de même genre. Elles ne doivent pas être discriminées, ni exclues.
L’objectif est qu’elles aient les mêmes garanties que les couples hétérosexuels, notamment du point de vue du patrimoine. Notre proposition est l’union consensuelle : les couples de même sexe ont les mêmes droits que les couples de sexe différent. Il n’y a pas de différence. On ne parle pas d’adoption.
"Une société en transition socialiste telle que la société cubaine doit être vigilante à ne pas reproduire les mécanismes de domination préexistants"
Même si on pouvait l’envisager, ce que je pense, les résistances sont là. Au fur et à mesure que notre population avance et qu’elle surmontera ses préjugés, ce ne sera pas un souci. Nous avons observé le processus de progrès législatifs dans d’autres pays, même européens, et ils ont dû procéder de la même manière, commencer par une chose d’abord et passer à une autre.
En ce qui nous concerne, nous ne proposons ni mariage, ni adoption des mineurs. Nous avançons dans la reconnaissance des droits de la population et du genre.
S’agit-il d’une bataille d’émancipation dans le cadre du processus révolutionnaire cubain ?
Mariela Castro. Bien entendu ! C’est la plate-forme, le scénario. Moi, j’ai une formation marxiste qui me permet de comprendre la société dans laquelle je vis et ce que nous entendons par socialisme. Une société en transition socialiste telle que la société cubaine doit être vigilante à ne pas reproduire les mécanismes de domination préexistants.
Je pense que cette bataille pour la dignité pleine des personnes est en cohérence avec un processus de transformation sociale pour l’émancipation des êtres humains qu’est le socialisme. Cette idée, on ne peut pas la perdre de vue. Sans elle, justement, on continue ailleurs à reproduire les mêmes schémas avec les femmes, les homosexuels ou les immigrants.
Pour la première fois dans l’histoire du PCC, dans le document qui sera présenté à la conférence nationale en janvier 2012, on parle des droits à l’orientation sexuelle. On le discute dans toute la population. Nous, au Cenesex, nous avons fait pas mal de suggestions, notamment d’y inclure le concept d’identité des genres et non seulement l’orientation sexuelle. Car, avec cette identité, on a la protection des personnes par rapport au genre.
Vous parlez du respect de la personne humaine et de ses droits pleins et entiers, n’y a-t-il pas aussi d’autres combats à mener sur la liberté d’expression ?
Mariela Castro. Personne ne peut nous empêcher de nous exprimer. Ça, c’est un mythe. Personne ne peut se taire à Cuba. Le système colonial espagnol n’a pas pu nous faire taire, ni le colonialisme nord-américain, pas plus que la dictature militaire imposée par les États-Unis. Nous avons toujours dit ce que nous pensons. Chacun est maître de ce qu’il dit, de ce qu’il fait. Il faut aussi en assumer la responsabilité.
La liberté, c’est assumer ses responsabilités, de jouer le tout pour le tout, de prendre des décisions. Et c’est vrai partout. Par rapport à la liberté de la presse, je serais tenté de dire que nulle part elle n’existe. Elle dépend de ceux qui maîtrisent les moyens de communication, les propriétaires, les groupes financiers, les actionnaires, les éditeurs, la politique d’État.
À Cuba, il y a un grand nombre de blogs indépendants et des milliers de blogueurs intéressants, courageux dans leurs remises en questions tout en assumant leurs responsabilités, sans apport d’argent d’un pays qui veut nous maîtriser, nous harceler. Certes, un petit nombre d’entre eux reçoivent de l’argent du gouvernement des États-Unis pour inventer des histoires contre Cuba.
"Qui connaît vraiment, autrement que par la déformation, la réalité quotidienne des Cubains et leur capacité d'avancer?"
Depuis plus de cinquante ans, nous subissons une véritable guerre idéologique dans le but d’achever la révolution. La campagne médiatique contre Cuba est de plus en forte. Le département d’État américain y a injecté plus de 20 millions de dollars. Avec cet argent, il paie des blogueurs, des journalistes nord-américains ou européens, pour nous discréditer. Mais qui connaît vraiment, autrement que par la déformation, la réalité quotidienne des Cubains et leur capacité d’avancer ?
Concernant Cuba, je souhaiterais une presse plus critique, qui fasse un vrai travail d’enquête. Et critiquer ne veut pas dire manquer de respect si cela répond à l’éthique journalistique.
Un seul parti dominant la politique cubaine, est-ce suffisant ?
Mariela Castro. Bon ! Celui qui a inventé le parti unique, ce n’est pas Fidel, mais José Marti. Face à la menace étrangère, il n’y avait pas d’autre option que de rallier la volonté des Cubains, ce que Marti appelait le «parti révolutionnaire». Le PCC a hérité de ce parti révolutionnaire créé par José Marti.
Grâce à l’unité dans ce parti unique, on a réussi à gagner l’indépendance vis-à-vis de l’Espagne, mais elle a été frustrée du fait de l’intervention nord-américaine. Les Cubains se sont encore unis pour accéder à leur souveraineté. C’est pourquoi c’est un parti qui comprend énormément de diversité, inclut les religions et a différentes positions. Mais le principe est très clair sur la souveraineté nationale, la défense de cette souveraineté, le développement du pays sur la base de la justice et de l’équité sociale.
Voilà, c’est ça, le projet. Le peuple cubain a ce qu’il veut. Le PCC ne postule pas aux mandats électifs, c’est le peuple dans les quartiers qui décide et postule.
Quel est le sens de la formule de votre père, Raul Castro, quand il dit : il faut avancer « pas à pas » ?
Mariela Castro. Tout changement brusque peut être d’une grande irresponsabilité. Le processus de construction et le changement d’état d’esprit exigent du temps, beaucoup plus qu’une consultation populaire. Quand il dit «pas à pas», c’est consolider chaque pas que l’on fait, ne pas être superficiel et n’oublier personne. Il m’a dit à plusieurs reprises d’essayer d’avoir un point de vue éducatif auprès de la population avant de l’amener sur un projet de loi, sinon celle-ci ne sera jamais votée.
Ce que nous avons fait en sensibilisant les Cubains, les députés. Lui travaille dans ce sens, je crois que c’est un bon stratège. Des gens aimeraient que Cuba se presse dans les changements. Lui répond : «Je voudrais me presser, mais je ne peux pas imposer.» Il faut trouver un certain consensus, tout au moins, pouvoir compter sur la majorité.
Quelles sont les priorités pour les Cubains aujourd’hui ?
Mariela Castro. Des tas de choses ! Surtout il s’agit de renforcer notre économie pour être autosuffisants. D’une certaine manière, le tourisme peut nous aider à réaliser des progrès. Malgré le blocus économique et commercial envers Cuba, le tourisme nord-américain a augmenté de façon incroyable. Les Nord-Américains ont envie de venir à Cuba, nombreux arrivent par des voies détournées pour ne pas être pénalisés aux États-Unis.
Le fait d’être sanctionnés par la loi du blocus est, au passage, est une violation des droits des citoyens nord-américains et de la Constitution. Alors, oui, il nous faut avancer, créer de nouveaux mécanismes. Et ça vient ! Cuba surprend toujours, même nous, nous surprenons.
À son élection, Obama avait nourri quelques espoirs vis-à-vis de Cuba. Mais rien n’a changé…
Mariela Castro. Obama ne s’est pas acquitté des responsabilités de son programme. Les États-Unis continuent à être hégémoniques. Ils sont la police du monde, ils nous contrôlent tous. Je constate que l’Europe leur a emboîté le pas en établissant une position commune contre Cuba. C’est d’un cynisme ! Cela démontre qu’elle est subordonnée à la politique des États-Unis.
Vous êtes la fille de Raul et la nièce de Fidel. L’héritage n’est-il pas trop lourd à porter ?
Mariela Castro. Parfois oui, parfois non ! Non pour tout ce qu’on vous fait porter de façon symbolique par rapport à l’héritage familial. Certains inventent une responsabilité qu’ils aimeraient me voir endosser, qui ne me correspond pas ; d’autres veulent que, dans l’avenir, je sois présidente de la République. S’ils me connaissaient bien, ils ne le voudraient pas ! Cela n’a rien à voir avec mes aspirations.
D’autre part, j’ai reçu beaucoup de gratifications à Cuba et dans de nombreux pays. On m’a dit des choses très belles, pleines d’admiration, de respect, d’affection et de remerciements. On m’a raconté des anecdotes de mes parents que j’ignorais. Alors je me sens fière de la famille dans laquelle je suis née. Ils m’ont transmis des valeurs, une éthique. Et si je suis rebelle, ce n’est pas de ma faute, c’est de la leur. Ils l’ont été beaucoup plus que moi et continuent de l’être, c’est pourquoi j’ai beaucoup d’admiration. Mais moi, je ne veux pas être comme eux.
À lire :
--> Raul vu par Mariela...
Entretien réalisé par Bernard Duraud pour l'Humanité
19:24 Publié dans Actualités, Connaissances, Entretiens, Planète | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : cuba après fidel castro, education, droit, cuba, raul castro, fidel castro |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
25/01/2013
Les 100 personnes les plus riches ont un revenu annuel qui pourrait permettre d'éradiquer quatre fois la pauvreté
 INÉGALITÉS – Du 23 au 27 janvier, les grands de ce monde se retrouvent à Davos, petite station de sports d'hiver du canton des Grisons en Suisse, pour la traditionnelle réunion annuelle du Forum économique mondial.
INÉGALITÉS – Du 23 au 27 janvier, les grands de ce monde se retrouvent à Davos, petite station de sports d'hiver du canton des Grisons en Suisse, pour la traditionnelle réunion annuelle du Forum économique mondial.
Les semaines précédant le sommet, lobbys et ONG ont coutume de mettre en lumière quelques-uns des problèmes les plus urgents de la planète à grands coups de rapports et de mises en perspectives déroutantes. À quelques jours de la 43e édition du rassemblement, l'organisation humanitaire Oxfam n'a pas dérogé à la règle en dévoilant son rapport sur les inégalités, "The cost of inequality : how wealth and income extremes hurt us all". Avec une idée choc: le revenu annuel des 100 personnes les plus riches pourrait permettre d'éradiquer quatre fois la pauvreté.
Un "new-deal" pour lutter contre les inégalités ? Dans son rapport, la confédération d'ONG britannique cite l'Index des Millardaires de Bloomberg dont la dernière version estime à 240 milliards de dollars, le revenu net des 100 personnes les plus riches du monde en 2012.
Barbara Stocking, directeur-général d'Oxfam, indique qu'au cours des vingt dernières années les personnes les plus aisées de la planète, qui représentent à peine 1% de la population mondiale, ont vu leurs revenus augmenter de 60%.
A l'inverse, les plus démunis tentent de survivre tant bien que mal avec moins d'un dollars et 15 cents par jour. Citant le Brésil en exemple de pays qui a su allier une forte croissance à une réduction des inégalités, l'organisation souligne également que l'accroissement de l'écart entre riches et pauvres va à l'encontre de toute productivité économique et met en péril la démocratie en exacerbant les tensions sociales.
Aussi, Oxfam somme-t-il les dirigeants mondiaux à s'engager dans un "new-deal mondial" pour ramener les inégalités à leur niveau de 1990 en luttant contre l'extrême richesse (fermeture des paradis fiscaux, fiscalité plus agressive, taux minimum d'imposition pour les entreprises à échelle mondiale, gratuité des services publics).
Un cri d'alarme qui sonne comme un avertissement à destination de la cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement et des chefs d'entreprises et décideurs économiques qui sont attendus dans la station suisse à partir de mercredi pour débattre de la relance de l'économie mondiale et des conflits au Mali et en Syrie.
18:51 Publié dans Actualités, Economie, Planète | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pauvreté, richesse, monde, inégalités |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
04/01/2013
ETATS UNIS : UNE DETTE DE MOINS EN MOINS GERABLE
L’intensité et l’âpreté des débats entre la Maison-Blanche et les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, soulignent la difficulté croissante à gérer une dette dont le gonflement incessant est une menace pour les équilibres outre-Atlantique mais aussi pour le reste de la planète.
Grâce aux privilèges du dollar, les États-Unis peuvent en effet s’endetter à très bon compte en recyclant les formidables excédents accumulés sur l’Oncle Sam ici et là, de la Chine au Japon ou à l’Allemagne. Avec un risque majeur évident pour l’ensemble de ce système, rouage clé de la domination de la superpuissance, au cas où cette boursouflure finirait par nourrir une défiance croissante et par provoquer un reflux des placements libellés en dollars. Ce qui conduirait à une inévitable hausse des taux d’intérêt de la réserve fédérale et à une réaction en chaîne terrible pour l’activité aux États-Unis et dans le monde.
D’où l’enjeu majeur que constitue la question de la viabilité de la dette. En 2012, on restait sur un rythme de croissance de l’endettement identique à celui des années précédentes, avec un déficit budgétaire à 1 330 milliards de dollars (1 050 milliards d’euros), dépassant encore les 8 % du PIB. Le sauvetage public du système financier, lors du krach de 2007-2008, continue de peser très lourd. Comme l’explosion des dépenses militaires.
 Sur les dix dernières années, le budget du Pentagone a quasiment doublé, passant de 400 milliards de dollars en 2001 à plus de 750 milliards aujourd’hui. Ce qui correspondait, en 2011, à 41 % du total des dépenses militaires mondiales. Hormis quelques nuances, un consensus paraît acquis pour le maintien de l’investissement dans ce formidable appareil militaro-industriel.
Sur les dix dernières années, le budget du Pentagone a quasiment doublé, passant de 400 milliards de dollars en 2001 à plus de 750 milliards aujourd’hui. Ce qui correspondait, en 2011, à 41 % du total des dépenses militaires mondiales. Hormis quelques nuances, un consensus paraît acquis pour le maintien de l’investissement dans ce formidable appareil militaro-industriel.
Le cœur de la dispute qui va continuer d’alimenter la chronique pendant plusieurs semaines porte bien davantage sur les coupes qui seraient devenues incontournables dans les budgets sociaux.
Les républicains radicalisés y répondent par un intégrisme de marché, en hurlant contre l’assistanat. Barack Obama et les démocrates y résistent, tout en laissant clairement entendre, eux aussi, qu’un « effort de tous est nécessaire ».
Comme au lendemain de 2008, on tente ainsi de bricoler le sauvetage d’un système en crise, relais des dominations monétaires et militaires de la superpuissance. En présentant l’essentiel de l’addition aux salariés et à la masse des citoyens des États-Unis.
19:27 Publié dans Actualités, Economie, International, Planète | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : croissance, dette, etats-unis, barack obama |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
02/11/2012
Le bras d'honneur de Gérard Longuet scandalise des responsables algériens
 "Droite française bête et méchante", "voyous" ou "réactions honteuses", dénonçaient des responsables algériens vendredi dans la presse après le bras d'honneur de l'ex-ministre français de la Défense Gérard Longuet sur une repentance française envers l'Algérie.
"Droite française bête et méchante", "voyous" ou "réactions honteuses", dénonçaient des responsables algériens vendredi dans la presse après le bras d'honneur de l'ex-ministre français de la Défense Gérard Longuet sur une repentance française envers l'Algérie.
Pour le Front de Libération Nationale (FLN, parti présidentiel), la réaction de l'ex-ministre de Sarkozy "illustre parfaitement les actions de ce courant durant la colonisation, qui avait dans sa grande majorité soutenu les thèses développées par l'OAS", organisation extrémiste armée pour l'Algérie française. "On a toujours dit que cette droite française était bête et méchante. Elle est colonialiste dans l'âme", déclare le porte-parole FLN, Aïssa Kassa, à d'El-Watan Week-End (francophone).
Pour Lakhdar Benkhellaf, porte-parole du Front pour la justice et la démocratie (islamiste radical), "ces réactions sont honteuses et sont une véritable insulte jetée à la face du peuple algérien. Les Français doivent savoir que nous ne nous contenterons pas de la reconnaissance partielle des massacres d'Octobre 1961 faite par le président Hollande", affirme-t-il.
Zohra Drif, combattante de la Libération et vice-présidente du Sénat, dénonce le "mépris" français: "J'ai toujours affirmé que la France coloniale était ce qu'il y avait de plus hideux".
Le président de la Fondation du 8 Mai 1945 (date de massacres d'Algériens à Sétif), Abdelhamid Salakdji, prévient que "la France a intérêt à accepter de faire acte de repentance avant qu'il ne soit trop tard", sinon elle ne pourra pas "avoir de relations apaisées avec l'Algérie".
Côté presse arabophone, les critiques vont bon train. "Les responsables politiques voyous de la droite française ont répondu de manière humiliante" à une demande de repentance, s'est insurgé en Une le quotidien populaire Echorouk, évoquant un "geste abominable, inhumain" et un acte "irresponsable".
El-Khabar rappelle que Gérard Longuet a assumé son bras d'honneur jeudi 1er novembre, date du 58e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, alors que l'Algérie célèbre cette année le cinquantenaire de son indépendance et attend une visite de François Hollande dans un mois.
Publié par l'Humanité
16:24 Publié dans Actualités, International, Planète | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ump, algérie, fn, marine le pen, guerre d'algérie, extrême-droite, front national, présidentielle 2012, gérard longuet, gilbert collard |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | |