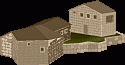Justice . Le CDR, structure publique, devra payer 285 millions à l’homme d’affaires. Ayrault et Bayrou dénoncent « la protection » accordée par Sarkozy.
Justice . Le CDR, structure publique, devra payer 285 millions à l’homme d’affaires. Ayrault et Bayrou dénoncent « la protection » accordée par Sarkozy. Après treize ans de procédure, l’affaire Tapie rebondit encore. Le tribunal arbitral chargé de solder le litige opposant, dans le dossier Adidas, Bernard Tapie et le CDR (structure d’État chargée de gérer le passif du Crédit lyonnais), a condamné ce dernier à verser 285 millions d’euros à l’ancien homme d’affaires.
Bernard Tapie, qui s’estimait floué d’une plus-value importante réalisée par la banque lors de la vente d’Adidas en 1993, bénéficie donc d’une indemnisation record, ponctionnée de surcroît sur les deniers publics.
Cette décision unique dans notre pays remet en cause le jugement de l’autorité suprême qu’est la Cour de cassation, ayant rendu un arrêt le 09/10/2006 qui donnait tord à Tapie. C’est substitué alors un tribunal d’exception composé de Pierre Mazeaud, Denis Bredin et Pierre Estage (dont chaque membre a reçu pour cette mission 300 000 €) qui a rendu un jugement très favorable à Bernard Tapie, qui est secret et contraire à une décision de justice rendu clairement « au nom du peuple français ».
Pour Jean-Marc Ayrault cette affaire « ramène à des années de gabegie » alors qu’« aujourd’hui, l’argent public est rare », il s’agit « d’y voir clair compte tenu des conditions un peu obscures du versement ».
Didier Migaud, président socialiste de la commission des finances, a déclaré vouloir notamment comprendre pourquoi la justice de la République a été dessaisie au profit du tribunal arbitral, l’instance qui a décidé d’indemniser grassement Bernard Tapie avec de l’argent public.
Derrière cette largesse, PS et Modem voient la main de Sarkozy. « On a l’impression que, derrière, l’État est à la manoeuvre », a lâché Jean-Marc Ayrault sur France Info. Pour François Bayrou, « chaque fois que Nicolas Sarkozy a été soit au ministère des Finances, soit à la présidence de la République, comme par hasard des protections se sont déclenchées à l’endroit de Bernard Tapie. Cela envoie un message très simple : si vous êtes avec moi, vous êtes protégé et vous n’aurez qu’à vous féliciter des libéralités dont vous ferez l’objet par l’État ».
Le leader du Modem a souligné que 285 millions représentent la totalité de tous les salaires annuels des 15 000 postes d’enseignants qui vont être supprimés l’an prochain.
Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen alertent sur cette dérive affairiste, où argent, politique et judiciaire s’entremêlent dangereusement : « Une telle opération, concernant un ancien ministre, homme médiatique et politique, soutien affiché de l’actuel président de la République, est révélatrice des pratiques politiques actuelles. Comment ne pas faire le lien avec les tentatives de débauchage, vote par vote, à l’occasion du Congrès du Parlement, relatif à la révision constitutionnelle ? »












 del.icio.us
del.icio.us Imprimer
Imprimer
 Digg
Digg