15/11/2017
Lydie Salvayre : « Cette part de nuit, d’étrangeté, est en chacun de nous »
 Entretien réalisé par Sophie Joubert, L'Humanité
Entretien réalisé par Sophie Joubert, L'Humanité
Prix Goncourt 2014 pour Pas pleurer, Lydie Salvayre signe une tragédie moderne sur le populisme et la haine de l’autre, ancrée dans un village du sud de la France. Entretien.
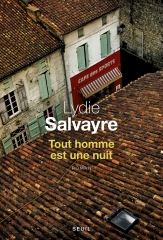 Tout homme est une nuit est-il né d’un mouvement de colère ?
Tout homme est une nuit est-il né d’un mouvement de colère ?
Lydie Salvayre Je sors d’une période où me sont tombés dessus simultanément le Goncourt et la maladie. Pendant une saison, j’ai été « les cailloux et la boue noire », comme je le dis dans le texte. Le désert, aucun goût pour rien. Je me suis dit que l’impulsion ne reviendrait peut-être pas. Et puis est arrivée la campagne présidentielle. Pas un jour ne passait sans que j’entende une bassesse, une invective, un propos xénophobe ou d’exclusion. Je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à faire mes petits romans, comme si de rien n’était. Je ne pouvais pas et ne voulais pas me dérober, même si je tiens en suspicion la littérature qui surfe sur les événements présents pour aller à l’émotion et faire du réalisme à bon compte. Je suis souvent dans le désir du monde et dans le désir de retrait. Cette fois je me suis dit qu’il fallait y aller. À certaines périodes historiques, d’autres l’ont fait : Malraux pendant la guerre d’Espagne, Charles Péguy ou Zola pendant l’affaire Dreyfus… Me sont venues des questions vieilles comme le monde : pourquoi les hommes reportent-ils leurs inquiétudes sur l’intrus, sur l’étranger, plutôt que de s’en prendre à la racine de leur mal ?
Comment traiter aujourd’hui la question archaïque du bouc émissaire ?
Lydie Salvayre Depuis que j’ai terminé le livre, je lis beaucoup sur le populisme. La victime émissaire est légèrement différente des autres, presque conforme mais pas vraiment. Tout est dans le presque. Selon René Girard (1), elle doit présenter des caractères enviables ou odieux. Mon narrateur a les deux, il est enviable car il ne travaille pas, et son teint un peu bronzé le rend haïssable. Ces choses insignifiantes vont devenir peu à peu des preuves irréfutables, à cause d’une espèce de déraison qui s’empare des uns et des autres, un déchaînement des passions. Mais il me ferait horreur d’être dans le camp du bien. J’essaie de semer des indices pour éviter d’opposer le pauvre exclu à l’infâme populiste. Dans le livre, l’étranger n’est pas pure victime, il est enfermé dans des pratiques citadines, qui séparent le public et le privé. Cette barrière est beaucoup moins étanche à la campagne. Mon narrateur s’exprime bien, il peut apparaître comme un érudit, appartenant à l’élite. De l’autre côté, le village se meurt, déserté par l’industrie. Ses habitants ont le sentiment d’être les derniers représentants d’un monde qui s’achève. Ils essaient de faire groupe, tentent de maintenir un collectif.
La construction du roman alterne deux voix, celle du narrateur, l’étranger, sous forme de journal intime et celle des villageois, dans le café. Le personnage d’Augustin, qui arrive plus tard, incarne-t-il une autre voix possible ?
Lydie Salvayre Je ne peux pas écrire tant que je n’ai pas de forme. J’ai tenté la simultanéité, ce qui est impossible en littérature, contrairement à la musique. Augustin n’est ni dans un camp ni dans l’autre. Il représente une France qui ne serait pas dans le ressentiment ou sur la défensive. C’est peut-être une voix idéale, utopique, celle que j’appelle de mes vœux. Il fait partie de ceux que j’appelle les idiots sublimes, un personnage littéraire que j’aime entre tous : le prince Mychkine de Dostoïevski, le brave soldat Schweyk de Brecht, Plume de Michaux, ou le Quichotte. Leur bonté est tellement exceptionnelle qu’elle en paraît incongrue, déconcertante et même scandaleuse. Je ne m’étais jamais autorisé cette figure. Quand Augustin arrive, la logique du roman se poursuit mais ce personnage me permet de respirer entre ces deux camps presque symétriques, qui sont dans un parfait non-dialogue. Un réseau de survie minuscule va se créer et s’avérer efficace face aux déchaînements des passions tristes dont parle Spinoza.
Votre narrateur est, comme vous, d’origine espagnole, et transfuge de classe. Votre histoire de fille d’ouvriers, républicains espagnols arrivés en France pendant la guerre d’Espagne, a-t-elle influencé ce texte ?
Lydie Salvayre Mon narrateur, comme moi, est inscrit dans une histoire familiale qui le rend infiniment sensible à la question de l’étranger. Elle a plusieurs sens : l’étranger dans la cité, parce qu’il est fou ou mal adapté, notre inconscient comme étranger, la maladie comme corps étranger. Le titre du roman dit cette part de nuit, d’étrangeté en chacun de nous. Je suis fille d’ouvriers, d’Espagnols, et comme mon narrateur j’ai ressenti cette honte des origines. Le sentiment que je m’exprimais mal, que mes parents étaient pauvres, que je vivais dans un HLM, était si violent que je n’ai pas pu en faire œuvre jusqu’à ce livre. Il aura fallu soixante-dix ans pour que je m’autorise à en parler. Je me suis tellement battue pour essayer de bien m’exprimer, de bien écrire, de bien me tenir. Nos parents nous ont beaucoup aidées, mes sœurs et moi. Ils voulaient que nous soyons plus républicaines que les républicains, plus laïques que les laïques. Peut-être avons-nous fait tant d’efforts que c’est resté très douloureux, même aujourd’hui. Il y a toujours un angle mort. Je crèverai avec ça.
Votre narrateur dit qu’il est passé maître dans l’art de dissimuler, ses origines et la maladie…
Lydie Salvayre S’arracher aux origines est une entreprise de dissimulation. L’accent, les manières de table sont à vie en nous mais on peut les dissimuler. J’ai vécu dans la communauté des réfugiés politiques espagnols. On entendait des blagues sexuelles à n’en plus finir. J’ai toujours gardé le goût du mauvais goût, de la grossièreté. Quevedo est un exemple parfait de ce qu’est pour moi le baroque : une langue très érudite et extrêmement populaire, voire vulgaire, qui va vers le bas autant que vers le haut. Je crains que, pour quelqu’un de bien né, en ville, cette espèce de vulgarité banale dans laquelle j’ai baigné enfant, celle des cafés de village que je décris dans le roman, soit prise comme une caricature. Tant pis !
Pourquoi ce vers du Cimetière marin de Valéry, qui revient dans le livre : « Le vent se lève, il faut tenter de vivre » ?
Lydie Salvayre Pendant la maladie, on s’accroche à des petites choses. On ne lâche pas. La maladie ne recentre pas, ne fait pas grandir humainement. On est malheureux, c’est tout. Pendant quelque temps, mon narrateur est enfermé par son état. Puis il expérimente qu’il ne peut pas penser seul. On ne pense que parmi les autres, disait Deleuze. C’est la belle théorie du rhizome. L’un de mes personnages dit qu’il voudrait vivre comme Thoreau, au milieu de la nature. Mais si les mots ne se frottent pas à ceux des autres, ils sont ravalés par le cerveau et font une bouillie informe, cette idée m’est assez chère. La parole lie et sépare. Or, dans le café du livre, ils disent tous la même chose et donc ne se parlent pas. La parole est fondée sur l’altérité.
11:24 Publié dans Arts, Connaissances, Entretiens, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lydie salvayre, tout homme est une nuit |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
07/11/2017
Éric Vuillard : « Ce qu’on appelle fiction participe à la structure de notre savoir »
 Le lauréat du Goncourt est Eric Vuillard pour son livre L'Ordre du jour, publié par Actes Sud. Le journal l'Humanité avait réalisé un entretien avec l'auteur le 05 mai 2017.
Le lauréat du Goncourt est Eric Vuillard pour son livre L'Ordre du jour, publié par Actes Sud. Le journal l'Humanité avait réalisé un entretien avec l'auteur le 05 mai 2017.
Son dernier livre traite d’un épisode de l’installation des nazis au pouvoir et de l’Anschluss qui s’ensuivit. Il tient que toute narration est un montage et, à partir d’exemples illustres, il analyse sous tous les angles la différence entre la description du monde et la pensée de l’auteur.
À l’occasion de la publication de l’Ordre du jour, le romancier nous parle ici, au fil d’une passionnante conversation d’atelier, de sa conception de la littérature et des rapports qu’elle entretient avec l’histoire.
Ce dernier roman, l’Ordre du jour, comme 14 Juillet, qui traitait en détail de figures du peuple en ce jour entre tous fondateur, et comme Congo, dont le sujet était la conférence de Berlin en 1885 où fut décidé le découpage de l’Afrique au profit des puissances coloniales, s’attache à suivre pas à pas quelques-unes des journées capitales allant du 20 février 1933, quand les capitaines d’industrie allemands passèrent à la caisse en faveur des nazis, à mars 1938. Pourquoi avoir privilégié ces dates ?
Éric Vuillard Dès que l’on raconte un épisode de l’histoire, le temps n’est plus une unité de mesure et toute narration est un montage. Il n’y a pas de récit linéaire. L’Ordre du jour raconte un épisode de l’installation des nazis au pouvoir, puis l’Anschluss, un de leurs premiers succès. Domine une impression pénible de petites combines et de mauvais coups. Cela permet de défaire le mythe : non seulement les événements ne sont pas inexorables, mais les plus grands crimes peuvent résulter des manœuvres les plus grossières. Ainsi, le livre parle de la guerre, mais sans la raconter. Il s’appuie sur ce que le lecteur sait pour chercher autre chose. Si l’on raconte l’avant-guerre, puis que l’on s’engouffre dans un récit détaillé du conflit et de ses horreurs, une fois parvenu à la fin, on a perdu de vue les manœuvres de couloir. En revanche, lorsqu’on passe des minables combines qui émaillèrent l’établissement des nazis au pouvoir, aux juifs qui après guerre demandèrent réparation, cela met côte à côte les causes et le résultat, ce qui n’est pas indifférent.
L’ensemble de vos livres témoignent d’une étourdissante connaissance historique. Comment peut s’insinuer, dans ce considérable corpus de documents dûment digérés, la part qui revient à la fiction proprement dite ?
Éric Vuillard Dans mes livres, je n’invente rien, je m’en tiens aux faits. Bien sûr, j’incarne les protagonistes, je leur prête des pensées, parfois des sentiments. Mais rien qui mène au-delà des faits. C’est là ma part de fiction, au sens restreint du terme. Je sais que Ribbentrop était intarissable durant son déjeuner d’adieu à Downing Street, afin de prolonger le repas et de retarder le moment où Chamberlain réagirait à l’invasion de l’Autriche. J’imagine alors une conversation mondaine et je le fais parler longuement de Bill Tilden, un célèbre joueur de tennis. En revanche, lorsque je rapporte que Ribbentrop était le locataire de Chamberlain, c’est un fait, et qui donne à réfléchir. Mais, en un sens plus vif, ce qu’on appelle fiction participe à la structure même de notre savoir. La connaissance n’est pas le traitement de données brutes et la fiction s’insinue déjà dans la lecture elle-même. En lisant, mon esprit est sans cesse aimanté par tel ou tel détail, un mot, une phrase, une description, une idée. Cette mosaïque est le fond réel de notre pensée. Dès le départ, dès que l’on trie les documents, comme l’écrivait Döblin : « Les grandes manœuvres commencent. » C’est que la connaissance ne consiste pas à déchiffrer des données, mais à produire un discours. L’un des versants de cette opération est le montage. On ordonne des événements, on établit des correspondances entre les faits, et tout cela compose une intrigue. C’est là, je crois, que la fiction s’enracine.
Notre rapport à la vérité se fonde sur un matériau hétérogène, notre pensée s’appuie pas à pas sur une phrase qui nous a marqués, une image, la conclusion d’un livre… C’est le lien entre tout ça qui est l’élément dynamique de la connaissance, et on l’apparente à la fiction. Pour le dire autrement, davantage que le fait d’incarner un épisode de l’histoire, c’est surtout la structure de mes livres qui relève de la fiction : lorsque je place côte à côte les suicides survenus à Vienne juste avant l’Anschluss et la conférence de Munich, je livre à la fois des faits et un discours. La fiction est ce qui fait tenir les deux ensemble.
Est-ce que Michelet, par exemple, peut être un modèle dont vous vous réclamez, dans la mesure où chez lui le style, joint à un parti pris historique fort, en a fait, pour ainsi dire, un grand écrivain d’histoire.
Éric Vuillard Même si l’heure des grandes synthèses est morte, j’ai beaucoup de plaisir à lire Michelet. Son écriture est puissante, une conception le guide, il l’affirme avec force ; et puis il y a son côté délirant, le Michelet de Barthes. Celui qui avait des migraines historiques !
Plus largement, peut-on vous demander quelques noms d’écrivains qui vous paraissent avoir déjà illustré le type de littérature qui est le vôtre ? Le Tolstoï de Guerre et Paix, pourquoi pas, quant à la méthode historique…
Éric Vuillard Lorsque, à propos de la réalisation du Dictateur, Chaplin déclare : « L’histoire est plus grande que le petit vagabond », il nous signale un point critique pour toute création. Avec la montée du fascisme, le personnage de Charlot ne suffisait plus. Il ne permettait pas de mettre en scène une réponse aux horreurs que le fascisme annonçait. Pour les mêmes raisons, j’aime la Vie de Galilée, de Brecht. La pièce a été écrite au gré des circonstances. Brecht y travailla longtemps, la reprit, à mesure que la science moderne le mit au défi de penser autrement. Les bombes atomiques américaines tombées sur le Japon furent à l’origine d’un changement de point de vue. Son œuvre est prise dans une conjoncture ; sa pensée est inscrite dans le temps. Cette attitude de Brecht me touche. C’est aussi ce qu’a fait Tolstoï avec Guerre et Paix. Dans sa première version, les dialogues des aristocrates sont souvent en français, et les descriptions sont ponctuées de longues digressions métaphysiques. Dans une version plus tardive, Tolstoï traduit les dialogues en russe et sabre la métaphysique. Cela tient à son évolution politique. Le livre doit pouvoir être lu par le grand nombre, il ne saurait être le privilège de quelques-uns. Sans quoi les conditions de lecture du livre reproduiraient les conditions sociales qu’il dénonce. Mais il y a parfois mieux que la tradition romanesque. L’Établi, de Robert Linhart, est un récit de première grandeur. Il y raconte son séjour en usine. Sa description du travail arrache au lecteur les dernières illusions qu’il avait sur le salariat. Et puis il y a deux tendances inverses. D’un côté, il y a le naturalisme, le réalisme, l’enquête préludant à l’écriture. De l’autre, il y a James Agee, la prose toute saturée de sa présence. Il faudrait parvenir à ne jamais évacuer le sujet, à ne jamais faire croire au lecteur qu’il est seul, que l’auteur n’est pas là. Mais il faudrait aussi retrouver le monde par l’autre bout, par la réalité extérieure, en investiguant. Car ce qui nous entoure ne peut être seulement imaginé, et nous ne pouvons jamais être soustraits du monde.
De fait, dans l’Ordre du jour, vous dressez le constat argumenté de la prise de pouvoir effective du nazisme grâce à l’accord bienveillant du grand capital allemand… N’est-ce pas là une interprétation marxiste ?
Éric Vuillard Mes livres expriment une défiance marquée à l’égard de ce qu’on appelait jadis le capital. Il existe une permanence du monde des affaires, une stabilité de ses intérêts. Certaines personnes morales sont désormais plus anciennes que des États, et parfois plus puissantes. Que les grands industriels allemands aient participé à l’installation des nazis au pouvoir me semble relever des faits. Ce sont les eaux glacées du calcul égoïste dont parle Marx.
Est-ce qu’au fond de votre projet ne se trouve pas un désir d’éduquer par le roman, en une période où ce genre, dûment affadi dans les petites aventures de chacun, évite volontiers d’agiter ce qu’on nommait jadis les grands problèmes ?
Éric Vuillard Il existe une tension interne, coextensive à l’histoire du roman, entre une description fidèle du monde et la pensée de l’auteur. D’une certaine manière, avec Madame Bovary, Flaubert a cru résoudre le problème : il se tient au plus près de quelques existences, au cœur d’un monde social finement décrit ; la cruauté incorporée à sa description faisant office de thèse sur la valeur de l’humanité, elle se donne pour un effet de réel, une libre conclusion du lecteur sur le monde. Le point de vue de l’auteur étant informulé, il se confond avec l’atmosphère du roman, il ne fait plus qu’un avec le style. Ainsi, la distance de Flaubert est la dimension essentielle de son message. Dans la vie de tous les jours, l’idéologie fonctionne exactement de la même manière. Elle est partout, et on ne la voit jamais.
Il existe une autre conception, une façon de ne pas dissoudre le problème, de ne pas l’effacer. Zola est en réalité plus féroce que Flaubert, c’est même ce qui agace. Avec Nana, par exemple, il souhaite raconter l’histoire de « toute une société se ruant sur le cul » ; l’affrontement est direct et il n’épargne pas les responsables, à travers le vieux Muffat de Beuville. La fille de Gervaise élève seule son fils Louis, né d’un père inconnu. Elle fait des passes pour arrondir ses fins de mois, puis devient cocotte, et confie son fils en garde. Quelques centaines de pages plus tard, elle meurt à vingt et un ans de la petite vérole. Je crois qu’en un temps où les chances de vivre comme on le souhaite sont très inégalement distribuées, il est important de trouver dans l’écriture de quoi traiter ce que vous nommez justement « les grands problèmes ». Pour la question de l’éducation, j’hésite. En tout cas, je ne m’insurge pas à l’idée d’une littérature didactique. Un trait assez symptomatique de notre temps est que l’art y répugnerait unanimement, cela doit retenir notre attention et nous rendre méfiant. On réclame des écrivains qu’ils se produisent, qu’ils participent à des ateliers, à des rencontres. En revanche, leurs textes ne devraient surtout pas être didactiques. La contradiction est curieuse et mérite d’être relevée. Et puis en dernière instance, c’est moi que j’éduque.
Combien de temps dans votre vie peuvent prendre l’élaboration puis la composition de vos romans ?
Éric Vuillard Le plus important est l’élaboration au long cours ; comme tout le monde, je lis des livres sur les sujets que je veux mieux comprendre. Ce n’est pas de la documentation, seulement de la lecture. Une fois que le désir d’écrire est là, il faut effectuer des recherches plus précises. Je les mène souvent de front avec l’écriture, pour ne pas perdre mon élan. Parfois, cela peut interrompre le travail ; il me faut aller en bibliothèque, aux archives… Cela peut prendre des semaines. Il arrive aussi que je cale, que le livre m’échappe. Il n’y a pas de règle, certains livres viennent très vite, j’ai écrit Congo en quelques jours. Mais d’autres fois je m’ensable, et je reprends le texte plus tard, quand les choses se dénouent. C’est d’ailleurs ce que l’écriture a de plus étonnant, les livres se répondent. On perd le fil, on oublie ses brouillons, le temps passe, et voici qu’un autre texte apporte la solution du premier.
Pour parler d’aujourd’hui, quelle journée vous semble-t-elle décisive dans les moments politiques que nous traversons et qui ne sont pas encore visiblement de l’ordre historique mais du quotidien angoissant ?
Éric Vuillard Il me semble que ce n’est pas tant une journée qu’un ensemble de dispositions contradictoires. D’un côté, les ralliements autour de l’un des candidats, censé être sorti de nulle part, sont tellement unanimes que cela a quelque chose de troublant. De l’autre, l’extrême droite incarnant la protection des salariés, il y a de quoi être étonné. Nous devons faire face à deux fables.
Ce livre, dans une forme originale qui n’exclut ni l’esprit didactique, ni l’incursion d’un « je » perplexe, s’ouvre donc sur la réunion secrète au Reichstag, le 20 février 1933 – en présence d’Hitler et de Goering –, quand 24 grands noms de l’industrie allemande (Bayer, Agfa, Krupp, IG Farben, Opel, Siemens, Allianz, Telefunken, etc.) passent à la caisse pour aider le parti nazi à faire campagne. « Ils sont, dit l’auteur, nos voitures, nos machines à laver, nos produits d’entretien, nos radios-réveils, l’assurance de notre monde. » C’est ensuite une foule de péripéties sur l’invasion de l’Autriche. Il est aussi question du procès de Nuremberg. Le tout fourmille de faits vrais, d’anecdotes parlantes, de portraits à l’eau-forte. Éric Vuillard explore sans peur ce que la grande histoire cache sous le tapis, avec une verve féroce, en rappelant que « les plus grandes catastrophes s’avancent souvent à petits pas ». M. S.
17:15 Publié dans Actualités, Entretiens, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eric vuillard, prix goncourt, l'ordre du jour |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
31/05/2017
Josiane Balasko : « J’ai simplement envie que les gens vivent mieux »
Entretien réalisé par Julia Hamlaoui, L'Humanité
La comédienne Josiane Balasko apporte son appui aux candidats PCF pour les législatives, dont elle partage, sans être communiste, de nombreux engagements.
Pourquoi avez-vous décidé de soutenir les candidats communistes aux législatives, en particulier Maxime Cochard, dans la 10e circonscription de Paris ?
Josiane Balasko Leur discours n’est pas un discours de haine ou de démolition, mais de construction, cela m’a intéressée. Je ne suis pas communiste, mais ce sont des gens honnêtes qui font un bon boulot dans les quartiers. Ils se mobilisent pour l’aide aux personnes dans le besoin – et il y en a énormément –, contre le mal-logement, pour le secours aux réfugiés… Ce sont des engagements qui me parlent. Le Parti communiste a toujours été là dans les communes, avec ses militants et ses représentants, pour aider les gens.
C’est pour cela que j’ai eu envie de les soutenir et que j’appelle à voter pour eux. Et puis, il faut qu’il y ait une parité aux législatives. Après le travail que les communistes ont fait, ce serait injuste qu’ils soient réduits à la portion congrue. Pour ma part, j’ai simplement envie que les gens puissent vivre un peu mieux, qu’ils n’aient pas de problème pour boucler leurs fins de mois et remplir leur Caddie. Beaucoup de gens vivent très misérablement.
Je passe mon temps à me balader en tournée, et je vois la désertification gagner les campagnes, les centres-villes. On ressemble maintenant aux villes américaines où il n’y a plus rien dans le centre et où il faut faire dix bornes pour aller s’acheter de la bouffe industrielle.
Après l’élection présidentielle, pour laquelle vous n’avez pas soutenu de candidat, quel regard portez-vous sur la situation politique ?
Josiane Balasko Comme beaucoup de Français j’ai voté Macron, non pas parce que j’étais absolument pour lui, mais parce qu’il fallait impérativement barrer la route au Front national. Il n’y avait pas 36 000 solutions. J’attends de voir ce qui va se passer puisque peu de choses ont été dites ou faites depuis la présidentielle. Mais il est impératif pour la démocratie que plusieurs partis républicains, plusieurs partis du peuple soient représentés à l’Assemblée nationale. Et notamment la gauche.
Le PS est très mal barré, Macron veut réunir tout le monde et Mélenchon tuer toute la gauche à part lui. Pour moi, les législatives sont aussi importantes que l’élection présidentielle. Ce sont elles qui permettent d’avoir une réelle représentation et que chacun puisse s’exprimer.
Pour l’instant on ne parle plus du FN, mais il est toujours là. Ce n’est pas parce qu’ils ont été recalés à la présidentielle qu’ils n’existent plus. En revanche, on parle beaucoup d’un raz-de-marée Macron en juin. Il est très photogénique mais on ne sait pas ce qui va se passer. J’espère qu’il y aura des surprises.
10:08 Publié dans Actualités, Entretiens, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : josiane balasko, pcf, législatives |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
25/05/2017
WAT UNESCO EVRY 2017
Du 15 au 24 mai, la ville d’Evry a accueilli des architectes, des urbanistes, des paysagistes et des sociologues du monde entier pour réfléchir ensemble aux futurs aménagements du centre-ville.
Ce projet nommé, Wat Unesco, est le résultat d’un partenariat entre avec la Chaire Unesco en paysage et environnement de l’Université de Montréal (CUPEUM), la ville d’Evry, l’université Evry-Val d’Essonne et l’école spéciale d’architecture de Paris.
Avant Evry, Binzhou en Chine ou encore Sao Paolo au Brésil ont, notamment, déjà bénéficié de la même initiative.
Alors que le centre-ville est en plein développement, avec la sortie de terre de nouveaux logements, la création d’un marché il y a deux ans ou encore la construction d’une école, inaugurée en septembre prochain, la Ville a pris un temps d’avance.
L’objectif de ce partenariat était de concevoir l’aménagement urbain des décennies à venir en imaginant des projets de requalification de certains sites significatifs.
Issus de plus de 20 institutions universitaires, les participants à ce colloque agissent pour résoudre les problèmes urbains en lien avec les grands enjeux sociaux, culturels et environnementaux. L'atelier organisé à Evry a visé à compléter les visions d’aménagement en cours dans le centre-ville.
 Cinq groupes d'étudiants venus de Tunisie, du Canada, d'Italie, de France ont proposé dans ce cadre des projets innovants et ont participé à un concours fraternel.
Cinq groupes d'étudiants venus de Tunisie, du Canada, d'Italie, de France ont proposé dans ce cadre des projets innovants et ont participé à un concours fraternel.
Cette rencontre qui c'est déroulé a été une chance pour la ville d'Evry de bénéficier ainsi d’une vision mondiale de l’aménagement, et d'un laboratoire d’idées multi-culturel.
Reportage exclusif réalisé par Radio Evry pour Chansons Rouges Mosaik Radio avec entretien avec Elodie François Maire adjointe à l'urbanisme d'Evry, et les lauréats de ce concours qui ont obtenu le premier prix : CLIQUEZ SUR CETTE LIGNE OU SUR LA PHOTO POUR ECOUTER CE REPORTAGE
11:01 Publié dans Actualités, Entretiens, Planète, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wat unesco evry 2017, urbanisme, projets |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
04/03/2017
« Macron, c’est Tony Blair avec 20 ans de retard »
Propos recueillis pas Lola Ruscio, Humanite.fr
Frédéric Farah : Macron est vendu comme du neuf, mais ce qu’il propose est poussiéreux. Il s’inscrit dans la continuité avec la ligne social-libérale du gouvernement tout en appuyant sur l’accélérateur. On pourrait croire que la nouveauté se trouve dans sa réforme du marché du travail ou de l’assurance-chômage, mais elles sont directement inspirées du modèle anglais. Alors que l'assurance-chômage est aujourd'hui financée par les cotisations salariales et patronales, il veut que ce système soit financé par l’impôt. Ce qui va engendrer un Etat social au rabais : tout le monde va bénéficier d’un minimum chômage, mais les indemnités vont être tirées vers le bas, comme c’est le cas en Grande-Bretagne. Pareil sur l’arrêt du versement des allocations chômage en cas de refus après des offres d’emploi, elles aussi inspirées par Margaret Thatcher. Autant de mesures qui ne combattent pas le chômage, mais les chômeurs.
11:27 Publié dans Connaissances, Economie, Entretiens, Science | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : macron, présidence, économie, social, propositions |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 












