29/01/2014
Dounia Bouzar : "Combattre les dérives sectaires, c’est respecter l’islam"
Anthropologue du fait religieux et membre de l’Observatoire national de la laïcité, Dounia Bouzar montre dans son livre Désamorcer l’islam radical (1) comment l’amalgame entre les radicaux et l’islam met en péril la cohésion de notre société.
Quelle est la responsabilité des politiques dans l’amalgame entretenu entre radicalisme et islam ?
Dounia Bouzar. Pour vous répondre, je vais prendre l’exemple du niqab. Les radicaux voulaient faire passer ce voile intégral pour une application de l’islam au pied de la lettre, alors que c’est une tradition préislamique des tribus pachtounes, sacralisée il y a quelques années par les wahhabites de l’Arabie saoudite… Lorsque j’ai été auditionnée par les parlementaires, en 2010, avant le vote de la loi sur l’interdiction du voile intégral dans les lieux publics, j’avais plaidé pour faire reconnaître le niqab comme un signe sectaire. Cela permettait d’éviter de faire l’amalgame avec l’islam. Il m’a été répondu qu’il n’appartient pas aux États démocratiques de se mêler des débats théologiques. Pourtant, le premier article de la loi de 1905 dit que « la République assure la liberté de conscience à ses citoyens », ce qui implique de les protéger des dérives sectaires (même si celles-ci sont reliées à un pays riche…). Du coup, les débats autour de la loi de 2010 ont pris pour principe que le niqab était musulman. On a alors fait le procès de l’islam. Cela a eu deux conséquences graves : la commission de l’Assemblée nationale a validé l’interprétation des radicaux. En croyant les combattre, les politiques ont renforcé leurs pouvoirs en les considérant comme de simples religieux orthodoxes ; les musulmans non radicaux ont eu du mal à se positionner contre le niqab puisque les débats faisaient le procès de l’islam et non du radicalisme. Résultat, malgré le vote de la loi qui interdit de se cacher le visage, les radicaux ont gagné symboliquement : aujourd’hui, 95 % des Français croient que porter le niqab, c’est appliquer le Coran à la lettre.
Vous expliquez que l’islam en tant que projet politique peut être combattu par la laïcité et l’apprentissage de la séparation entre croyance et citoyenneté. Mais qu’en est-il du discours de l’islam radical ?
Dounia Bouzar. Pour pouvoir désamorcer un mouvement, il faut savoir le diagnostiquer. Les radicaux n’ont pas pour but un projet politique tel qu’on l’entend habituellement. Ils endoctrinent les jeunes en leur disant qu’ils sont élus par Dieu pour appartenir à un groupe purifié qui détient la vérité. Ces purificateurs ont transformé l’islam en codes pour délimiter le contour du groupe purifié. Les chaussettes remontées, les barbes jusqu’au nombril et les bosses sur le front, ce sont des signes de reconnaissance pour se démarquer des impurs. Le niqab l’illustre clairement. L’exhibition religieuse consiste aussi à injecter de la pureté dans le monde à tout instant. Plutôt que de proposer un projet politique, ce qui demanderait de réfléchir à partir du monde réel, les radicaux se réfugient dans une idéologie de rupture, qui considère que la société est régie par le mal (le sexe, l’argent, la violence). Ils ne cherchent pas à tester la République, puisqu’elle n’existe pas pour eux. Ils se soustraient à la légalité au nom d’une loi, qui les missionne pour sauver le monde du déclin. On tend vers un mouvement totalitaire. Or, on ne combattra pas ce mouvement totalitaire de l’islam radical en diminuant l’État de droit des musulmans. Car précisément, ceux qui sont attirés par ce type de fuite ont le sentiment de ne pas avoir de place dans la cité commune. Ils sont persuadés que « les autres » ne garantissent pas leur place.
Ces mamans qui portent le foulard et à qui on refuse le droit d’accompagner les sorties scolaires font-elles les frais de cet amalgame que vous décrivez ?
Dounia Bouzar. Absolument. Quand on interdit aux mamans d’accompagner les classes pendant les sorties scolaires parce qu’elles portent un foulard, on provoque le contraire de ce qu’on cherche. En effet, on dit aux enfants que leur maman est inutile auprès de la figure d’intégration qu’est l’instituteur, et même interdite. Comment cet enfant aura-t-il le sentiment que sa place est garantie par les autres si celle de sa mère ne l’est pas ? Il est plus aisé de harceler les femmes qui portent le foulard que de s’attaquer aux radicaux. C’est là où, à mon avis, le politique est parasité par la posture idéologique et par l’entretien de l’amalgame entre islam et radicaux.
Pour vous, plusieurs exemples prouvent l’infiltration progressive d’idées sectaires devenues acceptables…
Dounia Bouzar. Le meilleur exemple concerne le serrage de main. Je suis immergée dans le milieu musulman depuis vingt-cinq ans et aucun homme n’a jamais refusé de me serrer la main. Aujourd’hui, de jeunes hommes, dans certaines entreprises, refusent de serrer la main à leurs collègues femmes. Cela pose un grave problème lorsqu’ils arrivent à convaincre les non-musulmans qu’il s’agit d’une simple application de leur islam et d’un retour à la tradition, réduisant la femme à un objet diabolique qu’il faudrait neutraliser. Cette déshumanisation de la femme n’existe pas dans l’histoire de l’islam. Il y avait séparation des rôles et des fonctions dans la tradition mais cela n’entraînait pas de mépris de la femme. Cette représentation des femmes est très récente. Elle est apparue il y a une dizaine d’années. Il faut être très clair : ne pas serrer la main d’une femme est une discrimination sur le critère du genre qui est condamnable par la loi. Mais, en dix ans, les radicaux ont semé le doute. Cela a fini par donner de l’islam une image très négative. Le laxisme et l’inaction envers les radicaux devraient interroger. Car cela encourage une vision profondément islamophobe et nourrit les représentations archaïques et racistes de l’islam qu’il serait temps de déconstruire collectivement.
Ce livre est-il un message adressé aux responsables politiques et à la société française ?
Dounia Bouzar. Oui. Si ce ne sont pas les politiques qui diagnostiquent les dérives sectaires et font face aux radicaux, qui le fera ? La société doit se mettre d’accord sur les indicateurs, sur les signaux d’alarme qui doivent nous pousser à réagir. Ne pas serrer la main d’une femme est une dérive. Être choqué de cela et ne pas laisser s’installer ce type de comportements, c’est respecter l’islam.
(1) Désamorcer l’islam radical. Ces dérives sectaires qui défigurent l’islam, Éditions de l’Atelier, 2014.
Lire aussi :
- Il convient de libérer l’homme de la fantasmagorie religieuse par Yvon Quiniou, philosophe
- Baby loup: le principe de laïcité ne s'applique pas dans le privé
- Dounia Bouzar: «La radicalisation doit être mieux étudiée»
17:45 Publié dans Actualités, Connaissances, Entretiens, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laïcité, entretiens, islam, entretien, intégration, égalité hommes femmes, islam radical, dounia bouzar, croyance |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
06/12/2013
Camarade Nelson Mandela : L'homme tranquille contre l'apartheid
En 1991, lors de son voyage en France, Nelson Mandela aujourd'hui disparue, accordait une interview exclusive à « l’Humanité ». Des extraits sont publiés dans l’Humanité Dimanche du 12 février 2010. Voici l’intégral de l’entretien.
L’homme tranquille contre l’apartheid
Hôte de la France, et plus précisément de son ministère des affaires étrangères, le vice-président du Congrès national africain (ANC) a reçu hier les journalistes de « l’Humanité » dans une de ses possessions « diplomatiques » du gouvernement français en région parisienne, le château de la Celle-Saint-Cloud. Aucune solennité cependant. Ni mythe ni symbole, c’est l’hôte, l’homme tranquille à la taille imposante, préservée, dont la main large et forte rappelle une jeunesse tumultueuse sur les rings de boxe pour amateurs condamnés à devoir prouver toujours plus qui pose la première question : « Où voulez-vous que je m’assoie ? »
Une question en appelant toujours une autre, et chacun d’entre nous ayant participé d’une manière ou d’une autre au combat pour la libération de Nelson Mandela ainsi qu’aux campagnes de solidarité avec le peuple sud-africain, nous ne pouvons que demander, plutôt émus :
Les journalistes de « l'Humanité » Claude Kroës et José Fort accueillent Nelson Mandela pour l'interviewer en 1991.
José Fort et Claude Kroës. Pouvons nous vous appeler camarade ?
NELSON MANDELA. Oui, tout à fait. Vous savez, je suis le camarade de Georges Marchais.
J. F. et C. K. Alors, la première vraie question. Il y a seize mois, vous étiez enfin libéré après plus d’un quart de siècle de prison. Quel regard portiez-vous sur ce que vous avez découvert au moment de votre libération ? Et quel regard portez-vous aujourd’hui sur le monde ?
N. M. Ce n’est pas facile à dire. Il n’est pas très facile pour moi de dire quel était mon regard il y a un an et demi. Il y a toujours un risque de spéculation dans ce genre de déclaration. Mais ce qui m’a frappé, c’est l’amélioration des rapports entre l’Est et l’Ouest, l’amélioration des rapports entre l’Union soviétique et les États-Unis d’Amérique, les pourparlers et les traités sur le désarmement et sur la réduction des armes nucléaires.
À mon avis, le premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher, a joué un rôle significatif dans le rapprochement entre Gorbatchev et Reagan pour favoriser les discussions sur la paix mondiale. Ce fut mon impression dominante. Et deuxièmement, il y a le problème de la lutte anti-apartheid dans le monde entier. En particulier en Grande-Bretagne, en Europe, en Asie, aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud.
La voix des forces de libération et de progrès vers la démocratie et vers la suppression de la tyrannie s’est très fortement fait entendre. Je suis heureux de constater que les forces de paix sont si fortes, que la tendance en faveur d’une réduction des tensions dans le monde s’exprime toujours avec la même puissance et, bien sûr, que le mouvement anti-apartheid pèse toujours du même poids dans le monde entier.
J. F. et C. K. Camarade Mandela, croyez-vous que les réformes annoncées dans votre pays conduiront à l’élimination de l’apartheid ? Et pensez-vous que le poids de l’opinion publique internationale, qui s’est fortement exprimée pour exiger votre libération, puisse encore avoir un rôle décisif, alors que vous, démocrates sud-africains, êtes entrés dans une phase de négociation ?
N. M. Les réformes annoncées par le gouvernement sud-africain sont très encourageantes. Certains progrès ont été enregistrés dans le sens du démantèlement de l’apartheid et le chemin qui mène vers une Afrique du Sud unie et démocratique est en voie de construction. Mais nous sommes encore très loin de la satisfaction des revendications que nous avons avancées, parce que le contenu principal des réformes voulues, c’est la possibilité pour le peuple sudafricain de s’exprimer par le vote.
J. F. et C. K. Vous voulez dire « one man, one vote » ?
N. M. Oui, bien sûr, et dans la situation actuelle, moi, je ne peux toujours pas voter. Ça, c’est l’élément essentiel. Mais, indépendamment de ce qu’a annoncé le gouvernement sud-africain, nous sommes encore loin d’une situation où la majorité du peuple sud-africain pourrait se déterminer lui-même sur son avenir. C’est la raison pour laquelle nous demandons le maintien des sanctions par la communauté internationale et c’est la raison pour laquelle nous regrettons la décision prise en décembre 1990 par la Communauté européenne. (…)
J. F. et C. K. A propos de cette décision de lever les sanction, vous avez rencontré mardi Jacques Delors, à Bruxelles. Quelle appréciation portez-vous sur votre conversation avec le président de la Commission européenne et avez-vous le sentiment d’avoir été entendu ?
N.M. Mr Delors est un homme qui soutient la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud et je souhaite pouvoir croire, surtout après notre rencontre d’hier, qu’il acceptera de faire connaître aux chefs d’Etats de la CEE les positions de l’ANC. Mais nous discutons d’un problème qui sera soumis aux chefs d’Etat, et il ne serait pas opportun que j’entre dans les détails sur cette question.
J. F. et C. K. Les images montrant les affrontements entre Noirs marquent beaucoup la population française. Est-ce qu’il est possible d’arrêter ces massacres ? Quel avenir pour l’Afrique du Sud ? Etes-vous prêt à gouverner avec les Blancs et dans quel cadre législatif ? Pouvez-vous nous dire quelques mots du Congrès de l’ANC, prévu à Durban, au début du mois prochain ?
N. M. D’abord au sujet de la violence : elle a été présentée comme un affrontement entre noirs. Or, ce n’est là qu’un élément de cette violence. Il y a d’autres éléments qui incitent à la violence. Il y a actuellement des escadrons de la mort, organisés par le gouvernement sud-africain, qui font beaucoup plus de mal à des victimes innocentes que la violences entre Noirs.
Et puis il y a aussi la connivence du gouvernement dans cette violence. Si le gouvernement utilisait la capacité qu’il a de mettre un terme à la violence et de maintenir l’ordre, il pourrait le faire le plus aisément du monde. C’est la raison pour laquelle nous l’avons menacé de ne pas poursuivre les pourparlers sur la Constitution future, aussi longtemps qu’il n’aura pas mis un terme à cette violence.
Mais nous sommes optimistes quant au fait que nous réussirons à contraindre le gouvernement à arrêter la violence. Celle-ci ne continue que parce que le gouvernement le souhaite.
J. F. et C. K. Et le devenir de l’ANC, dans ce contexte changeant et difficile ?
N. M. En ce qui concerne le congrès de l’ANC en juillet, nous sommes très optimistes. Les mass média, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Afrique du Sud, ont essayé de faire croire à l’existence de factions. C’est parfaitement mensonger. C’est la même propagande que celle qui a eu cours par le passé, avant la première conférence consultative légale de l’ANC de décembre dernier. Bien sûr, il y a des divergences qui s’expriment sur tous les sujets, divergneces qui existent aussi dans d’autres congrès, dans d’autres organisations, ailleurs. Mais les décisions que nous avons prises ont été unanimes et saines.
J. F. et C. K. Etes-vous prêt à gouverner avec les Blancs et dans quel cadre législatif ?
N. M. Notre politique est favorable à une Afrique du Sud non raciste, véritablement démocratique et, à cet égard, le mérite personnel sera pour nous le seul critère pertinent. Ce qui signifie que nous sommes prêts à travailler avec tous les groupes nationaux, avec les Noirs et avec les Blancs. Et malgré les problèmes que nous rencontrons, les choses avancent très bien.
J. F. et C. K. Vous avez rencontré François Mitterrand et le premier ministre Édith Cresson. Avez-vous maintenant un message à faire passer au peuple français ?
N. M. Eh bien, notre message est très simple : nous demandons au peuple français de continuer à soutenir la lutte anti-apartheid parce que notre lutte repose sur les principes démocratiques que sont l’égalité, la liberté et la fraternité humaines. Et ces valeurs ont été répandues en Europe par les philosophes français, Voltaire, Montesquieu et d’autres… Et nous espérons donc que le peuple français continuera à soutenir notre lutte.
Propos recueillis par José Fort et Claude Kroës
Derniere photo, Nelson Mandela avec la chanteuse Whitney Houston disparu le 11 février 2012
17:52 Publié dans Actualités, Connaissances, Entretiens, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, nelson mandela, l'humanité dimanche, marchais |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
01/12/2013
LES MEDIAS FACE AU DEFI DE L'IMPARTIALITE
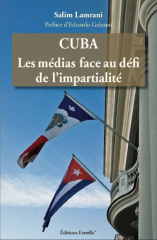 Salim Lamrani, Maître de conférences à l’Université de la Réunion et journaliste spécialiste de Cuba, vient de sortir un nouvel ouvrage aux Editions Estrella avec un titre éloquent : Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité. Ce livre de 230 pages se divise en neuf chapitres. Il est introduit par une préface du grand écrivain uruguayen Eduardo Galeano, auteur du célèbre livre Les veines ouvertes de l’Amérique latine. Lamrani, comme pour tout bon historien et chercheur, enrichit toujours son travail par des sources abondantes, avec pas moins de 350 notes dans cet ouvrage. Entretien avec Salim Lamrani par André Garand, France-Cuba Marseille.
Salim Lamrani, Maître de conférences à l’Université de la Réunion et journaliste spécialiste de Cuba, vient de sortir un nouvel ouvrage aux Editions Estrella avec un titre éloquent : Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité. Ce livre de 230 pages se divise en neuf chapitres. Il est introduit par une préface du grand écrivain uruguayen Eduardo Galeano, auteur du célèbre livre Les veines ouvertes de l’Amérique latine. Lamrani, comme pour tout bon historien et chercheur, enrichit toujours son travail par des sources abondantes, avec pas moins de 350 notes dans cet ouvrage. Entretien avec Salim Lamrani par André Garand, France-Cuba Marseille.
André Garand : Salim Lamrani, parlez-nous de votre dernier ouvrage.
Salim Lamrani : Ce livre part du postulat suivant : le phénomène de concentration de la presse entre les mains du pouvoir économique et financier est devenu, partout en Occident, une réalité indéniable. Or, ces médias, qui sont liés aux puissances d’argent et qui défendent l’ordre établi, sont souvent confrontés au défi de l’impartialité, surtout lorsqu’il s’agit de Cuba. Il leur est difficile de présenter de manière objective une nation dont le projet de société défie l’idéologie dominante. De plus, Cuba est, par définition, un sujet médiatique qui suscite critiques et controverses et attise régulièrement les passions.
André Garand : Quels thèmes abordez-vous dans ce livre ?
Salim Lamrani : Mon livre tente d’apporter une réponse aux questions suivantes : Comment les médias présentent-ils la réalité cubaine ? De quelle manière abordent-ils des problématiques aussi complexes que les droits de l’homme, le débat critique, l’émigration, le niveau de développement humain et les relations avec les États- Unis ? Remplissent-ils réellement leur rôle de quatrième pouvoir ? Sont-ils capables de s’émanciper du pouvoir politique, des puissances d’argent et d’apporter une vision plurielle sur la société cubaine ? Car une presse libre et indépendante est essentielle dans toute démocratie et elle s’accompagne, à l’évidence, d’un devoir de vérité informationnelle vis-à-vis des citoyens.
André Garand : Pourquoi les médias sont-ils si critiques à l’égard de Cuba ?
Salim Lamrani : Cuba, depuis le triomphe de la Révolution et l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro, est un sujet de débat vif et animé. Il est une raison essentielle à cela : le processus de transformation sociale initié en 1959 a bouleversé l’ordre et les structures établis, a remis en cause le pouvoir des dominants et propose une alternative sociétale où – malgré tous ses défauts, ses imperfections et ses contradictions qu’il convient de ne pas minimiser – les puissances d’argent ne règnent plus en maître, et où les ressources sont destinées à la majorité des citoyens et non à une minorité.
André Garand : Eduardo Galeano, célèbre écrivain latino-américain, a rédigé la préface de votre livre.
Salim Lamrani : Eduardo Galeano a effectivement rédigé un texte incisif non dépourvu de l’humour sarcastique, si caractéristique de son style, sur Cuba et les médias. J’en profite pour le remercier chaleureusement d’avoir bien voulu associer son nom et son prestige à mon travail. J’en profite également pour remercier publiquement Estela, journaliste espagnole, qui m’a aidé dans cette tâche.
André Garand : La quatrième de couverture comporte une citation de Jean-Pierre Bel, notre Président du Sénat, qui vous remercie pour votre travail. Elle dit la chose suivante : « Merci pour ce regard sur Cuba, tellement utile ». C’est une belle reconnaissance, non ?
Salim Lamrani : Le Président Jean-Pierre Bel est un grand ami de Cuba. C’est un grand connaisseur de l’Amérique latine. Il est très attaché à la liberté d’expression et à la pluralité d’opinions. Il est issu d’une famille de résistants communistes et est un grand admirateur de la Révolution cubaine. Il a lu certains de mes ouvrages et m’a fait parvenir ce petit mot. Je l’en remercie grandement.
André Garand : Une citation de Robespierre, à qui vous dédiez votre ouvrage, introduit le livre. Pourquoi ce choix ?
Salim Lamrani : Robespierre parlait de passer la « vérité en contrebande » car il avait la conviction profonde qu’elle finirait par triompher. Je partage cette foi.
Maximilien Robespierre est le plus pur patriote de l’Histoire de France. C’est la figure emblématique de la Révolution, le défenseur de la souveraineté populaire. Il avait compris dès le départ que les puissances d’argent étaient le principal ennemi du peuple, de la République, de la Patrie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’idéologie dominante vilipende tant son héritage. Ses aspirations à la liberté et à la justice sociale sont toujours d’actualité.
Nous vivons une époque assez curieuse. On glorifie les ennemis du peuple et on méprise ses défenseurs. Prenez la ville de Paris : Pas une rue ne porte le nom de notre Libérateur, pas une statue à l’effigie de Robespierre, alors que le traitre Mirabeau a un pont et Adolphe Thiers, le boucher de la Commune qui a fait fusiller 20.000 patriotes en une semaine, dispose d’un square et d’une statue. Rendez-vous compte, le 22 septembre, jour de la Fondation de notre République, n’est même pas célébré en France.
Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité
Préface d’Eduardo Galeano
Paris, Editions Estrella, 2013
230 pages
18€
Disponible auprès de l’auteur : lamranisalim@yahoo.fr
Egalement en librairie : http://www.librairie-renaissance.fr/9782953128437-cuba-le...
Et chez Amazon
http://www.amazon.fr/Cuba-Medias-Face-Defi-lImpartialite/...
17:19 Publié dans Connaissances, Entretiens, International, Livre, Médias | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cuba, médias, salim lamrani, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
16/11/2013
Bertrand Tavernier : "Que le spectateur soit le locataire du Quai d’Orsay"
Dominique de Villepin fut un ministre facile à caricaturer. À la suite de la BD de Lanzac et Blain, Bertrand Tavernier s’est emparé de cette comédie. Rencontre avec le réalisateur.
Avec cette transposition à l’écran du travail de Christophe Blain et Antonin Baudry, vous faites appel pour la première fois à un matériau relevant de la bande dessinée. Est-ce exact ?
Bertrand Tavernier. J’ai lu la bande dessinée, cette bande dessinée, mais quand je fais un film, c’est sur un coup de cœur. Je ne me pose pas la question de l’origine du matériau. J’ai envie de faire le film, je le fais. C’est vrai d’un sujet historique comme la Princesse de Montpensier, qui était inspiré de la nouvelle éponyme de madame de La Fayette, mais ce l’était tout autant de L. 627, qui se déroulait presque entièrement dans un Algeco, tandis que l’histoire était coécrite par l’ancien policier Michel Alexandre. Ce n’est que longtemps après qu’on analyse les raisons qui ont conduit à nos choix. En l’occurrence, ce à quoi il faut veiller est l’erreur de sujet. Ici, je voulais m’intéresser à un cabinet ministériel, donc aux gens qui ont la tête dans le cambouis, là où les médias ne s’intéressent qu’aux gens qui parlent. Il fut un temps où, pour certains, avoir son nom dans les journaux était un signe de déshonneur. Voyez le personnage de Maupas (Niels Arestrup), les moments où il va parler sont minimaux. Je voulais avoir une justesse de ton par rapport à la période que l’on décrit – 2002 –, pensant que cette justesse continuerait à s’appliquer au-delà de l’époque. J’ai connu le chef de cabinet de Laurent Fabius. Il y a des moments qui perdurent, la différence étant que, moi, je n’ai pas fait envoler des paquets de feuilles (gag récurrent du film – NDLR).
Vous a-t-on laissé l’accès aux décors, ou tout a-t-il dû être reconstitué en studio ?
Bertrand Tavernier. Nous avons tenu à payer pour l’emploi des décors naturels. J’avais en mémoire le studio qui est installé à la Maison-Blanche, où l’on trouve une copie conforme du bureau du président, qui est juste à côté de l’original. Cela a permis de payer la réfection des toitures. Le Quai d’Orsay a été facilement accessible car le cinéma y a toujours été l’objet d’une politique de continuité, que ce soit la gauche ou la droite qui soit aux commandes. Juppé ou Toubon ont été des ministres de droite, mais ils ont pris des positions très fortes contre le Gatt (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce – NDLR). En fait, on aimerait que le président actuel soit aussi ferme contre Barroso.
Votre travail semble relever du film à clef. Qui doit-on identifier ?
Bertrand Tavernier. Aucun personnage n’est connu, sauf le ministre, Alexandre Taillard de Worms dans le film, que joue Thierry Lhermitte et dans lequel il est facile de retrouver Dominique Galouzeau de Villepin. Les autres sont des anonymes qui travaillent dans les soutes sans compter leurs heures. Le directeur de cabinet ne dépensait pas d’argent public, alors qu’il ne ménageait pas sa peine. Il aimait la langue française et défendait une ligne politique. C’est ce qui m’intéresse. L. 627 traitait de gens anonymes, la Guerre sans nom aussi. Seuls les films historiques sont différents, comme Laissez-Passer où l’on pouvait reconnaître les personnages de Jean Devaivre ou Jean Aurenche. Même le statut d’Autour de minuit n’était pas si simple. Je ne suis pas très intéressé par le biopic. Du coup, ici, il n’y avait pas besoin de montrer le président.
Vous parlez du film dans la joie. Cela a-t-il été un film facile à faire ?
Bertrand Tavernier. J’ai pris un plaisir énorme à le faire, à commencer celui de retrouver des comédiens comme Niels Arestrup ou Anaïs Demoustier. Il n’y a eu aucune condescendance. J’avais en tête Jacques Becker (le cinéaste – NDLR) et je voulais, à sa suite, aimer les personnages. J’avais envie que les spectateurs soient un peu les locataires du Quai d’Orsay. Qu’il y ait à faire des discours, à citer Héraclite à propos de la pêche aux anchois. Ils en ont bavé mais il n’y a pas de morgue. Ils ont leur franc-parler, comme Dominique de Villepin qui dit qu’on se fait chier au Conseil des ministres, ce qu’on a perdu avec Kouchner. Comme il est dit de Villepin, il nous crevait mais, dans son mouvement perpétuel, il amenait des choses. Pour moi, c’était une période où je me faisais des vacances, j’avais une possibilité de me marrer après des films aussi durs que Dans la brume électrique. J’étais complètement détendu, c’était un super film du milieu, sans aucun souci. Tout s’est passé dans un climat jubilatoire. Tous les acteurs adoraient. Ici, contrairement aux films précédents, il n’y a pas eu de problèmes physiques liés à la météo ou au froid. Pour la scène au Conseil de sécurité, on m’avait préparé un casting de figurants impressionnant, où chacun venait vraiment de son pays. Rien n’est inventé. Les figurants ont tous pris très au sérieux leur personnage, comme celui qui fixe le délégué américain, ou le Chinois impénétrable. De surcroît, j’ai pu tourner partout, sauf au Bundestag, car c’est interdit. Il m’a suffi de onze jours au Quai d’Orsay, le reste, ce sont des appartements. Je tourne toujours vite car c’est comme cela que l’on trouve les meilleures idées. Regardez le truc incongru lié à l’Iowa. J’en voulais un, mais sans savoir lequel. Cela a renvoyé à Sur la route de Madison, qui a renvoyé à Meryl Streep. C’est un vrai truc de comédie, qui fait beaucoup rire et qui s’appelle « comment démotiver une fourmilière ».
Vous êtes content de vous, donc ?
Bertrand Tavernier. Oui. Je sors du festival de Lyon (lyonnais de naissance, Bertrand Tavernier est le président de l’Institut Lumière – NDLR), qui a été un triomphe. Vous rendez-vous compte, 92 % de fréquentation pour du cinéma de patrimoine ? Je viens de faire publier, chez Actes Sud, deux romans sur l’Ouest extraordinaires, Terreur apache, de W. R. Burnett, et Des clairons dans l’après-midi, d’Ernest Haycox. Le film est un désastre mais pas le livre, qui prouve que la littérature western avait de grands romanciers. Enfin, il y a tous ces films que j’ai pu montrer à Lyon, comme le Président, d’Henri Verneuil, dans lequel on entend Jean Gabin dire, en 1961 : « Je suis pour l’Europe des travailleurs, contre l’Europe des actionnaires. » Ou des films de Michel Audiard, qui était beaucoup moins de droite qu’on pouvait le croire, sinon dans la provocation. Il y a toujours eu dans son œuvre des pulsions sociales, libertaires.
Publié par l'Humanité
- La bande annonce :
Quai d’Orsay, de Bertrand Tavernier. France. 1 h 53. Un ministre survolté, véritable pile électrique, aussi facilement porté par la bravoure bravache que s’il jouait un mousquetaire d’Alexandre Dumas, tel est le personnage qu’incarne Thierry Lhermitte dans la première comédie de Bertrand Tavernier issue d’une bande dessinée. L’observation sociale fait mouche et les mœurs n’ont guère changé dans ce portrait de famille (politique) où le culte du verbe tient souvent lieu d’action, ou, à tout le moins, d’incantation. Entourant dignement le maître, les seconds rôles sont formidables. On rit franchement et de bon cœur à cette évocation d’un passé récent.
19:02 Publié dans ACTUSe-Vidéos, Cinéma, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, dominique de villepin, entretien, bande dessinée, cinéma français, bertrand tavernier, lanzac et blain |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
12/11/2013
THIERRY LEPAON : LE GOUVERNEMENT N'ECOUTE QUE LE PATRONAT
 LE FIGARO. - Les syndicats, dont la CGT, sont absents des mouvements actuels de contestation. Pourquoi?
LE FIGARO. - Les syndicats, dont la CGT, sont absents des mouvements actuels de contestation. Pourquoi?
Thierry LEPAON. - L'efficacité du syndicalisme se mesure d'abord dans l'entreprise. Ensuite, il y a dans la période un effet de curiosité médiatique. La manifestation des «bonnets rouges» à Quimper, c'est nouveau. Le rassemblement de Carhaix, mené par la CGT, Solidaires et Sud, a été moins relayé par les médias. Mais sur le fond, le fait que les organisations syndicales n'aient pas une démarche unitaire sur les questions de l'emploi n'aide pas. Les patrons, eux, sont unis. Ce sont eux qui ont inspiré la manifestation des «bonnets rouges». Ils ont un discours identifié: ils réclament la baisse des cotisations sociales, en demandant le maintien des aides qu'ils reçoivent! La lettre de Pierre Gattaz s'engageant à créer un million d'emplois en cinq ans si les dépenses publiques baissent et si les cotisations sociales sont transférées sur d'autres impôts est pour nous une déclaration de guerre.
Comment comptez-vous réagir?
Le comité CGT de Bretagne a travaillé pour bâtir une démarche unitaire. Le 23 novembre, il y aura une manifestation à laquelle participeront toutes les organisations syndicales, à l'exception de la CFE-CGC. Mais la crise n'est pas qu'en Bretagne. Actuellement, il y a 10 plans sociaux et 1000 chômeurs de plus par jour en France! 70 % des salariés français estiment que les conditions pour bien faire leur travail ne sont pas réunies. Et puis, il y a les suicides au travail. Le climat est très tendu, c'est explosif partout. Face à cela, nous avons lancé une campagne bâtie sur un triptyque: les salaires, l'emploi et la protection sociale. Car tout est lié.
Mais pourquoi les salariés ne se mobilisent pas?
Le chômage fait peur, les salariés se replient sur eux-mêmes. C'est à nous d'aller à leur rencontre pour les remobiliser.
Le problème ne vient-il pas du fait que le motif de la fronde actuelle - le «ras-le-bol fiscal» - n'est pas compris par les syndicats?
Le «ras-le-bol fiscal» cristallise le mécontentement. J'entends des gens qui s'en plaignent, alors qu'ils ne payent pas d'impôt! Mais le vrai problème, c'est le pouvoir d'achat. À un moment, les salariés verront aussi que cela irait mieux si les rémunérations n'étaient pas bloquées comme elles le sont depuis trois ou quatre ans. Les fonctionnaires vont subir la quatrième année de gel. Et les salaires n'augmentent plus, même dans les entreprises qui vont bien. À un moment, la colère va s'exprimer par un «on veut gagner plus». Voilà pourquoi on a demandé au gouvernement d'ouvrir des négociations nationales sur les salaires, et notamment sur la question du smic, ainsi que sur l'emploi. Nous voulons discuter de l'efficacité en termes d'emploi du crédit d'impôt compétitivité emploi et des 200 milliards d'euros d'aides et exonérations que touchent les entreprises.
Avez-vous le sentiment d'être entendu par le gouvernement?
Non. Il y a deux poids deux mesures: il ne fait qu'écouter le patronat sans être récompensé. Plus il cède aux revendications des patrons, plus ils revendiquent! Il n'y a pas non plus de traitement égalitaire entre les organisations syndicales. La CFDT est ultraprivilégiée. Cela révèle un dysfonctionnement de ce gouvernement.
Êtes-vous déçu par l'équipe Ayrault?
C'est peu de le dire. Ce que je leur reproche, c'est de ne pas traiter les questions sociales qui sont pourtant urgentes. Entre ce qu'ils disaient quand ils étaient dans l'opposition ou en campagne, par exemple sur les retraites, et ce qu'ils font aujourd'hui, il y a un gouffre. Ce décalage entre les paroles et les actes nous mène dans le mur. Dans ce gouvernement, on ne sait pas qui fait quoi et on est en début de mandat! Où sont passées les réformes de fond promises pendant la campagne: la réforme fiscale, la décentralisation? Quelles sont les priorités de l'exécutif? Ça pèche par manque de responsabilité et d'innovation. Nous sommes face à une crise du politique, qui n'est pas nouvelle, mais qui s'aggrave.
N'y a-t-il pas aussi une crise de la CGT, qui n'a pas proposé d'idées fortes depuis longtemps?
Nous avons fait de nombreuses propositions sur les retraites. S'il y a eu des avancées en termes de pénibilité, d'égalité hommes-femmes et de prise en compte des années d'études, la CGT y est pour beaucoup. Mais c'est vrai que la CGT était plus efficace il y a quelques années pour lancer de nouvelles idées. À l'époque, quand on avançait une proposition, on l'accompagnait d'une action sur le terrain. Je veux revenir à cet engagement militant. On va lancer de cette façon le débat sur le coût du capital. Le travail est-il un coût, ou une richesse? C'est aussi une question essentielle. II faut que la CGT s'exprime à nouveau sur les questions économiques. C'est pour cela que j'ai créé un pole économie dans le nouvel organigramme. Nous avons les ressources internes et une trentaine d'experts extérieurs travaillent avec nous.
Vous avez mis huit mois à définir ce nouvel organigramme. N'est-ce pas le signe d'un flottement à la CGT?
Non. D'abord si l'on enlève la période des congés d'été, cela fait cinq mois. Cinq mois pour bien établir une nouvelle organisation, c'est rapide! Nous sommes maintenant en ordre de marche.
Comptez-vous mener d'autres actions contre la réforme des retraites?
Oui. Nous avons prévu une journée d'action le 19 novembre, puis des rassemblements devant l'Assemblée et les préfectures, lorsque les députés voteront le texte.
Et sur le travail du dimanche?
Nous attendons les résultats du rapport Bailly. Sur le fond, notre position est claire. Le travail atypique - le dimanche, de nuit - ne doit avoir lieu que lorsqu'il est nécessaire: dans la santé, les services publics, certaines industries… Vendre du parfum après 21 heures sur les Champs-Élysées, ouvrir les magasins de bricolage le dimanche, ce n'est pas nécessaire. Les Français disent vouloir des magasins ouverts le dimanche, mais ils ne veulent pas travailler ce jour-là! Sur ce sujet, nous faisons là aussi face à une campagne du patronat, qui paye les salariés pour manifester mais aussi des affiches et des cabinets de communication. La ficelle est grosse! Elle va finir par se voir.
14:56 Publié dans Actualités, Economie, Entretiens, Société | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le paon, gouvernement, patronat, cgt |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 














