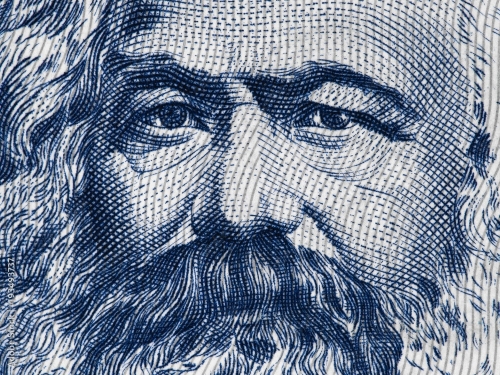Selon le Kiel Institute, qui réalise un suivi du soutien à l’Ukraine, 158 milliards d’euros ont été alloués à l’aide militaire depuis 2022 (au 31 octobre 2025). Ces aides proviennent principalement de l’Union européenne (88 milliards d’euros) et des États-Unis (65 milliards d’euros). Par ailleurs, l’Union européenne a formé plus de 85 000 soldats ukrainiens depuis le début du conflit, d’après le Conseil européen. Certains ont fait scandale pour leurs tatouages néonazis.
Les forces armées ukrainiennes comptent également sur un budget multiplié par huit, plus de 54 milliards d’euros en 2025, soit 30 % du PIB de l’Ukraine. Avec le concours d’autres puissances, les moyens financiers engagés permettent de mobiliser près de 900 000 soldats.
Mais, à la fin de la guerre, l’Ukraine ne pourra vraisemblablement pas entretenir la 7e plus grande armée du monde. La réduction des forces armées passera par la démobilisation des conscrits et des réservistes, mais certains groupes, notamment des nazis et des volontaires étrangers, pourraient ne pas revenir à la vie civile.
Certaines unités des forces armées ukrainiennes sont connues et documentées par plusieurs enquêtes de Médiapart ou du Monde, mais ça ne permet pas d’en dresser une liste exhaustive. Reste que ces unités sont entraînées, expérimentées et équipées. La plus controversée, la 3e Brigade d’assaut Azov, a reçu de l’aide américaine, comme l’a souligné une enquête vidéo du Monde publiée en juin dernier.
On peut ajouter des unités de Tchétchènes et de Tatars séparatistes et islamistes, des mouvances idéologiquement concurrentes, mais en pratique convergentes. D’autres mouvances nationalistes, étrangères, sont également engagées dans la guerre en Ukraine. On les retrouve dans la Légion internationale, forte de 20 000 hommes, dont les pays d’origine les plus représentés sont la Géorgie, la Biélorussie, les États-Unis, l’Azerbaïdjan, la France, le Brésil, la Colombie, le Royaume-Uni, la Pologne et la Suède.
Ces volontaires, parfois mercenaires, ont des motivations diverses, idéologiques, pécuniaires ou stratégiques. Pour les motivations politiques, les milieux fascistes répondent le plus présents, c’est le cas notamment pour les Français. Mais la présence d’étrangers s’explique aussi par la conviction que c’est sur ce front que l’expérience militaire acquise sera la plus décisive dans les conflits à venir. Ils sont là-bas pour apprendre. Les cartels latino-américains sont notamment suspectés de s’engager en Ukraine pour se former au pilotage des drones FPV, qui redéfinissent le combat rapproché.
En effet, cette guerre transforme profondément les opérations militaires, avec en particulier le rôle central du drone, et les deux camps acquièrent une expérience tactique et technologique considérable. Cela intéresse les armées et groupes armés du monde entier qui doivent réfléchir à des réorganisations et des évolutions doctrinales.
Quelques exemples des changements dus à l’utilisation massive des drones :
- Drones d’observation et de surveillance : meilleurs ciblage et efficacité de l’artillerie, renseignements visuels en temps réel, relative transparence du champ de bataille.
- Drones kamikazes : nouveau type de bombardements des cibles, nouvelles capacités de saturation de la défense adverse, grandes difficultés à acquérir une domination aérienne ou navale pour les deux camps.
- Drones FPV (vue à la première personne) : redéfinition du combat rapproché.
- Guerre électronique : brouillage des communications ennemies, leurres, substitution des communications filaires aux communications radio, y compris pour les drones.
- Logistique : véhicules autonomes, véhicules plus rudimentaires petits et très mobiles.
- Regain d’intérêt des petites unités de combat dans un objectif de discrétion.
- Utilisation de missiles hypersoniques pour percer la défense antiaérienne ennemie.
Les terrains de la guerre en Ukraine dépassent le cadre du Donbass. D’une part, des combattants de tous les continents sont présents sur le front ukrainien. Mais d’autre part, les forces armées ukrainiennes ont également été présentes dans de nombreuses autres zones de conflit depuis 4 ans, en Syrie, au Soudan du côté des FSR, au Sahel…
La guerre en Ukraine aura une fin, et de nouveaux problèmes vont apparaître : des combattants nombreux, entrainés, équipés et désœuvrés qui vont chercher des débouchés professionnels dans d’autres zones de conflit ; d’autres seront démobilisés, mais vont revenir dans leur pays d’origine avec une expérience militaire qu’ils pourront mettre à profit pour d’autres projets politiques. Il faut l’anticiper.
Source












 del.icio.us
del.icio.us Imprimer
Imprimer
 Digg
Digg