29/11/2014
MOSAIK RADIO : MUSIQUES ET INFORMATIONS
Le groupe E-Mosaïque se renforce avec une nouvelle radio présente sur tous ses blogs et qui diffusera essentiellement de la musique d'ambiance très diversifiée, des flashs d'informations, des magazines d'actualités .
L'objectif pour son maintien impératif est d'obtenir une audience cumulée d'au moins 300 heures par période de 24h. Nous comptons bien sûr sur vous pour atteindre cet objectif. L'idée est également que chacun d'entre vous devienne programmateur de cette nouvelle radio en proposant chanteurs et chansons.
Mosaik Radio, la radio de toutes les musiques, de toutes les actualités !
11:44 Publié dans Cinéma, Connaissances, Economie, Histoire, Médias, Musique, Société, Web | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mosaik radio, musique, informations |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
11/08/2014
L'Amérique latine derrière Gaza
Plus de 10 000 km séparent l'Amérique latine de bande de Gaza. Pourtant, les réactions sud-américaines à l'opération « bordure protectrice » ont atteint une intensité inédite.
«Une guerre d’extermination menée depuis presque un siècle» , «usage disproportionné de la force dans la bande de Gaza», «agression collective contre un peuple». Ces commentaires ne proviennent pas d'associations pro-palestiniennes, mais de hauts responsables politiques du Vénézuela, du Brésil et du Chili. Comme le rapporte (en anglais) le Washington Post, l'Amérique latine a soutenu en bloc la cause palestinienne.
 En tête des pays les plus critiques à l'égard de la politique militaire israélienne, Cuba, qui, dès la guerre du Kippour en 1973, avait mis un terme à ses relations diplomatiques avec Israël. Le Vénézuela d'Hugo Chavez, qui fut le président sud-américain à se rendre le plus en Palestine, a arrêté les relations en 2009. Dernier en date, le président bolivien Evo Morales. Le mercredi 30 juillet il inscrivait l'état hébreu sur une liste des «Etats terroristes».
En tête des pays les plus critiques à l'égard de la politique militaire israélienne, Cuba, qui, dès la guerre du Kippour en 1973, avait mis un terme à ses relations diplomatiques avec Israël. Le Vénézuela d'Hugo Chavez, qui fut le président sud-américain à se rendre le plus en Palestine, a arrêté les relations en 2009. Dernier en date, le président bolivien Evo Morales. Le mercredi 30 juillet il inscrivait l'état hébreu sur une liste des «Etats terroristes».
Mais il serait réducteur de croire que seul les gouvernements de gauche « radicale » se manifestent contre l'opération militaire menée à Gaza. «Déjà en 2009 l'opération israélienne contre Gaza « Plomb durci » avait soulevé des critiques contre l'Etat hébreu, explique Christophe Ventura, chercheur spécialiste de l'Amérique latine à l'IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques). Mais cette fois-ci, c'est historique: l'ensemble des pays de l'Amérique centrale et du sud sont sur la même ligne politique. Le Mercosur (marché commun du sud, organisation économique qui réunit l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et le Vénézuela) qui se tenait la semaine dernière à Caracas, a débouché sur une déclaration commune condamnant l'offensive israélienne à Gaza.»
«Nain diplomatique»
Un peu plus de deux semaines après le début de l'opération «Bordure protectrice», la présidente brésilienne, Dilma Roussef, rappelait pour consultation son ambassadeur en Israël après avoir qualifié de «massacre» l'offensive de Tsahal. Israël a répondu par l'intermédiaire du porte-parole de son gouvernement, Yigal Palmor, en traitant de «nain diplomatique» le géant sud-américain.
«Le Brésil se fait le porte-voix des gouvernements qui n'acceptent pas la manière dont le droit international est piétiné en fonction des intérêts occidentaux. De plus, le pays compte assumer son statut de puissance émergeante. Il veut affermir son implication dans les grands dossiers qui agitent le monde. Il ne faut pas oublier qu'en 2010 le Brésil avait fait avec la Turquie une proposition d'accord sur le nucléaire iranien. Les Etats-Unis ont refusé mais Téhéran a accepté», explique le chercheur.
Le geste fort du Brésil a entraîné dans son sillage le Pérou, l'Equateur, le Chili et le Salvador à rappeler leurs ambassadeurs. L'Argentine a convoqué l'ambassadeur d'Israël et condamné sévèrement l'entreprise militaire israélienne. Le pays a pourtant une relation privilégiée avec Israël en raison de sa communauté juive qui avec 150 000 personnes est la plus importante d'Amérique latine. De même, la Colombie, pays le plus à droite du continent et confronté à un conflit militaire interne qui l'incline à soutenir «le droit à se défendre», a pris une position non-équivoque face à Israël. Pourtant le pays est l'allié traditionnel des Etats-Unis dans la région et son armée est notamment formée par Tsahal.
Liens important entre les deux continents
«Il y a une relation charnelle entre les pays arabes et l'Amérique Latine», raconte Christophe Ventura. Ainsi le Vénézuela abrite une grande communauté syrienne. Au Brésil également, nombreux sont les citoyens ayant une origine syrienne ou libanaise. Leur part monterait à 6% de la population totale. «La communauté arabe au Brésil est très présente, tant dans la vie culturelle qu'économique ou politique. C'est un facteur qui compte, rapporte Christophe Ventura. D'ailleurs, c'est pour cela que l'ancien président brésilien Lula a pendant son premier mandat fortement contribué à créer des échanges importants avec le Proche-Orient. Entre 2001 et 2010, les exportations du Brésil vers le Moyen-Orient ont augmenté de 63%. Et de 330% avec l'ensemble des pays du Mercosur. Il ne faut pas oublier non plus que Lula fut le premier président sud-américain à se rendre en Palestine en 2002.»
À l'instar de l'Europe, des manifestations de soutien aux habitants de Gaza ont eu lieu un peu partout sur le continent latin. Le 26 juillet, une protestation devant l'ambassade israélienne a donné lieu à des heurts avec les forces de l'ordre tandis que le 1 août à Brasilia, le comité de soutien au peuple palestinien demandait officiellement la fin des relations diplomatiques avec Israël. «L'Amérique latine a un rapport différent des Américains et des Européens avec la fondation de l'Etat hébreu, analyse le chercheur à l'IRIS. Pour eux, la question israélo-palestinenne est celle d'un conflit colonial au XXIe siècle. Il y a donc chez les latinos-américains une identification à la cause palestinienne qui crée une forte empathie. Cette idée coloniale est insupportable pour l'opinion publique. Tout comme celle-ci est frappée par la violence qui s'est abattue sur Gaza.»
12:28 Publié dans Actualités, Connaissances, Histoire, International, Planète | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : amérique latine, palestine, gaza |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
15/07/2014
Michel Vovelle : "L'idée de changer le monde reste vivace"
 L’historien et spécialiste de la Révolution française livre ses réflexions sur cette insurrection et la figure de l’incorruptible révolutionnaire Robespierre décriée par les réactionnaires.
L’historien et spécialiste de la Révolution française livre ses réflexions sur cette insurrection et la figure de l’incorruptible révolutionnaire Robespierre décriée par les réactionnaires.
Professeur d’histoire moderne à l’université d’Aix-Marseille, Michel Vovelle(*) a ensuite enseigné la Révolution française à Paris I Panthéon-Sorbonne succédant à Albert Soboul à la direction de l’Institut d’histoire de la Révolution française. Il a été également président de la société des Études robespierristes de 1980 à 1990.
La Marseillaise. Que représente le 14 juillet pour l’historien que vous êtes ?
Michel Vovelle. Une date majeure de la Révolution française. Les révolutionnaires affirment la possibilité de changer le monde à partir de la mobilisation populaire, celle du peuple de Paris. Une révolution préparée par les Lumières, le mouvement des idées, mais aussi par l’évolution profonde de la société. C’est une des dates fondatrices de l’évolution vers la démocratie et l’affirmation des libertés dans le cadre de la Nation. Nous connaissons ses limites par la mise en place de la Révolution de la bourgeoisie face à l’Ancien Régime de la monarchie. Le symbole de cette affirmation est la prise de la Bastille comme représentante de l’arbitraire et de la société inégalitaire des ordres. Le 14 juillet 1789 conduira en 1792 à la chute de la monarchie et, en 1793, à la proclamation d’une nouvelle constitution.
La Marseillaise. De nos jours, cette fête autour de l’insurrection de tout un peuple s’est transformée en un vaste défilé militaire, comment l’expliquer ?
Michel Vovelle. En 1900, on a deux visages du 14 juillet. Le défilé du village, on va au monument aux morts et la fête du soir avec le bal autour de l’héritage vivant de la Révolution française. Au lendemain de 1945 et la Libération, il n’y a pas encore de rupture entre la fête populaire et le défilé. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l’armée se fera de plus en plus l’agent des guerres coloniales. Elle prend le visage réactionnaire. L’ardeur patriotique liée à la Résistance se défait dans le cadre d’une armée instrument du maintien de l’ordre mondial à l’époque de la décolonisation. En même temps, la fête profane décline en se vidant de son contenu, l’on danse moins. La fête militaire subit un grand tournant avec la fin de l’armée citoyenne. Sa professionnalisation marque une rupture entre l’aspect militaire du 14 juillet et le sentiment collectif. Aujourd’hui, le 14 juillet a un statut menacé. Il serait précieux de continuer à lui donner le sens de ses origines, celle de l’expression du peuple à changer l’ordre du monde.
La Marseillaise. Aujourd’hui, que reste-t-il de la Révolution française dans la mémoire collective ?
Michel Vovelle. Le bicentenaire de la Révolution française a permis de mesurer ce qu’il restait de cet héritage. 70% des Français ont exprimé une valeur positive de changement fondamental. Associée à l’idée que cette révolution est terminée. Idée confortée par l’implosion des régimes socialistes. Ce bouleversement des années 90 a contribué à affaiblir l’espoir d’une révolution en train de se faire. D’autres révolutions ont éclaté dans des pays arabes. Par-ici, la révolution n’est pas pour demain. Pour le moment, il y a une sorte de désenchantement. Cependant, il reste toujours un noyau de gens pour rêver d’une révolution à venir. L’idée de changer le monde reste vivace.
La Marseillaise. Le Maire du 5e secteur de Marseille envisage de débaptiser la place Robespierre. Que vous inspire les frondes contre le révolutionnaire ?
Michel Vovelle. Après Thermidor(**), Robespierre est identifié à la Terreur, à la révolution sanglante. Il a été le premier à demander l’abolition de la peine de mort, à prôner des réformes démocratiques, l’égalité des citoyens, des juifs, des noirs et de tous les marginaux. Ce pan de l’histoire a été oublié, voire gommé. L’image négative a prévalu dans le camp contre-révolutionnaire mais aussi à l’intérieur du camp des héritiers de la Révolution. On lui a opposé la figure de Danton, l’indulgent, le héros à visage humain, Robespierre c’est l’inflexible et l’incorruptible, l’homme de la révolution radicale. Il y a également en littérature une diabolisation du personnage qui perdure aujourd’hui. Jacques Duclos, ancien Secrétaire général du PCF, raconte dans ses mémoires que lorsqu’il était Maire de Montreuil, il attendait avec impatience la prolongation du métro afin de pouvoir donner à une station le nom de Robespierre, c’est chose faite à Montreuil. En France, il y a très peu de places ou de rues portant son nom. A Paris, aucune. Je me suis rendu dans la capitale en délégation avec des militants de la Libre pensée. « Pourquoi n’y a t-il pas de rue ou de place Robespierre ? », avons-nous demandé à Anne Hidalgo. Elle a répondu qu’il ne faisait pas l’unanimité, alors que, deux mois auparavant, le Maire avait inauguré la place Jean-Paul II. Je suis très fier qu’il ne fasse pas l’unanimité.
La Marseillaise. Pour quelles raisons êtes-vous robespierriste ?
Michel Vovelle. C’était un homme qui croyait en ce qu’il faisait. Il est de ceux qui ont voulu changer le monde en prenant ses responsabilités. Celles de la Terreur mais corrigée par la vertu au nom de la défense de la patrie et du peuple. « Nous sommes les sans-culottes et la canaille », disait Robespierre. Dans la grande histoire de la Révolution française Jean Jaurès s’interroge sur le héros révolutionnaire et finit par dire : « C’est à côté de lui que je vais m’asseoir aux Jacobins. »
Propos recueillis par Piedad Bemonte (La Marseillaise, le 14 juillet 2014)
 (*) Michel Vovelle est aussi l’auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date « La Révolution française expliquée à ma petite-fille ». Éditions du Seuil, 2006.
(*) Michel Vovelle est aussi l’auteur de nombreux ouvrages. Le dernier en date « La Révolution française expliquée à ma petite-fille ». Éditions du Seuil, 2006.(**) Le 27 juillet 1794, les robespierristes sont renversés.
10:00 Publié dans Connaissances, Entretiens, Histoire, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution française, vovelle, changement |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
31/05/2014
La science est-elle une voie vers la vérité ?
Variations sur la mécanique quantique
 La mécanique quantique (MQ) a la spécificité d’ébranler notre intuition directe et de nous faire renoncer à un objectif attendu de la science, celui de décrire, auquel elle substitue celui de prédire. Et de prédire non pas un évènement certain, mais la probabilité des résultats d’une mesure, une fois spécifiée la situation spatio-temporelle dans lequel elle a été réalisée.
La mécanique quantique (MQ) a la spécificité d’ébranler notre intuition directe et de nous faire renoncer à un objectif attendu de la science, celui de décrire, auquel elle substitue celui de prédire. Et de prédire non pas un évènement certain, mais la probabilité des résultats d’une mesure, une fois spécifiée la situation spatio-temporelle dans lequel elle a été réalisée.
Cela peut se traduire par une non-localité à la fois temporelle et spatiale, donc une contextualité, puisque les observations dépendent du contexte expérimental. Diverses interprétations n’ont cessé d’être proposées depuis la naissance de la MQ, et continuent de foisonner, toutes s’accordant avec les observations expérimentales et ne pouvant être réfutées sur des critères empiriques. Ainsi, l’idée d’une correspondance possible entre une théorie et une réalité empirique, voire l’existence d’une telle réalité sont loin de faire l’unanimité.
C’est de cela que se nourrissent les débats épistémologiques chez les philosophes occidentaux, dans la droite ligne des questions auparavant posées par les philosophies grecque et islamique.
Accueillir la perplexité offre une ouverture à l’altérité.
Inès Safi.
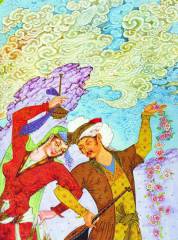 L’empirisme est fragilisé par la sous-détermination des théories par l’expérience. Et le réalisme semble ébranlé, et avec lui le déterminisme. Or certaines interprétations en termes d’entités ontologiques, ont tenté de sauver le réalisme, mais ont dû renoncer à deux intuitions : la localisation de ces entités, et l’accès (du moins en principe) à tout ce qui « existe ».
L’empirisme est fragilisé par la sous-détermination des théories par l’expérience. Et le réalisme semble ébranlé, et avec lui le déterminisme. Or certaines interprétations en termes d’entités ontologiques, ont tenté de sauver le réalisme, mais ont dû renoncer à deux intuitions : la localisation de ces entités, et l’accès (du moins en principe) à tout ce qui « existe ».
Nous assistons à d’autres visions qui vont à l’encontre du réalisme, et qui tendent à remplacer la notion de propriété intrinsèque par une relation. On tentera ici de dégager cette approche systémique, à la fois sur le plan de l’épistémologie et sur celui de la métaphysique islamique. Non seulement la vérité prend sens dans la relation que le sujet a avec l’objet, mais encore le sens émerge de cette co-naissance.
Cela est illustré à travers des représentations diverses de la MQ par des physiciens, intimement liées à leurs croyance. Il faut désormais se familiariser avec la multiplicité et l’indécidabilité de certaines assertions. C’est simultanément une invitation à relativiser le statut des théories scientifiques, élaborées dans un certain contexte humain complexe, de même que celui de certaines « vérités » religieuses.
Accueillir la perplexité offre une ouverture à l’altérité.
Par Inès Safi.
 Née en Tunisie, Inès Safi est diplômée de l’Ecole Polytechnique de Palaiseau et chercheuse CNRS en théorie de la matière condensée, au Laboratoire de physique des solides à Orsay, où elle étudie des système de taille nanométrique.
Née en Tunisie, Inès Safi est diplômée de l’Ecole Polytechnique de Palaiseau et chercheuse CNRS en théorie de la matière condensée, au Laboratoire de physique des solides à Orsay, où elle étudie des système de taille nanométrique.
Reconnue sur le plan international notamment pour son expertise dans les systèmes unidimensionnels, elle s’intéresse aussi, depuis quelques années, aux significations de la mécanique quantique, ainsi qu’aux questions éthiques et environnementales posées par la science. Elle est invitée à divers colloques et débats sur le thème « science et religion ».
Information
- Retrouvez le texte complet d’Inès Safi dans « Science et religion en Islam : des musulmans parlent de la science contemporaine », sous la direction de Bruno Abd al-Haqq Guiderdoni;
- Découvrez également sa page facebook
15:10 Publié dans Connaissances, Histoire, Inès Safi, Point de vue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences, vérité, ines safi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
28/04/2014
Quand la Cour suprême américaine mine la démocratie
Il y a certaines décisions qui, prises à Washington, nous concernent directement. C’est le cas de celle qu’a prise mercredi la Cour suprême dans l’affaire McCutcheon vs FEC : au nom du Premier amendement de la Constitution, qui promeut la liberté d’expression, les juges suprêmes, par cinq voix contre quatre, ont refusé que soient plafonnés les dons que peuvent faire les particuliers pour des campagnes électorales.
Le plafond, fixé à 123 200 dollars, a donc disparu depuis mercredi. En débridant le rôle des plus riches dans le processus politique, la Cour renforce concrètement leur influence, déjà immense, sur les décisions publiques.
Prise au nom de la liberté, sa décision aboutit à miner celle-ci. Car quelle est la liberté des citoyens dans un système de plus en plus ploutocratique, de moins en moins démocratique ?
Un enjeu de civilisation
On pourrait se dire que c’est certes scandaleux, OK, mais que c’est l’affaire des Américains : « Tant pis pour eux ! » Ce serait raisonner à courte vue. Que la première puissance mondiale se laisse glisser sur cette pente-là est une mauvaise nouvelle non seulement pour le peuple américain, mais aussi pour le reste de la planète.
Cette dérive ploutocratique américaine ne fait qu’accroitre, dans l’ensemble du monde, la course de l’accumulation de l’argent vers une petite élite bien décrite par l’économiste français Thomas Piketty dans « Le Capital au XXIe siècle » (un livre publié chez Seuil, et dont la traduction fait sensation aux Etats-Unis, soit dit en passant). L’enjeu n’est donc pas seulement américain : c’est un enjeu de civilisation.
La Cour suprême. Pastilles rouges : les plus conservateurs, majoritaires (Steve Petteway/Wikimé ; dia Commons)
La Cour suprême a perdu une occasion de mettre un coup d’arrêt à cette dérive de l’argent en indiquant qu’on est allé bien trop loin. C’est ce que souhaitaient les quatre juges (dont les trois femmes de la Cour) qui ont voté contre la décision.
Lorsque, comme c’est le cas outre-atlantique, 85% des élus sont ceux qui ont dépensé le plus d’argent pour leur campagne, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Lorsque des milliardaires créent leur propre structure politique, comme c’est le cas des frères Koch, obsédés par l’idée de chasser Obama du pouvoir, il y a même quelque chose de pourri au cœur du système.
« La voix de l’argent à plein volume »
Dans un avis dissident joint à la décision, le juge Stephen Breyer, nommé par Clinton, résume le problème d’une formule :
« Quand la voix de l’argent s’exprime à plein volume, celle des citoyens devient inaudible. »
Selon lui, cette décision, qui fait suite à une autre de la même eau (Citizens United vs FEC) empêche tout contrôle du financement de la vie politique et de ce fait soulève « de graves problèmes de légitimité démocratique ». Des mots qui, sous la plume d’un des garants de la Constitution américaine, sont très lourds.
Sans surprise, ce sont les cinq juges conservateurs, qui ont voté pour laisser la voix de l’argent « s’exprimer à plein volume ». Selon eux, « dépenser des larges sommes d’argent en lien avec une élection, et non en vue de contrôler l’exercice du pouvoir de celui qui sera en charge, n’est pas en soi un pacte de corruption [en VO : “quid pro quo corruption”, ndlr] ». Une vision bien étroite du mot corruption...
10:30 Publié dans Actualités, Cactus, Histoire, International | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : usa, cour suprême, politique, élections |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 











