03/07/2007
LE BLAIRISME
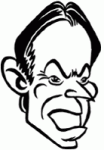 « Il serait suicidaire pour la gauche d’importer en France le blairisme »
« Il serait suicidaire pour la gauche d’importer en France le blairisme »
par Philippe Marlière, maître de conférences en sciences politiques à l’université de Londres.
Faisant ces derniers jours le bilan des années Blair, les médias français parlaient de pragmatisme, de thatchérisme social, de modernisme, de social-démocratie… Qu’en pensez-vous ?
Philippe Marlière. En 1998, devant les députés français, Tony Blair déclarait : « Il n’y a pas de politique économique de droite ou de gauche, mais des politiques économiques qui marchent et d’autres qui ne marchent pas. » Il affichait ainsi son soi-disant modernisme politique et sa volonté de rompre avec « le vieux travaillisme ».
Ce pragmatisme porté très haut a fait place à des choix beaucoup plus idéologiques.
En fait, le blairisme est resté sur les rails du thatchérisme avec des correctifs à la marge pour les plus pauvres, les familles monoparentales. Il a mis en place un filet de sécurité pour ces catégories, mais n’a pas réduit les inégalités qui se sont au contraire largement accrues. Dans les services publics il n’a pas rompu avec le paradigme thatchérien. La rénovation des écoles, des hôpitaux s’est faite en associant étroitement le privé à leur construction et à leur gestion. Le choix de Blair et de Brown d’accompagner et non de réguler la mondialisation a fait que Londres et le Royaume-Uni sont devenus la plaque tournante d’une économie dérégulée, totalement flexible où seuls les plus riches peuvent s’en sortir. Un exemple : la spéculation immobilière qui chasse les classes moyennes des centres-villes.
Derrière ce pragmatisme de façade, Blair a imposé des politiques rejetées non seulement par les syndicats, mais également par une grande partie des travaillistes, les médias et aussi par le public. Ainsi, la rénovation du métro de Londres a donné lieu à une longue bataille contre la gestion privée du service public.
Le maire, Ken Livingstone, s’est opposé à cette privatisation, mais Blair et Brown sont passés outre démontrant que leur pragmatisme n’était qu’un slogan.
Tony Blair est-il social-démocrate ?
En France, à gauche, surtout à gauche du PS, ce terme est synonyme de droite. C’est un raccourci. Pendant les Trente Glorieuses, la social-démocratie n’a pas été forcément droitière, y compris en Grande-Bretagne. Elle a proposé un mode de redistribution assez égalitaire. Ce n’est pas la politique qu’a suivie Blair. Avec lui, les ouvriers, les fonctionnaires et les classes moyennes du privé ont été laissés de côté.
Il est amusant de voir certains médias français parler d’un blairisme social, alors qu’en réalité il a repris les recettes néolibérales du thatchérisme et privilégié les tenants du capitalisme financier. Non, il a fait moins que le strict minimum. Après vingt ans de gouvernement ultralibéral, après les privatisations catastrophiques du thatchérisme, la population n’en pouvait plus du néolibéralisme et elle souhaitait une réelle rénovation des services publics et davantage d’égalité. Elle n’attendait pas la révolution mais une politique plus sociale-démocrate. Le blairisme n’a pas été à la mesure de cela. Blair a manqué d’audace alors qu’il s’appuyait sur une majorité absolue.
Ce qui a caractérisé son action, c’est un profond pessimisme social.
Tony Blair est-il de gauche ?
Philippe Marlière. Lorsqu’on est à la tête d’un gouvernement de gauche, fut-il hypercentriste, post-social-démocrate même, à quoi juge-t-on sa réussite ? À l’aune d’un combat en faveur de la justice sociale. Dans ce domaine Blair a failli. Ce sont les riches qui ont prospéré sous le blairisme. Les autres catégories sociales ont eu beaucoup de mal.
En Grande-Bretagne, les classes moyennes « galèrent », ce qui fait que le blairisme est devenu très impopulaire parmi les salariés et les cols blancs.
Ce n’est donc pas seulement la guerre en Irak qui explique la relative impopularité de Blair aujourd’hui…
Philippe Marlière. Vu de Grande-Bretagne, la guerre d’Irak n’explique qu’en partie cette impopularité. Elle est en effet un énorme fiasco, tout le monde le reconnaît sauf Tony Blair. Elle a entraîné le décrochage de catégories qui étaient très blairistes. Ceux qu’on appelle en France les « bobos ». Des gens aisés qui ne veulent pas de hausse des impôts, qui mettent leurs enfants dans les écoles privées, mais qui sont progressistes sur les questions sociétales, d’environnement et de moeurs. Pour eux la guerre d’Irak, c’était trop.
À ceux qui affirment en France que Blair s’en est bien sorti exceptée sur l’Irak, je dirais : Blair a échoué sur l’Irak et il a également échoué dans le domaine économique et social. Les résultats macroéconomiques sont peut-être corrects mais à qui a profité la croissance ?
Aux riches, pas au peuple.
 Ségolène Royal et Dominique Strauss-Kahn se sont à plusieurs reprises référés à Tony Blair. Y a-t-il une tentation blairiste au PS ?
Ségolène Royal et Dominique Strauss-Kahn se sont à plusieurs reprises référés à Tony Blair. Y a-t-il une tentation blairiste au PS ?
Philippe Marlière. Incontestablement le Parti socialiste français et tous les partis qui siègent à Bruxelles dans le Parti socialiste européen (PSE) sont traversés par cette tentation. Il y a ceux qui pensent que Blair a fait le maximum. Vous avez cité Royal et DSK, je suis d’accord. Mais il y a encore des socialistes qui pensent que le blairisme n’a rien à voir avec la gauche sociale-démocrate, qu’il est tombé du côté de la droite et qu’il faut donc le combattre. DSK a bien étudié le blairisme, il a des contacts étroits avec ses dignitaires, il pense que le socialisme à la française doit s’en inspirer, c’est son horizon, c’est idéologique. Quant à Royal, sa campagne peut être qualifiée de blairiste. Elle se situe même en deçà comme on l’a vu a posteriori avec sa critique des 35 heures et du SMIC (incroyable ! Même Blair a revalorisé le SMIC). Elle a aussi adopté du blairisme son versant sécuritaire. Il me semble que dans ces moments de grande incertitude socio-économique, quand les plus défavorisés souffrent des restructurations, des délocalisations, d’un pouvoir d’achat rogné, un gouvernement de gauche devrait défendre ces catégories et non exacerber la dérégulation néolibérale en disant : soyez contents d’avoir un boulot même mal payé et flexible.
Aujourd’hui, l’opposition politique majeure n’est plus entre la gauche et la droite, mais c’est une opposition qui traverse les partis sociaux-démocrates et qui met face à face blairistes et progressistes.
Nicolas Sarkozy affiche lui aussi sa proximité avec Tony Blair…
Philippe Marlière. Que Nicolas Sarkozy se réfère à Blair sur le plan économique, approuve ses politiques sécuritaires et partage son admiration pour les États-Unis, c’est dans la logique des choses. C’est un fait connu ici, Blair souhaitait la victoire de Sarkozy. Entre les deux hommes, il existe une admiration et une sympathie mutuelle. Les politiques de Blair et les intentions déclarées de Sarkozy coïncident.
Quels enseignements tirez-vous du blairisme pour la gauche française ?
Philippe Marlière. Il a pu prospérer électoralement dans des conditions politiques particulières, après vingt ans de thatchérisme et de défaite en rase campagne de la gauche britannique, depuis la grève des mineurs jusqu’à la reprise en main du Parti travailliste par Neil Kinnock. Celui-ci avait préparé le terrain avec les purges des éléments de gauche du Parti travailliste, pas seulement les trotskistes, mais des sociaux-démocrates bon teint, qui ont été mis de côté progressivement en une dizaine d’années. Le mode de fonctionnement du parti est devenu plébiscitaire et a renforcé les pouvoirs du leader. Quand Blair en prend la tête en 1994, il n’a plus qu’à mettre en oeuvre sa politique. C’est un premier point important. Ensuite, il est arrivé au pouvoir alors que les conservateurs faisaient l’objet d’un rejet viscéral et qu’il y avait un grand espoir populaire pour le changement. Malgré les échecs des dernières années, malgré tout ce qu’on peut reprocher à la gauche, et au PS en particulier, la France reste culturellement, idéologiquement, beaucoup plus à gauche que la Grande-Bretagne. La thèse de la « droitisation » de la société française, défendue par certains, n’est pas démontrée. Tous les sondages qualitatifs montrent, à l’inverse, qu’il existe une forte attente sociale. C’est tout le génie stratégique de Sarkozy d’avoir fait voter en faveur d’une plate-forme néolibérale tout en ayant pris soin, le temps de la campagne électorale, de flatter l’électorat de gauche. Cela lui a permis de remporter une élection que la gauche aurait dû gagner. Il serait suicidaire pour cette dernière d’importer en France le blairisme et son pessimisme social, de promouvoir une politique qui viendrait décourager ce qui a au contraire besoin d’être réactivé : l’aspiration à davantage de solidarité et de justice sociale.
Entretien réalisé par Jacqueline Sellem pour l'Humanité
10:48 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Blair, Ségolène Royal, Grande Bretagne, Social Démocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
03/05/2007
MAI 1968
 L’ancien secrétaire général de la CGT réplique au discours du candidat de la droite sur mai 1968.
L’ancien secrétaire général de la CGT réplique au discours du candidat de la droite sur mai 1968.
En entendant devant son poste de télévision Nicolas Sarkozy diaboliser mai 1968, le sang de Georges Séguy n’a fait qu’un tour. L’ancien secrétaire général de la CGT, principale centrale syndicale, et leader, à l’époque, de la grève ouvrière, sait de quoi il parle...
Comment avez-vous réagi à chaud ?
Georges Séguy. J’ai sursauté. Je comprends que les événements de Mai 1968 aient laissé un douloureux souvenir dans la mémoire des réactionnaires et spécialement dans celle du patronat. Mais c’est la première fois que j’entends un politicien comme Nicolas Sarkozy condamner dans des termes aussi rétrogrades ce moment mémorable de notre histoire sociale nationale. Car ce qui fait l’importance historique de Mai 1968, ce ne sont pas essentiellement les violences policières du Quartier-Latin, ni les controverses légitimes des différents courants philosophiques de cette époque, c’est la grève générale de dix millions de travailleurs occupant les entreprises.
Quels en furent les résultats que tout le monde n’a pas en mémoire ?
Georges Séguy. Les travailleurs étaient excédés, depuis des années, par l’opposition gouvernementale et patronale à tout progrès social. L’arrêt général du travail a eu ce but : faire sauter le blocage, obtenir l’ouverture d’une véritable négociation. L’immense majorité des usines une fois occupées, souvent pour la première fois, elle s’engagea le 25 mai 1968 à Grenelle, au ministère du Travail.
Cela n’a pas traîné. En quelques heures de délibération, nombre de revendications, qu’il serait trop long d’énumérer, furent prises en compte. Dont la plus extraordinaire : l’augmentation de 30 % du SMIC. Quand on voit les conciliabules sur le SMIC à 1 500 euros, brut ou net, il n’est pas superflu de rappeler que cette revalorisation du salaire minimum et des petits salaires dans les régions, comme en Bretagne, stimula la consommation intérieure à tel point que la croissance économique connut l’une des plus importantes augmentations de la période dite des « Trente Glorieuses ».
Mais vous parlez des ouvriers, de leur grève, et c’est justement de cet aspect dont ne parle pas Nicolas Sarkozy. N’y a-t-il pas malentendu ?
Georges Séguy. Non, Sarkozy sait très bien ce qu’il fait. Il censure, dans ses propos, la grève ouvrière parce que cela contredit son attaque contre mai 1968. Il ne peut pas à la fois clamer son amour pour les ouvriers et vilipender ceux-ci quand ils font accomplir un bond en avant à leur propre condition et à la société. L’ouvrier qu’il respecte c’est celui qui se lève tôt et se défonce pour son patron, même si celui-ci le met dehors un jour, ce n’est pas celui qui se couche tard pour préparer l’action qui aidera les autres à se défendre et à vivre mieux. Son slogan « Travailler plus pour gagner plus » est trompeur. Pour gagner plus, il faut lutter plus. Je mets au défi quiconque, au vu de l’histoire, de démontrer le contraire.
Quel est l’enjeu de cette diatribe ?
Georges Séguy. Cette condamnation haineuse, assimilant voyous et acteurs des luttes, militants, syndicalistes, cherche à discréditer un mouvement où justement la fameuse valeur travail que brandit Sarkozy s’imposa spectaculairement à ceux qui ne pensent qu’à le surexploiter à leur profit. Ce mouvement profond reste et restera, très au-delà des prétentions d’un politicien, comme l’un des exemples les plus significatifs de l’attachement des travailleurs français au modèle social issu du programme du Conseil national de la Résistance.
Nicolas Sarkozy n’hésite pas cependant à se référer à cette même Résistance, au général de Gaulle, à Jean Moulin, à Guy Môquet. Quelle est votre réaction, vous qui avez été déporté résistant très jeune ?
Georges Séguy. Il a le front effectivement de citer ces noms glorieux. Mais, c’est précisément les grandes conquêtes sociales imposées par la Résistance unie qu’il veut détruire : la Sécurité sociale fondée sur la solidarité des générations, le droit à la retraite, les libertés syndicales, les nationalisations, les grands services publics, etc. Son programme, c’est le programme inversé du CNR. En vouant aux gémonies mai 1968, cette historique avancée sociale, tout en serinant son amour pour les travailleurs, Sarkozy montre que, s’il était élu, le modèle social français ne survivrait pas à sa ferveur dévorante pour le travail.
On sait que les vues du monde ouvrier et du monde étudiant n’étaient pas, en 68, exactement les mêmes. Peut-être Sarkozy croit-il, d’ailleurs, pouvoir spéculer là-dessus. Et cependant, le mot d’ordre du grand défilé du 13 mai 1968 était « étudiants-travailleurs solidarité », ce qui finalement réunissait les uns et les autres était une sorte de soulèvement contre un ordre social qu’ils subissaient à des titres divers...
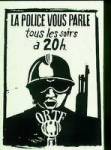 Georges Séguy. À mes yeux, dans les propos du chef de l’UMP, il y a quelque chose de très important qui vaut globalement pour mai 1968. Mis à part les diversions gauchisantes de quelques groupes, mai 1968 est aussi une formidable révolte de la jeunesse contre les adeptes d’une pensée unique et un pouvoir politique d’esprit totalitaire qui tendait à scléroser la démocratie.
Georges Séguy. À mes yeux, dans les propos du chef de l’UMP, il y a quelque chose de très important qui vaut globalement pour mai 1968. Mis à part les diversions gauchisantes de quelques groupes, mai 1968 est aussi une formidable révolte de la jeunesse contre les adeptes d’une pensée unique et un pouvoir politique d’esprit totalitaire qui tendait à scléroser la démocratie.
Il y a eu, alors, un vaste élan juvénile vers une société libérée de la ringardise de certaines mentalités, de l’injustice, et du carcan de toutes sortes d’interdits, de tabous. On a assisté à une puissante volonté d’émancipation sociale, politique et culturelle. Pour les femmes, c’est le rejet de l’inégalité et de la discrimination, la force novatrice du féminisme, des droits de la femme. En bref, mai 1968 est un grand mouvement social et une extraordinaire demande de modernisation des moeurs, des habitudes, de la société, dont le mouvement ouvrier, j’en témoigne, n’a peut-être pas pris, sur le moment, la juste mesure. En clamant sa répugnance pour cette volonté d’émancipation, Nicolas Sarkozy laisse apparaître la préférence de son camp, celui du grand patronat, pour un système monarchique arriéré.
Entretien réalisé par Charles Silvestre, pour l'Humanité
13:31 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : Georges Séguy, mai 1968, Sarkozy |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
24/04/2007
Patrice Cohen-Seat (PCF) : «Il y a eu un effet de souffle du vote utile»
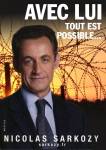 Le directeur de campagne de Marie-George Buffet revient sur le score historiquement bas de la candidate soutenu par le Parti communiste français. Selon lui, le tout sauf Sarkozy et le vote utile qui en découle masquent la réalité d'un PCF qui « va bien ».
Le directeur de campagne de Marie-George Buffet revient sur le score historiquement bas de la candidate soutenu par le Parti communiste français. Selon lui, le tout sauf Sarkozy et le vote utile qui en découle masquent la réalité d'un PCF qui « va bien ».Patrice Cohen-Seat : Non, pas du tout. Ça fait partie des paradoxes de la situation, de la campagne et de ses résultats. Marie-George Buffet a mené une très belle campagne avec une mobilisation que nous n'avions pas vu depuis une quinzaine d'années. Et en même temps, il y a le résultat qu'on connaît. Ça fait partie du paradoxe. Et l'autre paradoxe, c'est qu'on a rencontré dans cette campagne les attentes qui s'étaient exprimées dans les grandes mobilisations (lors des réformes Raffarin, le non à l'Europe, le CPE). Et dans les milieux populaires nous avons rencontré une adhésion au programme de rupture de gauche avec les politiques libérales que portait Marie-George Buffet.
Alors comment expliquez-vous le résultat obtenu ?
La campagne a fini par être dominée par une seule question : pour ou contre Sarkozy. Non seulement parce qu'il y avait l'ombre portée du 21 avril 2002. Mais aussi parce que le fait que Nicolas Sarkozy se soit placé sur le terrain de la droite et de l'extrême droite, et que pour attirer cet électorat il ait repris à son compte les thèmes du FN. En extrémisant son projet politique, il est devenu, à gauche, un danger majeur. De ce fait, tout ce qui s'écartait de l'effort pour battre Sarkozy est devenu un risque imprenable. Il y a eu un effet de souffle du vote utile, qui s'est traduit pour toutes les candidatures de gauche. Autre explication : il n'y a pas eu d'autres enjeux, autre que la volonté de battre Sarkozy. Cela pose de grandes interrogations sur l'état de la société, sur des régressions idéologiques réelles. Le thème de l'assistanat a pris le pas sur celui de la solidarité. On a lié de manière inacceptable l'importance de l'immigration aux questions de sécurité. C'est un vrai problème.
Vous appelez à voter pour Ségolène Royal. Que doit-elle faire pour espérer battre Nicolas Sarkozy ?
Nous mènerons campagne pour battre Nicolas Sarkozy parce qu'il est vraiment un grand danger. Il ne faudrait pas qu'il y ait à gauche des gens qui sous-estiment ce danger et qui, parce qu'ils sont déçus du pacte présidentiel de Ségolène Royal, soient absents de ce rendez-vous. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Nous allons mener une véritable campagne pour battre Sarkozy.
Est-ce que cela peut inclure des meetings avec le Parti socialiste ?
Rien n'a encore été envisagé. Je ne sais pas si c'est envisageable parce que ce que nous voulons c'est mobiliser de toutes nos forces pour battre Nicolas Sarkozy et inscrire sa défaite dans un effort, notamment en vue des législatives et au-delà, pour construire une véritable alternative de changement à gauche. Et là, le discours différera très sensiblement entre ce que pourra dire Ségolène Royal pour le deuxième tour, et le contenu politique que nous donnerons pour battre Nicolas Sarkozy.
Pour les élections législatives, avez-vous des discussions avec les autres antilibéraux ?
Les discussions sont très avancées. C'est au niveau local que cela se construit, avec tout ceux avec qui nous avons été en lien ces dernières années, notamment les collectifs antilibéraux. Il y a déjà beaucoup de candidatures fixées avec des communistes et beaucoup de non-communistes également. Nous travaillons au rassemblement de tout ceux qui veulent porter un projet de gauche antilibérale. Après chacun fait ses choix. On l'a vu pour les présidentielles. Mais j'espère que les législatives constitueront une étape importante en vue de la construction d'une véritable alternative de changement à gauche.
Quel est l'avenir du PCF ?
Il va bien, ça fait partie des paradoxes. Il se porte mieux qu'en 2002. Il y a plus d'adhérents. Plus de 8000 jeunes de moins de 30 ans ont adhéré l'année dernière. Je ne nie pas la réalité, mais ça fait partie du paradoxe. Il y a de véritables attentes à gauche et le PCF est en phase avec ces attentes. Nous sommes touchés par le souffle du vote utile comme les Verts. On voit dans les résultats que l'électorat Vert de Paris a fondu. Est-ce que cela veut dire que leur électorat a disparu de Paris ? Absolument pas. Que les préoccupations écologiques ont disparu ? Non plus. Ce n'est pas ces questions là que se sont posés les hommes et femmes de gauche à cette élection.
09:56 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : Marie George Buffet, Présidentielles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 
18/04/2007
UNE AUTRE VISION DU SPORT
 « Il n’y a pas de star en rugby » Rugby . Pour l’entraîneur Henry Broncan, l’amitié et la solidarité sont la clé de l’accession du FC Auch-Gers (Pro D2) dans le Top 14. Homme de gauche, il se raconte sans détours. Entretien.
« Il n’y a pas de star en rugby » Rugby . Pour l’entraîneur Henry Broncan, l’amitié et la solidarité sont la clé de l’accession du FC Auch-Gers (Pro D2) dans le Top 14. Homme de gauche, il se raconte sans détours. Entretien. Auch (Gers), correspondance particulière.
Ancien professeur d’histoire-géographie, entraîneur de l’équipe amateur de Lombez-Samatan, Henry Broncan entraîne le FC Auch-Gers depuis neuf ans. Après sa victoire 31-0 face à Tarbes samedi (27e journée), son club, sacré champion de Pro D2, est désormais mathématiquement assuré d’accéder au Top 14 la saison prochaine. Homme de gauche, il raconte sans détours comment il applique ses valeurs au rugby.
Comment expliquez-vous la réussite de votre équipe ?
 Henry Brocan. C’est une aventure humaine formidable, alors que nous avons le plus petit budget de la Pro D2 (2,3 millions d’euros). Trente-cinq joueurs ont évolué régulièrement dans l’équipe, selon une rotation. Cela a permis de garder une certaine fraîcheur. À la dernière intersaison, nous avons effectué un recrutement de qualité et l’équipe est très soudée. Chacun a trouvé sa place. L’équipe a étonné ses adversaires par sa solidarité.
Henry Brocan. C’est une aventure humaine formidable, alors que nous avons le plus petit budget de la Pro D2 (2,3 millions d’euros). Trente-cinq joueurs ont évolué régulièrement dans l’équipe, selon une rotation. Cela a permis de garder une certaine fraîcheur. À la dernière intersaison, nous avons effectué un recrutement de qualité et l’équipe est très soudée. Chacun a trouvé sa place. L’équipe a étonné ses adversaires par sa solidarité.
La solidarité permet-elle de compenser la faiblesse du budget ?
Henry Brocan. Le rugby est un sport extrêmement collectif. Les chefs d’entreprise qui arrivent dans notre sport ne comprennent pas que la vérité est remise en cause chaque week-end. On ne peut pas programmer les rapports humains. Pourquoi un groupe réussit et pas un autre ?
On ne peut pas le savoir en début de saison. Il y a tellement de tâches ingrates dans le rugby que, s’il n’y a pas d’amitié entre les joueurs, elles ne sont pas effectuées. Je regrette l’individualisation. Après un match, on récompense le talent d’or. Ce n’est pas ça le rugby ! Je ne crois pas à la star en rugby. Les journalistes créent des stars pour faire rêver, mais ce n’est pas l’essence de notre sport. Un seul joueur peut faire gagner son équipe ? Je n’y crois pas. Il y a trop d’écarts de salaire entre les joueurs. À Auch, les salaires vont de 1 à 3, mais les niveaux sont très faibles. Beaucoup de joueurs touchent le SMIC.
Quelle est votre part dans la réussite d’Auch ?
Henry Brocan. J’ai toujours su avoir autour de moi un groupe solidaire. J’ai bien choisi le staff technique : les deux co-entraîneurs, les préparateurs physiques, le kiné, le diététicien, le psychologue bénévole...
Qu’avez-vous apporté au jeu de l’équipe ?
Henry Broncan. Je suis un homme âgé (soixante-trois ans - NDLR), un homme du passé. Les innovations, ce n’est pas mon fort. Je ne suis pas un novateur, je suis un copieur. Je suis aussi un homme de rigueur qui demande politesse et exactitude. Mais quand je pique une crise envers mes joueurs, c’est une forme d’amour envers eux. Et j’en pique assez souvent.
On vous a surnommé le Guy Roux du rugby...
Henry Brocan. Je n’apprécie pas. Le foot, ce n’est pas le même monde que le rugby. Je n’aime pas le milieu du foot. Je n’ai pas regardé la finale France-Italie. Je faisais un scrabble !
Pourquoi quitter Auch au moment où l’équipe accède au Top 14 et rejoindre Agen ?
Henry Brocan. Agen m’a sollicité, je crois, plus comme meneur d’hommes que comme entraîneur. Dans le rugby, il y a encore un champ à exploiter : le mental. C’est difficile de conserver un collectif dans un monde de stars ! D’autre part, j’entraîne Auch depuis neuf ans et je suis arrivé au bout d’un cycle. À Agen, je serai bien mieux payé qu’à Auch mais je n’y vais pas pour l’argent.
J’y vais parce que je ne peux plus supporter que mes joueurs travaillent dans des conditions indignes d’un club pro. On s’est battus pendant neuf ans pour obtenir une salle de muscu ! J’avais d’abord dit non à Agen, puis j’ai changé d’avis en raison de mon impuissance ici à faire évoluer le club. Je ne supporte plus l’indifférence de la mairie. Je pars sur un échec.
Dans le sport de haut niveau, a-t-on le temps de s’intéresser à la campagne électorale ?
 Henry Brocan. On a un peu de mal. Il y a toujours un entraînement ou une séance vidéo. Et on a moins de temps à consacrer à ce qui se passe en dehors du rugby. Ségolène Royal et Marie-George Buffet sont venues à Auch mais je n’ai pas eu le temps d’assister à une seule réunion publique.
Henry Brocan. On a un peu de mal. Il y a toujours un entraînement ou une séance vidéo. Et on a moins de temps à consacrer à ce qui se passe en dehors du rugby. Ségolène Royal et Marie-George Buffet sont venues à Auch mais je n’ai pas eu le temps d’assister à une seule réunion publique.
Depuis l’âge de vingt-quatre ans, je suis très à gauche. J’ai été très déçu car les antilibéraux n’ont pu s’entendre pour présenter une seule personne. Au début, j’ai dit : je n’irai pas voter. Mais j’irai voter quand même !
Tout le monde sait ici que je voterai pour Marie-George Buffet au premier tour. C’est une femme extraordinaire. Pour le second tour, je verrai... J’ai toujours voté communiste. Je n’ai jamais caché mes opinions politiques. Tout ce que j’ai fait dans le rugby, je l’ai fait dans une démarche de gauche et même d’extrême gauche : partage du travail et des reconnaissances, éviter de trop gros écarts de salaire, mettre en avant le collectif... Je suis pour une société de partage.
Entretien réalisé par Bruno Vincens, pour l'Humanité
12:10 Publié dans Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rugby, sport, Auch, Broncan, présidentielles, MG Buffet |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Imprimer |
Imprimer |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook | |
Facebook | | 









